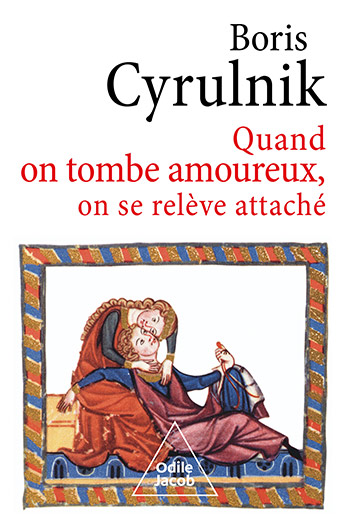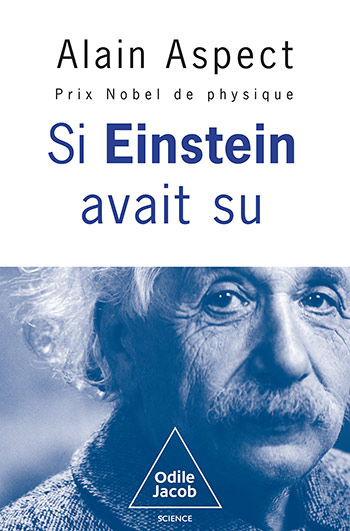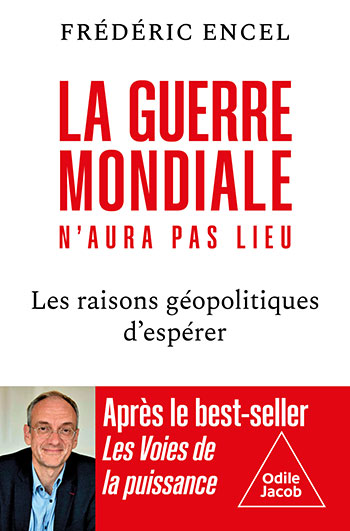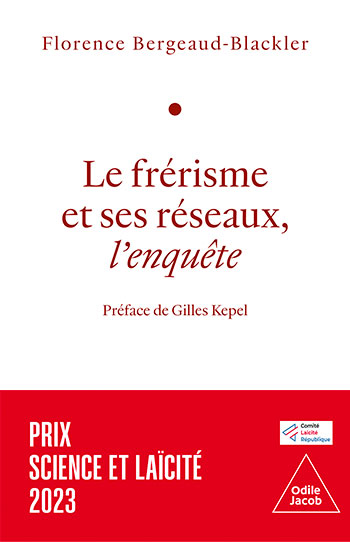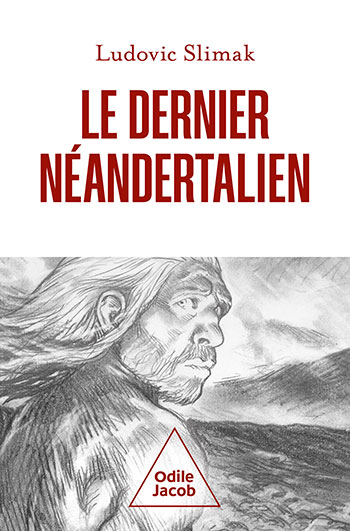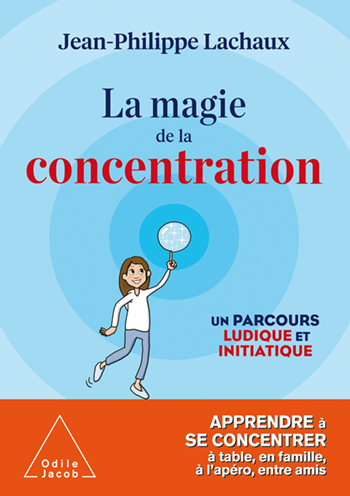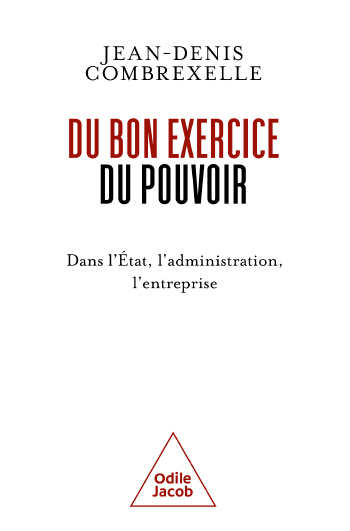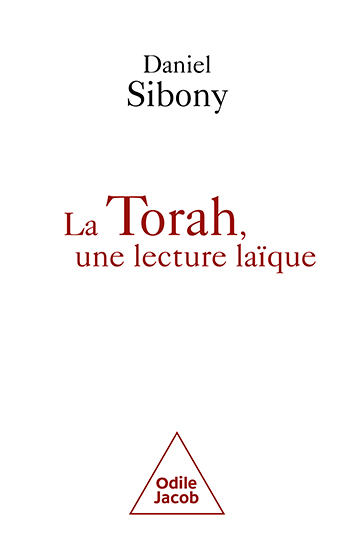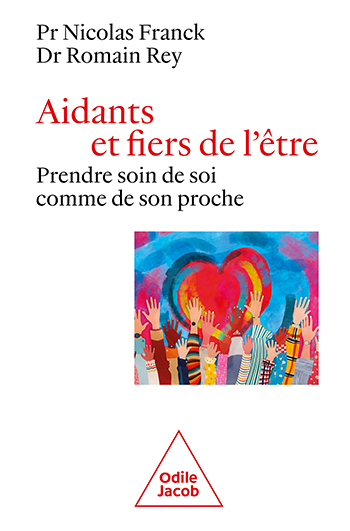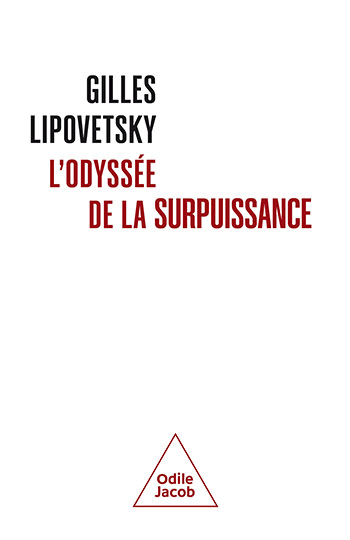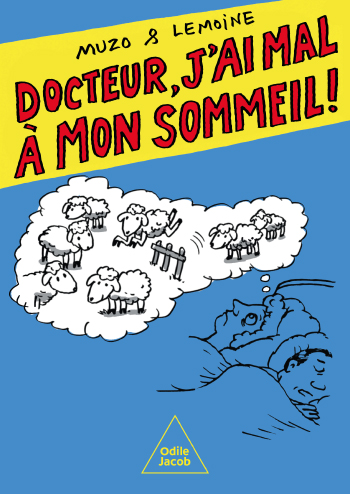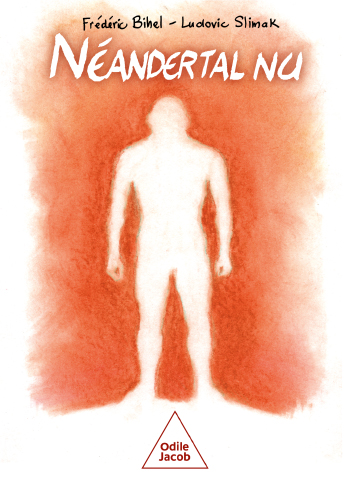Monsieur le président de la République,
Depuis des mois, des années, bien avant votre élection c’est vrai, de très nombreux professionnels ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’évolution extrêmement préoccupante du système de santé… sans réponse à la hauteur des problèmes soulevés.
Et ce que nous craignions tous, est advenu : un cataclysme. L’épidémie de Covid s’est abattue sur la nation plaçant l’hôpital public fragile, démuni, désossé, en première ligne. « Nous sommes en guerre », comme vous l’avez répété et après le « Blitzkrieg » de la première vague d’assaut, voici venir le temps des tranchées. Il faut tenir, mais les combattants épuisés vont déserter si le « plan massif » que vous avez annoncé, Monsieur le Président, n’est pas à la hauteur des enjeux.
Les collègues des Ehpad ont alerté depuis plusieurs années sur le manque de personnels et le manque de moyens. Aujourd’hui, ce sont les résidents, nos aînés, et les personnels des Ehpad qui ont payé et paient encore le plus lourd tribut à cette pandémie.
Après eux, les psychiatres ont expliqué que leurs moyens n’étaient plus à la hauteur des besoins croissants de notre population. Les personnels médicaux et paramédicaux, en nombre, ont été amenés à déserter les services de psychiatrie de l’hôpital public. Certains en sont même venus, l’année dernière, à se mettre en grève de la faim pour défendre leur spécialité au service de nos concitoyens. Les effets de la pandémie à Covid arrivent sur la psychiatrie. Les enfants et les adultes, habituellement suivis ou récemment fragilisés par ces semaines de confinement et ce stress généralisé, vont avoir besoin de ces soignants spécialisés.
Nos collègues des urgences s’y sont alors mis ; depuis plus d’un an maintenant. Certains, l’été dernier, se sont même fait porter pâles pour espérer être entendus. Aucun geste à la hauteur des enjeux. Et ils ont été en première ligne lorsque la vague est arrivée jusqu’à l’hôpital après avoir submergée nos collègues de ville, médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeutes, pharmaciens. La prime ne suffira pas à reconnaître leur travail et leur professionnalisme.
Alors, les autres médecins de toutes spécialités, de tous types d’exercice, de tous bords politiques et tous les autres personnels de l’hôpital public – administratifs, ingénieurs, secrétaires, techniciens, brancardiers –, se sont à leur tour mobilisés pour défendre l’hôpital public. Résultat : une toute petite rallonge budgétaire et de maigres primes pour une minorité des personnels.
Alors des services, des hôpitaux entiers ont arrêté la facturation à la Sécurité sociale pour démontrer à leur administration l’absurdité d’un système ne justifiant les soins que s’ils sont « rentables ». Toujours rien. Aucun geste réel pour arrêter cette destruction programmée.
Alors, 1 300 chefs de service sont même allés jusqu’à démissionner de leur fonction administrative en tout début d’année. Du jamais-vu. Comme si de rien n’était, les directeurs ont refusé de prendre acte de ces démissions, seule réponse à ce mouvement inédit.
Et ça y est, il faut remettre le système en route. Les affaires reprennent comme on dit. Les directions reviennent expliquer aux soignants exténués comment refaire marcher l’hôpital comme une entreprise commerciale.
Au début du mois de mars, juste avant la vague de Covid, voyant le drame arriver, le Conseil économique social et environnemental (Cese) – la troisième assemblée de la République – s’est saisi en urgence des difficultés de l’hôpital public. Il a voté le 11 mars 2020 à l’unanimité une résolution qu’il a nommée « Le droit à la santé pour tous » : 147 membres du Cese ont voté pour, 2 contre, 1 s’est abstenu. Le Cese transmettra dans quelques semaines un avis au Parlement et à votre gouvernement, Monsieur le Président. Nous sommes impatients. Nous espérons que lui, au moins, vous l’écouterez.
Pour faire face à la vague du Covid-19, l’hôpital public, malgré ces cris d’alerte jamais entendus, s’est organisé à la hâte, solidaire, collectif, efficace comme il l’est facilement quand on lui en donne les moyens pour réagir au mieux, sur tout le territoire, tant dans le nord-est de la France, submergé, que dans le sud, solidaire. Il a fallu courir après les lits, après les personnels, après le matériel, après les médicaments. Et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, les réanimations se vident petit à petit, les services de rééducation débordent mais l’épidémie n’est pas terminée et les patients non Covid reviennent enfin, encore plus fragiles. L’hôpital n’en peut plus. L’exceptionnel de quelques semaines ne pourra pas tenir plusieurs mois.
Pourtant, tous les soirs, les usagers nous remercient. Tous les matins, tous les midis, en garde, le week-end, ils cuisinent pour nous. Les enfants nous adressent des dessins de remerciements. Et nous sommes, nous aussi, profondément reconnaissants à tous nos concitoyens qui ont envie de prendre soin de nous à leur tour. Mais cela ne va pas être assez, Monsieur le Président. Ils vont devoir nous aider à vous montrer que vos paroles ne suffisent plus, qu’ils souhaitent, eux aussi, un hôpital public fort, véritable recours au milieu de son territoire, en connexion permanente avec les médecins libéraux, les structures privées, tous les collègues des soins primaires qui ont dû s’organiser pour faire face et qui montent désormais en première ligne.
Certainement pas « quoi qu’il en coûte » selon vos propres termes, mais seulement « au juste coût », pour la santé de nos anciens, de nos enfants, de tous nos concitoyens.
« Vous avez pu compter sur nous », Monsieur le Président, montrez-nous que nous pouvons désormais compter sur vous. Mettez en œuvre le programme de santé des « jours heureux » proposés par les professionnels de santé !
Le collectif interhôpitaux
Santé : le programme des « jours heureux »
L’« union sacrée » a prévalu pendant la crise sanitaire, quand tous les moyens devaient être mobilisés au service du soin, des soignants et de la protection des personnes exposées. L’heure du bilan vient. Et les propositions pour le « jour d’après » dépendront de l’évaluation qui sera faite des jours d’avant. Au nom de l’efficacité et de la démocratie, nous soignants, épidémiologistes, sociologues, économistes… citoyens et citoyennes avons le devoir de proposer.
Certains, de droite comme de gauche ou « ni de droite ni de gauche », reconnaissent que la crise sanitaire les amène à revoir leurs positions. Le président de la République, lui-même, a déclaré le 12 mars 2020 : « Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État providence ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Cette critique implicite du passé débouchait le 16 mars sur un engagement – « le jour d’après ne sera pas le retour au jour d’avant » – et le 25 mars sur la promesse d’« un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières pour l’hôpital ».
Tout le monde est peu ou prou d’accord pour reconnaître les défauts de préparation à la crise et les défaillances de l’État. D’aucuns mettront en cause la responsabilité personnelle de tel et ou tel décideur d’aujourd’hui ou d’hier. Nous pensons que le véritable débat doit porter sur la politique « managériale de marché » appliquée à la santé à l’échelle mondiale, même si la responsabilité en revient à chaque État et en l’occurrence à nos gouvernements successifs.
Pour certains, la crise n’est qu’une parenthèse. Le directeur de l’Agence régionale de santé du Grand Est en annonçant la reprise, dès la fin de l’épidémie, du plan de restructuration du CHU de Nancy (avec ses suppressions de lits et de personnels) n’a pas hésité à le dire. Deux anciens directeurs d’hôpitaux, MM. Guy Collet et Gérard Vincent (Le Monde, 24 avril 2020), anciens hauts responsables de la Fédération hospitalière de France, partisans de la tarification à l’activité (T2A) et de la gestion commerciale des établissements de santé, proposent même d’aller plus loin en transformant les hôpitaux publics en établissements privés à but non lucratif1 .
Il est donc indispensable que, parallèlement à la mise en œuvre des mesures nécessaires pour surmonter la crise sanitaire et en prévenir d’autres possibles, se tienne dans le pays un débat collectif sur l’après, si l’on veut éviter qu’une fois la crise terminée on reprenne la politique de l’avant, celle de la rigueur budgétaire à courte vue et de la gestion commerciale de la santé.
Les grandes crises sociales et politiques ont été par le passé l’occasion d’importants bonds en avant pour notre système de santé. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, création de la Sécurité sociale ; 1958, guerre d’Algérie et fin de la IVe République, création des centres hospitalo-universitaires où les médecins se consacrent à plein temps aux trois missions de soins, de recherche et d’enseignement ; 1968, accroissement du nombre d’étudiants en santé et remise en cause des rapports hiérarchiques dans la société et à l’hôpital, suivi, en 1970, par la fixation par la loi du cadre juridique du service public hospitalier et, en 1971, par la création du conventionnement entre la Sécurité sociale et les syndicats de médecins libéraux, permettant l’accès aux soins à des tarifs remboursés. Ces crises ont un point commun : elles ont été aggravées par les erreurs des gouvernements précédents, mais elles ont donné lieu à un sursaut du pays réalisant concrètement ce qui paraissait infaisable auparavant. Ce qui semblait impossible s’est imposé dans la crise. Ainsi, en quelques semaines, le Covid-19 a pulvérisé le collier de fer budgétaire hospitalier, la gestion entrepreneuriale assimilant l’hôpital à une chaîne de production, le millefeuille administratif et les réunions inutiles. Jadis sans cesse critiqués pour leur « manque d’organisation » et leur « résistance au changement », les soignants sont soudainement devenus des « héros » réorganisant l’hôpital tandis que les « manageurs » se mettaient à leur service. Et le dogme de la tarification à l’activité (T2A) tout comme l’encouragement à l’« optimisation du codage » (c’est-à-dire à la maximisation de la facture adressée à la Sécurité sociale) ont été submergés par une vague qu’on ne savait pas facturer. Quant au projet de développement du « tourisme médical haut de gamme », il a semblé d’un autre âge…
De même, la pandémie de Covid-19 a montré l’importance majeure des soins primaires pour orienter les patients et suivre ceux ne nécessitant pas ou plus d’hospitalisation. Elle a mis en évidence la nécessité du travail en équipe, de la coopération ville/hôpital et de la complémentarité public/privé au lieu de la concurrence. Elle a révélé l’inadaptation du paiement à l’acte pour les vraies urgences comme pour le suivi des patients atteints de maladies chroniques qui, pendant la crise, allaient directement chez leur pharmacien pour renouveler la délivrance de leurs traitements… Mais, pour espérer que ces changements survivent à la pandémie, il faut élaborer un projet collectif.
À l’opposé de la vision industrielle de la médecine tendant à transformer les médecins en ingénieurs, les paramédicaux en techniciens, les patients en clients et l’hôpital en entreprise commerciale, nous défendons une politique considérant la santé comme un « bien commun » devant échapper aux lois du marché et à la mainmise de l’État, bien collectif dont la gouvernance doit être partagée entre toutes les parties prenantes. Ce « bien commun » doit reposer sur un service public refondé.
Nous proposons l’édification d’un nouveau service public de santé reposant sur cinq piliers :
1. le service public de l’assurance-maladie ;
2. le service public des soins et de la prévention ;
3. le service de la sécurité sanitaire et de la santé publique, avec un Établissement public du médicament et des dispositifs de santé ;
4. le service de l’enseignement et de la formation continue ;
5. le service de la recherche en santé.
Il faut réaffirmer que « service public » ne signifie pas étatisation mais veut dire « au service du public », comme l’illustre de façon éclatante la prise en charge des patients victimes du Covid-19. Et l’expression « au service du public » comporte cinq principes :
1. L’universalité et l’automaticité de l’accès au système de santé, l’égalité face aux besoins de soins et la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé.
2. L’exigence du juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité et non la recherche de la « rentabilité » pour l’établissement ou pour le professionnel. En effet, un système de financement qui introduit un intéressement financier pour le médecin ou pour l’hôpital peut conduire à des actes ou des prescriptions non justifiés, inutilement coûteux voire dangereux pour le patient. Dans un système de santé égalitaire et solidaire, les dépenses inutiles de certains privent d’autres de soins indispensables.
3. La primauté des intérêts de santé publique sur les intérêts économiques et financiers des industriels, en particulier des industriels de la santé.
4. La liberté pour le patient de choisir son médecin dans le cadre de la graduation de l’offre de soins (allant des soins primaires aux centres référents), la pratique de la décision médicale partagée entre soignants et soignés, le respect de la confidentialité du colloque singulier et la protection des données individuelles de santé.
5. L’information et l’éducation des usagers sur l’histoire de la construction de notre système de santé, son organisation et son financement actuels, permettant leur implication dans son fonctionnement. L’association des usagers à la « gouvernance », c’est-à-dire à la direction des établissements et des diverses instances du système de santé au côté des professionnels et des gestionnaires.
1. Le service public de l’assurance-maladie
Le service public de l’assurance-maladie assure le financement des soins essentiels, afin de garantir à tous un accès aux soins et à la prévention en fonction de ses besoins, sans problème d’accès financier. En pourcentage de PIB consacré à la santé, la France se situe en 3e position des pays de l’OCDE avec l’Allemagne (11,2 %), après la Suisse (12,2 %) et les États-Unis (17,2 %), mais elle n’est qu’en 12e position en dollars dépensés pour la santé par habitant (l’Allemagne dépense 5 900 dollars par habitant contre 4 900 pour la France, soit 20 % en plus, et le Luxembourg qui a un PIB par tête très élevé n’y consacre que 6 % pour la santé mais dépense plus que la France en dollars par habitant).
Quand on compare les systèmes de santé des différents pays de l’OCDE, il apparaît que plus un système de santé est public dans son financement, plus il est efficient économiquement, socialement juste et performant du point de vue de la santé publique. Inversement, plus le financement d’un système de santé est privé, plus il est injuste, inégalitaire et coûteux. Sur un marché concurrentiel, les assurances privées sont fatalement contraintes d’ajuster le montant des primes au risque et à l’âge de la personne. De plus, parce que la santé est un bien supérieur conditionnant tous les autres biens, l’assuré n’est pas « un consommateur éclairé » choisissant librement le contrat proposé par l’assureur, pas plus qu’il ne choisit tout seul le traitement proposé par son médecin. Et cette asymétrie informationnelle et émotionnelle rend illusoire en matière de santé l’idée que la libre concurrence permet d’obtenir la qualité au plus bas prix. La concurrence entre mutuelles et compagnies d’assurances, loin de faire baisser le montant des primes tend à les augmenter.
1.1. Le service public de l’assurance-maladie repose sur la Sécurité sociale, définie comme un « bien commun », financée environ pour un peu plus de la moitié par des cotisations et pour un peu moins par des taxes ou des impôts dédiés, comme la contribution sociale généralisée (CSG). La part des recettes directement liées au travail, apportées par les cotisations considérées comme un « salaire socialisé », a régulièrement diminué conduisant en 1991 à la CSG impôt proportionnel portant sur l’ensemble des revenus.
1.2. Le financement de la dépense solidaire de santé doit porter sur l’ensemble des revenus, ce qui suppose la suppression des niches fiscales et sociales, le déplafonnement des cotisations sociales pour les plus hauts revenus et la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Il doit être progressif et indépendant des risques personnels, notamment de l’âge des assurés, assurant ainsi la double solidarité des bien portants avec les malades et des plus riches avec les moins fortunés.
1.3. La prestation remboursée par la Sécurité sociale doit être la même pour toutes et tous. La séparation du « petit risque » du « gros risque » fragilise la solidarité entre bien portants et patients, tandis que la franchise restant à la charge du patient aggrave les inégalités sociales de santé en nuisant à l’accès aux soins des plus démunis. Quant à l’instauration d’un « bouclier sanitaire fonction des revenus », elle minerait la solidarité des plus fortunés bien portants avec les moins fortunés, dans la mesure où les premiers auraient le sentiment de payer deux fois : la Sécu pour la solidarité avec les pauvres et leur assurance privée personnelle de plus en plus cher pour payer le « bouclier ». Le consentement à la solidarité n’y résisterait pas. Cette solidarité ne peut se maintenir durablement que si les prestations prises en charge pour tous par la Sécurité sociale sont de haute qualité (au juste coût), c’est-à-dire conformes aux données scientifiques et personnalisées, délivrées par des professionnels suivant une formation continue recertifiante.
L’épidémie nous rappelle que la solidarité des plus riches à l’égard des plus pauvres ne relève pas seulement de l’altruisme mais d’un intérêt bien compris. Le Covid-19 ne choisit pas ses victimes, même si la crise sanitaire et la crise sociale frappent d’abord les plus démunis, favorisant la constitution de « clusters » parmi les populations précaires. Et ces « clusters » menacent en retour l’ensemble de la société. Une solidarité réservée aux plus pauvres devient très vite une pauvre solidarité, avec des conséquences négatives pour l’ensemble de la société, comme on le voit aux États-Unis. Et ce qui est vrai à l’échelle d’un pays, l’est également à l’échelle de l’humanité tout entière. Pour vaincre la pandémie, c’est l’intérêt bien compris des pays riches d’aider les pays pauvres.
1.4. Il faut en finir avec le doublon coûteux de la gestion des remboursements des soins à la fois par la Sécurité sociale et par les assurances privées dites complémentaires (mutuelles, instituts de prévoyance, compagnies d’assurances). Pour s’en convaincre il suffit de rapprocher les frais de gestion de la Sécurité sociale – 7,3 milliards – qui rembourse 78 % des soins de ceux des assurances privées – 7,5 milliards – qui ne remboursent que 13 % des soins. Mais celles-ci sont soumises aux directives européennes assurantielles et doivent s’acquitter des coûts de la concurrence : démarchage, publicité, etc.
Ce double système fait progressivement glisser une proportion de plus en plus importante du remboursement des soins courants vers les assurances privées, même si ce sont pour la plupart des assurances mutualistes à but non lucratif. Mais la frontière est de plus en plus ténue avec les compagnies d’assurances à but lucratif qui gagnent du terrain et cherchent à s’emparer d’un marché potentiel de 200 milliards d’euros. Un plan de transition progressive, par transfert de l’essentiel des recettes des assurances dites complémentaires vers un régime unifié « 100 % assurance-maladie publique », doit être mis en œuvre. Ce plan devra préciser, avec les professionnels, les modalités de mise en œuvre du tiers payant, dispensant de l’avance de frais pour éviter le renoncement aux soins qui risque de s’accroître avec la crise actuelle.
1.5. Il faut définir un large panier de prévention, de soins et de services remboursé à 100 % par la Sécurité sociale. Incluant les activités de prévention, de soins et d’accompagnement, son périmètre doit être médicalement validé et socialement accepté, dans un exercice de démocratie sanitaire transparent. Dans ce cadre, on l’aura compris, il n’y aura plus besoin d’assurances complémentaires. Ne subsisteraient que des assurances supplémentaires pour des soins ne relevant pas de la solidarité mais répondant à des choix personnels (surcoût dû au refus des génériques, médecines dites « complémentaires » ou « alternatives », chirurgie esthétique, cosmétiques… cures thermales ?).
1.6. Les recettes de la Sécurité sociale doivent être sanctuarisées.
L’État doit compenser intégralement toute exonération de taxes ou de cotisations sociales. Il faut donc revenir sur l’abrogation par la majorité parlementaire en 2018, de la loi Veil de 19942.
1.7. La stratégie nationale de santé, définissant et hiérarchisant les objectifs et les priorités, doit être débattue et votée en début de quinquennat, en intégrant les propositions faites lors des campagnes électorales. Contrairement à la situation actuelle, les réformes du système de santé doivent être votées par le parlement en même temps que la planification des moyens alloués à leur réalisation (le plan « Ma santé 2022 » est un catalogue d’objectifs non financés). Chaque année avant le vote du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), la Conférence nationale de santé représentant l’ensemble des acteurs de la santé doit faire des propositions au Parlement qui doit débattre et approuver la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé.
1.8. L’Objectif national des dépenses de l’assurance-maladie (Ondam) voté chaque année par le Parlement doit être fixé non pas à partir des calculs budgétaires de l’État, mais à partir de la prévision d’augmentation programmée des charges et des besoins, prévision qui doit inclure le financement des mesures d’application de la stratégie nationale de santé et le financement du panier de soin et de prévention « solidaire ». Cette prévision de l’augmentation des dépenses doit être réalisée par un organisme indépendant du gouvernement dont la composition ne doit pas se limiter aux seuls experts mais impliquer aussi les partenaires sociaux, les fédérations hospitalières et médico-sociales, les représentants des professionnels et des usagers. Si la représentation nationale décide d’un budget inférieur aux prévisions d’augmentation des dépenses, les postes d’économie et les moyens de les réaliser doivent être négociés préalablement avec la Caisse nationale de l’assurance-maladie (Cnam). Les conséquences de ces économies sur la prise en charge du « panier solidaire » doivent communiquer aux citoyens de façon transparente, avant leur adoption par le Parlement. Il faut en effet éviter que ne se reproduise le scénario de 2019 : alors que l’augmentation des dépenses hospitalières prévue pour 2020 était selon le ministère de 3,3 %, le gouvernement avait fait voter, en première lecture, une augmentation du budget hospitalier (l’Ondam hospitalier) réduite à 2,1 %. Il imposait ainsi à l’hôpital, sans débat et sans négociation avec les acteurs concernés, une économie supplémentaire de plus de 800 millions.
1.9. Tout déficit de l’assurance-maladie devrait être analysé par secteur de dépenses. Sa résorption nécessite un choix entre :
– une augmentation nationale des recettes ;
– une diminution ciblée de dépenses médicalement non justifiées eu égard au respect de la règle éthique « du juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité » qui s’impose à tous, soignants comme patients ;
– une réduction assumée du panier de soin et de prévention solidaire.
Ces choix supposent une consultation préalable avec avis des professionnels et des usagers dans le cadre de l’exercice de la démocratie sanitaire, impliquant un nouveau changement de gouvernance de la Sécurité sociale.
1.10. L’État doit être le garant mais pas le gestionnaire exclusif de la Sécurité sociale. Sa « gouvernance » doit être revue en donnant une place aux professionnels de santé et aux usagers qui devront siéger de plein droit au conseil de la Caisse nationale de l’assurance-maladie (Cnam) et dans les instances et comités qui en dépendent. Une de ces instances, réunissant les représentants des assurés sociaux, des associations d’usagers et des représentants des professionnels de ville et de l’hôpital, sera dédiée à la définition du panier de prévention, de soins et de services. Ce « panier solidaire 100 % » prendra en compte les données scientifiques présentées par la Haute Autorité de Santé (HAS) et les sociétés savantes. De même, les représentants des usagers devraient participer aux négociations conventionnelles avec les organisations professionnelles. Il faut revenir à l’esprit des pères fondateurs qui conçurent la Sécurité sociale comme un « bien commun » ne pouvant être ni privatisé ni étatisé. La Sécurité sociale a malheureusement évolué à la fois vers plus d’étatisation et plus de privatisation, la première servant de levier à la seconde, pour donner une place toujours plus importante aux assurances maladies complémentaires privées, réunies depuis 2004 dans l’Union nationale des organismes complémentaires de l’assurance-maladie (Unocam). En effet, en plus du ticket dit « modérateur » de 20 %, on a de plus en plus délégué aux assurances privées, non seulement la prise en charge des soins courants remboursés à moins de 50 % par la Sécurité sociale, mais aussi le remboursement des dépassements d’honoraires (secteur 2 avec dépassements d’honoraires). Ces dépassements peuvent être justifiés par la sous-valorisation des tarifs officiels remboursés par la Sécurité sociale (secteur 1 conventionné dans lequel les praticiens ne peuvent pas dépasser un tarif opposable par exemple 25 euros pour la consultation chez un médecin généraliste).
2. Le service public de soin et de prévention
L’épidémie de Covid-19 a révélé notre impréparation à la gestion des pandémies. Elle a aussi démontré à la fois la force et les faiblesses de notre système de soin, non pas que le meilleur système de soin n’aurait pas été submergé par l’ampleur de la vague. Sa force a tenu à plusieurs facteurs : la mobilisation extrême et la capacité d’initiatives de ses personnels soignants malgré l’insuffisance des dispositifs de protection, la mobilisation de tous les moyens disponibles pour traiter une seule maladie, l’administration se mettant au service du soin et la coopération entre l’hôpital et la ville. Mais le Covid-19 a percuté un système de santé qui était déjà secoué par de multiples crises sur lesquelles les professionnels avaient en vain essayé d’attirer l’attention des pouvoirs publics depuis plusieurs années : crise des urgences, crise du premier recours en ville et des déserts médicaux, crise de l’épidémie de bronchiolite, crise gravissime de la psychiatrie, crise du manque de personnel soignant paramédical et médical dans les hôpitaux publics. Ces crises se sont traduites par la démission de plus de 1 000 chefs de service et responsables d’unités de soins début janvier 2020. Il faut ajouter la crise des Ehpad, la crise de la médecine préventive (du travail, de PMI, scolaire), la crise des ruptures répétées en approvisionnement de médicaments essentiels. Les économies budgétaires à courte vue imposées pendant des années se révèlent aujourd’hui très coûteuses.
Cette accumulation de crises sectorielles révèle plus fondamentalement une crise paradigmatique de notre système de santé aggravée par la rigueur budgétaire. Nous avons en effet construit un système de soin centré, d’une part, sur la maladie aiguë bénigne et les gestes techniques simples adaptés au paiement à l’acte en ville et, d’autre part, sur les actes techniques hospitaliers spécialisés, programmés, standardisés, adaptés au financement au séjour par la T2A. C’est le champ d’activité privilégié des cliniques privées contraintes par leur statut de choisir les activités rentables ou du moins convenablement financées. Ces activités sont compatibles avec la vision industrielle marchande développée par une idéologie prônant la concurrence entre le public et le privé. C’est en référence à ces activités qu’a été mise en place, dans les hôpitaux français, la « gouvernance d’entreprise » par la loi HPST de 2009. Mais notre système, son mode d’organisation et son mode de financement sont devenus inadaptés aux urgences et aux maladies chroniques, en ville comme à l’hôpital. En effet, la prise en charge des urgences nécessite un travail en équipe avec des moyens d’investigation, toutes choses qu’on réalise à l’hôpital et qu’on peut faire en ville dans des centres de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des maisons de garde travaillant de façon coordonnée avec les services hospitaliers d’accueil des urgences (SAU). Elles sont cependant plus difficiles pour un médecin seul dans son cabinet. L’organisation de la permanence des soins en ville, sans surcoût pour les patients, permettrait de réduire les passages non justifiés aux urgences hospitalières. Cependant, la prise en charge des vraies urgences hospitalières suppose d’avoir en permanence des lits d’aval vides dans des services dédiés, pour éviter aux malades les heures passées sur des brancards dans l’attente d’un lit et/ou éviter l’hospitalisation dans des services inadaptés aux soins requis par leur pathologie. De même, notre système n’est pas adapté à la prise en charge des maladies chroniques qui nécessite un travail en équipe pluriprofessionnelle, une médecine intégrée biomédicale et psychosociale, une activité coordonnée entre la ville et l’hôpital, une éducation thérapeutique des patients, et un accompagnement : la « 3e médecine ».
L’intelligence artificielle et les nouvelles technologies modifient d’ores et déjà les pratiques du soin et devraient bouleverser particulièrement certaines disciplines médicales comme la radiologie, la cancérologie, la chirurgie et la médecine interventionnelle. Elles aideront au diagnostic des maladies et à l’évaluation personnalisée du rapport bénéfice/risque des traitements. La télémédecine facilitera le suivi des patients, mais les NBIC (nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives) ne remplaceront pas le colloque singulier pour l’annonce d’une maladie grave comme pour la prise en compte du vécu et des représentations des patients nécessaire à l’amélioration de l’observance des traitements. Le manque d’observance est en effet le grand défi des maladies chroniques, ces maladies que l’on soigne de plus en plus efficacement mais qu’on ne guérit pas. Les progrès technologiques, loin d’entraîner une industrialisation généralisée de la médecine, devraient au contraire promouvoir le développement de la « médecine narrative », redonnant toute sa place à la parole du patient. Contrairement aux rêves de certains scientistes, l’être humain séquencé et connecté ne se réduira pas à un tas de chiffres. Le professionnel de santé ne sera pas un prestataire comme un autre, « ubérisable ». Et l’équipe pluriprofessionnelle qui prend en charge un patient dans sa globalité et sa complexité ne pourra être remplacée par un algorithme. La lutte contre le Covid-19 a montré l’importance des progrès biomédicaux et technologiques et, en même temps, leurs limites pour la prévention et le traitement, comme pour la réponse au besoin humain le plus fondamental : la relation. La médecine de demain sera biotechnologique et individualisée. Mais pour être une médecine de la personne, elle devra aussi être intégrée et relationnelle.
2.1. Les principes du service public de soin et de prévention sont, outre la neutralité idéologique, politique et religieuse :
2.1.1. L’égalité d’accès sur tout le territoire à des soins au tarif remboursé par la Sécurité sociale. Une telle égalité suppose la revalorisation des tarifs du secteur 1 et la prise en charge par l’État de l’assurance de responsabilité professionnelle et d’une partie des frais d’équipements, de secrétariat et de logistique des professionnels de santé libéraux. L’installation en secteur 2 avec dépassements d’honoraires doit être contingentée dans les territoires de santé pour les spécialités médicales ayant déjà une densité médicale élevée. Plus fondamentalement, le secteur 2, créé en 1980 malgré l’opposition de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), le principal syndicat de médecins libéraux, doit être mis en extinction progressive pour les nouvelles générations de médecins. Cette mise en extinction suppose une revalorisation du secteur 1, négociée avec les professionnels. Il ne persisterait plus à terme que deux secteurs : le secteur 1 revalorisé et le secteur 3 hors convention. D’ores et déjà, tout professionnel de santé exerçant au tarif remboursé par la Sécurité sociale fait partie du service public quel que soit son statut, libéral ou salarié, ou le statut de l’établissement dans lequel il exerce.
2.1.2. La continuité des soins. Elle implique l’organisation structurée et coordonnée entre les professionnels des soins primaires reposant sur le trio, médecins généralistes, infirmiers(ères) de ville, pharmaciens, du second recours spécialisé médical et paramédical en ville ou à l’hôpital, du troisième recours de référence et enfin des soins de suite et de réadaptation.
2.1.3. La prise en charge globale des patients, c’est-à-dire non seulement biomédicale mais aussi psychologique et sociale, non seulement curative mais préventive, ce qui nécessite une formation adaptée des professionnels ainsi que l’intégration des psychologues cliniciens aux professions de santé. Une telle prise en charge suppose une coordination des professionnels du soin avec ceux du secteur médico-social et social. Ni le paiement à l’acte ni la T2A qui supposent une activité standardisée, ne sont adaptés à cette pratique intégrée de la médecine.
2.1.4. L’amélioration de la qualité des soins. La qualité suppose :
– une formation continue des professionnels de santé ;
– une activité suffisante (on ne fait bien que ce que l’on fait souvent) en définissant des seuils. Leur application sera toutefois modulée pour éviter de supprimer des activités utiles en dessous du seuil ou d’induire une augmentation abusive des indications non pertinentes pour atteindre le seuil ;
– des soins dispensés par des professionnels travaillant en équipe pluriprofessionnelle, avec des effectifs en nombre suffisant et stable ;
– la pratique de l’autoévaluation et du retour d’expérience sur les événements indésirables, graves ou non ;
– l’organisation de la coordination avec les professionnels de l’amont et de l’aval ;
– l’information des patients et la pratique de la « décision médicale partagée ».
L’évaluation externe sur des indicateurs construits avec les professionnels et les usagers, doit avoir pour but l’amélioration de la pratique des professionnels et non leur rémunération ou le financement de l’établissement. Ses résultats doivent être portés à la connaissance des usagers, mais le financement à partir de scores d’indicateurs institutionnels prétendument de qualité, source de nombreux biais comme l’ont montré de nombreuses études anglaises et américaines, doit être abandonné. En réalité, l’évaluation la plus pertinente est celle réalisée par les pairs et par les usagers.
2.1.5. La pertinence des prescriptions et des actes. Une part croissante des dépenses de santé de la France tient au volume des prescriptions, qu’il s’agisse de médicaments ou d’examens complémentaires de biologie et d’imagerie, parfois inutilement répétés. Cette logique prescriptive aboutit à une véritable médicalisation de l’existence, chaque symptôme entraînant la rédaction d’une ordonnance. On constate également une variation inexpliquée des actes d’un territoire de santé à l’autre pouvant aller de un à quatre (thyroïdectomies, prostatectomies pour cancer, chirurgie bariatrique, cholécystectomies, hystérectomies, pose de stents ou de pacemakers…).
Il n’y a toujours pas à ce jour de vraie politique mobilisant l’ensemble des acteurs, sociétés savantes, doyens, enseignants en médecine, associations de formation continue, syndicats de médecins, associations de patients et les instances du système de santé (HAS, agences sanitaires, assurance-maladie) pour améliorer la pertinence des prescriptions et des actes. Cette médecine surprescriptive est favorisée par la valorisation des actes techniques par rapport à la relation de soin ainsi que par le paiement à l’acte et par la T2A induisant, l’un et l’autre, le cercle vicieux d’une augmentation du volume d’actes pour compenser l’insuffisance de certains tarifs.
La comparaison avec les prises en charge des pathologies fréquentes dans les autres pays européens devrait donner lieu à des débats au sein des instances, des réunions et des congrès de professionnels médicaux et paramédicaux, d’usagers et de citoyens.
Le développement du dossier médical partagé (DMP), facilement accessible à tout professionnel, doit devenir une réalité. Malgré ses limites, il devrait entraîner une plus grande cohérence des pratiques et faciliter l’autoévaluation des professionnels. On peut en espérer une réduction des prescriptions inutilement répétées et des actes injustifiés. Les praticiens ayant des méthodes manifestement déviantes par rapport à un consensus professionnel validé doivent en être informés, bénéficier de rencontres confraternelles et si besoin être placés sous autorisation préalable pour un certain nombre d’actes. La formation médicale continue, rendue indépendante de l’industrie, avec une recertification à intervalle régulier doit devenir une exigence pour tous les médecins cliniciens exerçant en ville comme à l’hôpital. Enfin, la promotion des bonnes pratiques de soins auprès de l’ensemble de la population, comme cela a été fait pour la prescription des antibiotiques (« un antibiotique, ce n’est pas automatique »), devrait être réalisée pour d’autres médicaments fréquemment prescrits (antihypertenseurs, antidiabétiques, anticoagulants, antalgiques, somnifères, psychotropes…) notamment pour l’observance, l’autosurveillance et la prévention des effets secondaires.
2.1.6. Cette politique continue d’amélioration de la pertinence des prescriptions et des actes suppose évidemment l’indépendance vis-à-vis des industriels, mais elle ne doit pas remettre en cause l’indépendance des prescripteurs vis-à-vis de l’État et de l’assurance-maladie. Cette indépendance ne veut bien sûr pas dire que les professionnels n’ont aucun compte à rendre. Les prescripteurs doivent être capables de justifier leurs prescriptions eu égard aux données de la science et dans le respect du principe éthique du juste soin au moindre coût.
2.1.7. La juste rémunération des professionnels. Lorsqu’on analyse la structure des dépenses santé du pays, on est frappé par la relative modération des revenus des professionnels de santé du premier recours (médecins généralistes, infirmiers) ainsi que des professionnels hospitaliers (personnels non médicaux mais aussi internes et jeunes médecins) en dehors des médecins hospitaliers ayant une activité privée. Nous sommes en 28e position sur 32 pays de l’OCDE pour le salaire des infirmiers(ères) hospitaliers(ères) avec une moyenne de 1 800 euros brut par mois.
Ce service public de soin et de prévention comprend :
2.2. Un service public de médecine de proximité. L’épidémie de Covid-19 a montré à la fois le rôle essentiel des « soins primaires », c’est-à-dire de première ligne, et la capacité de réorganisation des professionnels de santé de ville réunis dans des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS). Ils ont instauré des consultations dédiées et créé des centres Covid, permettant d’éviter des consultations injustifiées dans les services d’urgences hospitaliers. Ils ont confirmé l’utilité du travail en équipe pluriprofessionnelle pour le suivi à domicile des patients ne pouvant se déplacer. Il faut rattraper le retard historique pris dans sa construction.
2.2.1. Le service public de médecine de proximité comporte les médecins généralistes (spécialistes de médecine générale), les médecins spécialistes, les infirmiers(ères), les pharmaciens, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les podologues, les orthophonistes, les orthoptistes, les biologistes… et les autres professionnels paramédicaux, pratiquant les tarifs remboursés par la Sécurité sociale. Il intègre également les services de l’enfance de prévention et de promotion de la santé.
2.2.2. Il doit faciliter le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles (libérales) et des centres de santé (salariés). Ces organisations collectives pluriprofessionnelles permettent aux équipes soignantes à la fois d’assurer les soins de proximité et de participer à des activités de santé, préventives et participatives, pour la population du territoire. Au sein de ces équipes se développent des nouveaux métiers comme les infirmiers(ères) dits de pratiques avancées (IPA), les infirmiers(ères) du programme Asalée (Action santé libérale en équipe) effectuant des activités de dépistage et d’éducation thérapeutique, les assistants médicaux assurant notamment des tâches administratives et les médiateurs en santé pour des populations vulnérables. Ces structures correspondent aux souhaits de nombreux jeunes médecins, d’un « nouveau mode d’exercice » : travail en équipe, modes de rémunération différents du paiement à l’acte (y compris pour certains, le salariat), réduction du temps consacré aux tâches administratives ou consacrées à la gestion, temps suffisant pour la formation professionnelle continue, l’enseignement ou la participation à la recherche clinique, avec des horaires de travail maîtrisés.
Le système conventionnel qui régule les relations entre l’assurance-maladie et les syndicats médicaux doit être réorganisé afin de permettre l’expression de la spécificité de l’exercice pluriprofessionnel libéral et salarié.
Le statut de société coopérative d’intérêt collectif en cours d’expérimentation dans certains territoires doit être soutenu.
2.2.3. Les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) associent tous les professionnels de santé qui le souhaitent, les centres de santé, les maisons de santé, les réseaux de santé et l’ensemble des établissements de santé. Y participent les représentants des usagers. Soutenues par les mairies, les ARS et l’assurance-maladie, elles assurent l’accès aux soins pour tous, coordonnent l’offre de soins et promeuvent la santé publique.
2.2.4. Les CPTS aident notamment à tisser des liens structurés entre les professionnels des soins primaires et les professionnels du second recours en ville ou à l’hôpital, ainsi qu’avec les professionnels du secteur médico-social.
Les spécialistes installés en ville peuvent apporter leur expertise à leurs collègues généralistes (suivis à intervalle régulier de patients nécessitant une prise en charge spécialisée par un médecin référent, consultations pour un épisode de soins, conseils et avis ponctuels, télé-expertise, ou discussion de dossiers cliniques complexes, formation…), notamment en consultant dans plusieurs centres ou maisons de santé pluriprofessionnelles d’un territoire. Leur rémunération, au tarif révisé et remboursé par la Sécurité sociale, devrait revaloriser l’acte intellectuel au contraire de la survalorisation actuelle des actes techniques.
2.2.5. Les professionnels de santé, doivent pouvoir développer la télémédecine (téléconsultations et télésurveillance), médicale et paramédicale, pour le suivi des patients, notamment dans des territoires sous-médicalisés. Pour ce faire les professionnels de soins primaires doivent avoir des liens structurés avec les personnels de santé (aides soignantes, infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes, psychologues…) exerçant dans ces territoires. Mais la télémédecine ne saurait remplacer ni l’examen clinique ni la relation présentielle.
2.2.6. Les CPTS ont obligation d’organiser la continuité des soins pour éviter l’engorgement des services d’urgences par des consultations relevant de la médecine générale. Pour ce faire, elles accompagnent la mise en place des consultations sans rendez-vous. Elles assurent l’ouverture, en dehors des horaires réguliers de consultations, de maisons médicales de garde en lien avec le 15 et les services d’urgences. Les CPTS pourraient organiser des permanences d’accès aux soins de santé gratuits (PASS de ville), financés par les ARS pour les personnes en grande précarité.
Il revient aux équipes de soins primaires de guider les patients dans le système de santé.
2.2.7. Le maintien à domicile des personnes dépendantes qui le souhaitent, âgées ou non, est un enjeu majeur. Ce maintien nécessite la collaboration avec le secteur médico-social et l’hospitalisation à domicile sur tout le territoire. Parallèlement, il est essentiel de renforcer les effectifs et la formation des personnels soignants dans les Ehpad.
2.2.8. Les CPTS développent des actions de santé publique avec une approche populationnelle, en fonction des besoins prioritaires de leur territoire et en relais, quand cela est pertinent, des actions décidées régionalement ou nationalement. Elles doivent développer une fonction sentinelle en santé publique, notamment vis-à-vis des épidémies et des risques environnementaux.
2.2.9. Les professionnels des soins primaires participent à l’enseignement des étudiants en médecine et paramédicaux et contribuent à des activités de recherche en soins primaires, en lien avec le service public de la recherche. Ces missions nécessitant une formation doivent être reconnues et valorisées financièrement.
2.2.10. Les services de protection maternelle et infantile, de planification familiale, les réseaux périnataux, la médecine scolaire, la médecine des adolescents et la pédopsychiatrie seront regroupés dans un service de santé unifiée de l’enfance et de la famille. Ils endosseront également la dimension médico-sociale de l’urgence et en particulier contribueront à la réponse aux violences intrafamiliales.
2.2.11. Il faut revoir le paiement à l’acte pour le suivi des patients atteints de maladies chroniques en permettant l’expérimentation par les professionnels volontaires, de nouvelles formes de rémunération (capitation, dotation annuelle populationnelle…) et développer les paiements forfaitaires notamment pour des missions de santé publique pour des populations ciblées (prévention, dépistage, éducation à la santé…). Le paiement à la performance, inclus dans le revenu sur objectif de santé publique (ROSP), n’a pas fait la preuve de son efficacité pour l’amélioration de la qualité des soins. Il doit être transformé pour aider à financer les structures et l’organisation, notamment les frais de secrétariat.
Les actes de soin des paramédicaux, particulièrement des infirmiers(ères) doivent être revalorisés ainsi que les indemnités de déplacement (2,50 euros le déplacement). La rémunération prévue pour les « infirmiers(ères) de pratique avancée » en libéral n’encourage pas à développer cette activité pourtant fondamentale pour l’offre de soins territoriale. Il faut enfin prévoir des enveloppes budgétaires pour des soins paramédicaux aujourd’hui non remboursés par la Sécurité sociale, dans des indications médicales spécifiées (psychologues, podologues, diététicien[ne]s…).
2.3. Un service public hospitalier et de soins de suite et réadaptation (SPHSSR).
L’épidémie a montré la nécessité de remettre la gestion administrative au service du soin et non l’inverse. Les responsables de la gestion d’un établissement public doivent, en effet, être au service des équipes de soin pour les aider à mettre en œuvre le projet de santé des établissements, en cherchant à atteindre les objectifs au moindre coût pour la collectivité et non en privilégiant les activités financièrement rentables pour l’établissement. C’est en effet ce qui distingue fondamentalement un établissement public d’un établissement privé. Ce dernier est obligé par son statut de rechercher la rentabilité pour investir et se développer (établissements privés à but non lucratif, Espic) et en plus pour payer ses actionnaires (cliniques commerciales). Ainsi les établissements privés cherchent à gagner des « parts de marché » en privilégiant les « activités rentables » (typiquement la chirurgie ambulatoire) afin d’éviter le dépôt de bilan, alors que l’hôpital ne choisit pas ses activités. En revanche, l’hôpital ne peut pas faire faillite même si sa gestion défectueuse peut l’amener à être placé sous tutelle financière. Ainsi s’opère de fait un tri des patients, laissant aux établissements publics, les patients polypathologiques, âgés, dépendants, ceux ayant des pathologies graves ou complexes, ceux nécessitant des soins très coûteux, brefs ceux qui ne sont pas « rentables ». On distingue ainsi les patients « clinicables » (c’est-à-dire transférables en établissement privé) et les patients « non clinicables ». Cette division implique que l’hôpital public ne soit pas géré comme une clinique commerciale et que les praticiens recrutés par concours bénéficient d’un statut public garantissant leur autonomie par rapport aux gestionnaires, au service des patients. Pour autant, elle n’implique pas que l’hôpital public soit géré par une administration bureaucratique, coupée de la réalité du soin.
En effet le grand paradoxe des réformes de l’hôpital mises en place depuis dix ans est d’associer une gestion marchande cherchant à vendre des séjours (T2A) à une contrainte budgétaire cumulative et à une inflation de règlements administratifs. Pour respecter l’Ondam voté par le Parlement, chaque année les gouvernements baissaient les tarifs de remboursement de la T2A. Ainsi, pour essayer de maintenir l’équilibre financier, les hôpitaux publics devaient en faire toujours plus sans augmenter les coûts, tout en respectant les normes. Résultats : une augmentation de l’activité de 15 % en dix ans avec seulement une augmentation de personnel de 2 % et en réalité une diminution relative des personnels soignants par rapport aux administratifs, un investissement en berne et 50 % des hôpitaux en déficit.
La pandémie a montré l’importance de la coordination entre les hôpitaux et la médecine de ville. Le SPHSSR doit être combiné avec le service public de médecine de proximité, afin de réaliser ensemble des projets territoriaux de santé.
Elle a aussi démontré une nouvelle fois que l’organisation de l’hôpital doit évoluer vers plus de simplicité, de démocratie, d’efficacité et de modernité :
2.3.1. La hiérarchie hospitalière doit être repensée. La cellule de base de l’hôpital est le service ou l’unité de soin et non les structures de gestion. Les services doivent être gérés comme des collectifs interprofessionnels à la fois solidaires et créatifs, respectueux de chaque professionnel.
Le projet médical du service doit être construit et adopté par l’ensemble de l’équipe médicale et paramédicale et validé par les commissions médicale et paramédicale de l’établissement. Le choix du responsable médical doit se faire sur des qualités professionnelles mais aussi sur ses qualités relationnelles et sa compétence dans l’animation de l’équipe médicale et paramédicale, en binôme avec le cadre de santé. Il n’est donc pas indispensable, dans un CHU, d’avoir un statut universitaire pour être chef de service. Le nombre de mandats quinquennaux devrait être limité à deux ou trois. Les services peuvent se regrouper à leur demande, sans obligation, pour créer des fédérations de services ou des départements sur la base d’objectifs de soin ou de recherche communs. Les structures de mutualisation et de gestion qui n’ont pas démontré leur utilité pour les soins ou la recherche, ce qui est le cas de pôles à la fois gros et hétérogènes ne correspondant pas à des activités transversales, doivent être supprimées. Il faut alléger le millefeuille bureaucratique. Les médecins responsables de structures de gestion maintenues doivent être élus par l’ensemble des médecins relevant de la structure, avec un seul mandat. De même, l’ensemble des emplois administratifs doit être réévalué en fonction de leur utilité au service du soin, des patients et des soignants.
2.3.2. Il faut définir pour chaque unité de soins, comme on le fait déjà pour la réanimation et les soins intensifs, le quota de personnels nécessaires, c’est-à-dire présents réellement, pour assurer la sécurité des patients et la qualité des soins. Ces quotas doivent donc prendre en compte la charge de travail évaluée avec les personnels par le binôme responsable médical et paramédical du secteur, à partir de normes internationales et de comparaison nationales entre établissements. Une souplesse d’organisation des temps de travail doit être accordée pour coller au mieux à l’activité avec l’accord des personnels. Les quotients de calcul d’effectifs doivent tenir compte des jours de repos autorisés, des jours de formation, et de l’absentéisme moyen. Les équipes de suppléance doivent être en nombre suffisant pour pallier l’absentéisme pour éviter le recours à l’intérim coûteux et parfois délétère.
2.3.3. Les équipes soignantes doivent être encadrées au plus proche des patients par des cadres de santé qu’on devrait nommer « responsables paramédicaux d’équipe de soin ». Ces cadres de santé, ayant la responsabilité d’une vingtaine de paramédicaux, devraient pouvoir se consacrer à leurs missions essentielles : proposer des organisations efficaces, faciliter le travail d’équipe et la communication, évaluer les compétences, organiser les formations, participer à la veille documentaire et à l’élaboration de projets de recherche, promouvoir les carrières… Leur nombre a été considérablement réduit et leur temps absorbé par des tâches chronophages sans plus-value pour le soin (planning et renseignements d’activité…) à la suite de la mise en place de la « gouvernance d’entreprise » par la loi Hôpital, patient, santé, territoire (HPST), au profit de cadres gestionnaires dits « transversaux » dont l’utilité devrait être réévaluée.
2.3.4. Les services reposent sur la présence d’un personnel formé et stable donc correctement rémunéré. Si l’on veut garder le personnel, mobilisé pendant la crise, il faut annoncer un plan de rattrapage des salaires pour atteindre la moyenne des pays de l’OCDE et pas seulement des primes ciblées. La prime « récompense » une activité particulière ou exceptionnelle, alors que le salaire reconnaît la valeur du métier. Cette revalorisation salariale doit concerner non seulement l’ensemble du personnel hospitalier non médical (personnels paramédicaux, secrétaires, assistantes sociales…) mais aussi les étudiants hospitaliers, les internes et les jeunes médecins. Les primes doivent être intégrées au calcul des pensions. Il faut que la pénibilité des métiers de soignants (agent hospitalier, aide-soignant, infirmier) soit reconnue pour leur retraite. La mobilisation des soignants contre l’épidémie du Covid-19 est l’occasion d’intégrer à la fonction publique hospitalière les personnels paramédicaux et médicaux au statut précaire, en particulier les médecins à diplôme étranger, sur la base de leurs états de service.
2.3.5. L’activité médicale privée au sein des hôpitaux publics doit être mise en extinction pour les nouvelles générations, parallèlement à une révision des rémunérations pour éviter des différences injustifiées avec les rémunérations des médecins travaillant dans les Espic et à une intégration des primes et indemnités dans le calcul des retraites.
2.3.6. Il faut développer le nombre d’infirmières cliniciennes dites de pratique avancées (IPA) sur la base de la validation des acquis de l’expérience avec une revalorisation financière significative.
2.3.7. La prise en charge des maladies rares a bénéficié de la mise en place des « Plans maladies rares ». L’organisation en centres de référence et de compétence sur l’ensemble du territoire doit être poursuivie. Leur financement dédié doit être pérenne et sécurisé sur plusieurs années.
2.3.8. Il manque des lits dédiés pour l’aval des urgences. Pour accueillir les urgences, il faut avoir en permanence des lits vides, contrairement à l’injonction d’une occupation proche de 100 % dont le Covid-19 a démontré l’ineptie. En effet, selon le principe de la T2A, « un lit vide est un lit qui coûte mais ne rapporte pas », comme si on ne payait les pompiers que quand il y a le feu ! Il faut rouvrir des lits partout où cela se révèle nécessaire et revoir impérativement les projets de constructions hospitalières basés sur le dogme de la réduction des lits (« moins 30 % »). Pour éviter la désorganisation qui sévit depuis des années à l’hôpital, avec ses reports d’opérations chirurgicales et la déprogrammation des soins, il faut distinguer la filière des patients admis en urgence et la filière des soins programmés. Les patients suivis pour des affections chroniques dans des services hospitaliers doivent bénéficier, en cas d’urgences relevant de ces services, d’une admission directe sans passer par le service des urgences.
2.3.9. Il manque aussi des lits pour l’aval des soins aigus spécialisés pour les personnes ne pouvant pas poursuivre leurs soins à domicile. Des milliers de patients restent hospitalisés plusieurs jours en service de soins aigus coûteux faute de place en centres de soins de suite et réadaptation (SSR) ou en raison de conditions financières (coût du forfait hôtelier) inadaptées aux patients. La crise du Covid-19 a montré l’utilité de services de soins de suite spécialisés au sein même des hôpitaux. Et il faut développer l’aval des SSR quand la personne ne peut pas retourner à son domicile.
2.3.10. Il manque, pour assurer la prise en charge globale des patients, des équipes mobiles de gériatrie, de psychiatrie et de spécialités traitant les pathologies chroniques les plus fréquentes.
2.3.11. Il manque des unités de gériatrie aiguë postopératoire permettant, grâce à des soins adaptés, d’éviter des hospitalisations prolongées avec leurs effets secondaires délétères.
2.3.12. Il manque des chambres individuelles qui devraient être la norme, sans surcoût financier pour le patient, contrairement à la pratique commerciale actuelle de surfacturation.
2.3.13. La coordination structurée avec la ville et les soins de suite doit être assurée prioritairement par des infirmières de coordination et par des personnels médicaux et paramédicaux partagés entre l’hôpital et des maisons médicales ou des centres de santé, dans le cadre du service public. Chaque patient doit sortir de l’hôpital avec un bref résumé de séjour hospitalier comportant les changements de traitement. Et chaque médecin traitant devrait disposer d’un numéro de téléphone portable spécialement dédié d’un médecin hospitalier senior, afin de pouvoir joindre directement chaque service des établissements situés sur son territoire.
2.3.14. La direction hospitalière doit être revue, incorporant aux instances de décision les soignants (médicaux et paramédicaux) et impliquant les usagers.
Le directeur médical élu par la commission médicale est en charge de l’élaboration projet médical s’inscrivant dans un projet de santé territorial, partagé par l’ensemble des acteurs.
Le directeur administratif nommé est en charge de sa mise en œuvre dans le cadre des moyens alloués.
Les directeurs des soins doivent être les garants au sein de la direction de la cohérence entre le projet de santé de l’établissement et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences nécessaires pour assurer la qualité des conditions de travail, élément déterminant pour la qualité des soins.
Les représentants des usagers doivent être associés aux diverses instances de l’hôpital ; ils ont un rôle essentiel à jouer dans l’évaluation de la qualité de l’accueil, de la relation soignant/soigné et de la coordination ville/hôpital.
Les indicateurs d’attractivité d’un établissement et de ses services devraient être surveillés (turn over, absentéisme, accidents du travail, mesure de la satisfaction au travail et de l’implication des soignants médicaux et paramédicaux dans les décisions) et donner lieu si nécessaire à des actions correctives.
2.3.15. La T2A n’est pas adaptée aux urgences, à la réanimation, aux pathologies complexes, aux maladies chroniques et aux soins palliatifs. Elle doit être remise à sa place, c’est-à-dire limitée aux activités programmées standardisées, comme la chirurgie ambulatoire, correspondant à des activités assez facilement mesurables avec peu de fluctuations. Encore faut-il que les tarifs soient stabilisés.
Il y a fondamentalement trois modes de financement possible des activités hospitalières – le prix de journée, la dotation budgétaire et le paiement à l’activité – avec des adaptations (ainsi le paiement forfaitaire au séjour hospitalier de la T2A peut s’étendre au paiement forfaitaire pour une période de soins). Chaque mode a des avantages et des inconvénients et doit bénéficier d’un mode de régulation spécifique. La France a utilisé les trois modes successivement, il faut désormais les utiliser conjointement en déterminant avec les professionnels, et pas sans eux, les modes les plus adaptés à leur activité (par exemple, le prix de journée est le plus adapté aux soins palliatifs dans la mesure où il s’agit de prescrire des traitements contre la douleur, de prodiguer des soins de confort et d’assurer une présence humaine). Un budget annuel adapté aux besoins permet sa cogestion entre l’administration et les soignants. Il ne s’agit pas de revenir au « budget global » d’autrefois qui figeait les situations et ne prenait pas en compte l’évolution de l’activité. La dotation annuelle doit porter sur le budget de fonctionnement des services concernés sans inclure les investissements, les coûts d’entretien et de modernisation des infrastructures, ni le financement dit « en sus » pour les traitements innovants et coûteux. Calculée initialement à partir des budgets actuels corrigés (compte tenu des 8 milliards d’économie imposés à l’hôpital depuis dix ans), la dotation devra être modulée d’une année sur l’autre en fonction de critères simples et robustes de l’évolution de l’activité (file active, nombre de nouveaux patients, graduation de la gravité ou de la complexité thérapeutique en trois ou quatre niveaux, degré de précarité de la population prise en charge).
Il faut enfin mettre fin à la recherche actuelle absurde de maximisation de la facture adressée par les hôpitaux à la Sécurité sociale suscitant contrôles, pénalités, contestations… la marchandisation induite par la T2A renforçant la bureaucratisation.
2.4. Il faut reconstruire le secteur public de la psychiatrie ville-hôpital qui a besoin d’un système dédié pour assurer l’accueil, le diagnostic et le suivi des malades mentaux au plus près de leur lieu de vie et de leur entourage familial, en intégrant la dimension sociale.
2.4.1. Son budget doit être assuré par une progression de la dotation annuelle dédiée au moins égale à celle du secteur MCO (médecine-chirurgie-obstétrique) après un plan de rattrapage rendu indispensable par les années de sous-dotation.
2.4.2. Des projets territoriaux de santé mentale doivent être élaborés pour combler les défaillances de l’accès aux soins et de la réinsertion psychosociale avec un pilotage opérationnel appuyé sur des conseils locaux de santé mentale ayant des missions et des moyens de fonctionnement clairement établis. L’organisation des soins en secteurs doit assurer la triple activité de prévention, de suivi et de postcure afin de permettre la cohérence et la continuité des parcours entre le premier recours généraliste et les urgences, les soins spécialisés et les actions de réinsertion sociale.
2.4.3. L’ouverture de plages d’hébergement en structures médico-sociales et autres lieux de vie adaptés (foyers de postcure, foyers d’accueil médicalisés, appartements thérapeutiques et sociaux, maisons communautaires avec maintien de l’ouverture vers la cité) est un objectif majeur pour que cesse le scandale des dizaines de milliers de patients – adultes et enfants – laissés sans soins, dans une errance délétère ou accueillis par défaut dans des services hospitaliers inadaptés ou des hôtels sociaux suroccupés, parfois abandonnés à la rue (ou au système carcéral) ou encore transférés en Belgique loin de leurs familles ou de leurs proches.
2.4.4. Il faut réaffirmer la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire par rapport à un territoire en renforçant les liens entre professionnels y compris avec ceux des autres champs de la santé et des secteurs médico-social et social, les élus locaux et les collectifs d’usagers.
Le service public de psychiatrie et le service de la médecine de proximité devront organiser conjointement l’accès des malades souffrant de maladies mentales à des soins somatiques. La mortalité prématurée est en effet quatre fois plus importante chez ces patients que dans la population générale, en particulier en raison de la fréquence accrue des maladies cardio-vasculaires et des cancers.
2.4.5. Pour faire face à la forte baisse de la démographie médicale en psychiatrie, il convient d’accroître le nombre d’étudiants formés en psychiatrie, tout particulièrement pour le suivi des enfants et des adolescents, et de s’appuyer sur les compétences des professionnels issus de disciplines liées aux soins psychiatriques (psychologues cliniciens, psychomotriciens, ergothérapeutes, infirmiers spécialisés, assistants sociaux, orthophonistes, etc.). Le remboursement de prises en charge, effectuées par ces professionnels en ville est un impératif de même que la revalorisation des salaires de psychologues hospitaliers.
2.5. La « gouvernance » du service public du soin et de la prévention. Cette gouvernance suppose une planification sanitaire nationale et régionale. Il faut évaluer pour chaque territoire les besoins des populations et pour y répondre, organiser la coordination avec la médecine de ville, et la complémentarité entre les hôpitaux publics et les établissements de santé privés d’intérêt collectif (Espic) et ceux du secteur privé à but lucratif. La complémentarité contractuelle entre établissements doit se faire dans le respect du principe de l’accès aux soins aux tarifs remboursés par la Sécurité sociale. Elle doit remplacer la concurrence actuelle pour se disputer « les parts de marché ». Il faut donc veiller à l’absence de distorsion injustifiée entre les rémunérations des professionnels, à compétence identique et à travail égal. Il faut mettre fin au « mercato » entre les établissements pour l’embauche des médecins et des paramédicaux spécialisés, « rentables » (l’orthopédiste, l’anesthésiste, le cardiologue interventionnel ou le manipulateur radio…). L’intéressement financier individuel des personnels soignants, médecins ou paramédicaux, aux bénéfices éventuels de l’établissement, institue un conflit d’intérêts incitant au développement d’activités « rentables ». Il devrait être interdit.
Les restructurations/regroupements des établissements doivent répondre à des règles transparentes prenant en compte :
– la répartition sur le territoire national, selon les besoins variables et les caractéristiques des populations résidentes (âge, précarité sociale…) et en fonction des pathologies et des activités médicales (de la maternité et des centres d’IVG, à la dialyse rénale et à la greffe d’organe en passant par l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral) ;
– leur place dans la planification sanitaire régionale, et leur rôle au niveau du territoire de santé ;
– la cohérence du projet médical de chaque établissement.
Il convient de faire un bilan critique des Groupements hospitaliers de territoires (GHT) du point de vue, d’une part, de la coordination souhaitable pour les soins, la formation et la recherche et, d’autre part, de l’empilement des strates administratives produisant une gouvernance hors sol.
Les regroupements de services ne doivent pas avoir pour finalité première la réduction des moyens mais le projet de santé, et ils supposent une gouvernance moderne avec une alternance des responsabilités dans l’animation des équipes regroupées.
De même, il faut organiser avec les professionnels, les usagers et les collectivités territoriales une graduation régionale des activités entre les différents services d’urgence.
Tout projet de restructuration élaboré par les ARS doit préalablement être soumis aux collectivités territoriales concernées et en cas de désaccord faire l’objet d’un débat citoyen.
Les responsabilités propres, des régions, des départements, des intercommunalités et des communes en matière de santé doivent être redéfinies, notamment en ce qui concerne la prévention, l’accès aux soins et la lutte contre les inégalités sociales de santé.
3. Le service de la santé publique et de la sécurité sanitaire
Il sera évidemment impératif de tirer toutes les leçons de la gestion de la crise du Covid-19.
D’ores et déjà, il importe de réaffirmer que la gestion des crises sanitaires doit s’appuyer sur les compétences des agences de l’État. C’est en effet à elles qu’il appartient de créer, en cas de crise, des comités scientifiques ad hoc sur lesquels peut s’appuyer le gouvernement. Les scientifiques doivent émettre des avis comportant chaque fois que nécessaire différentes propositions avec une évaluation des avantages et inconvénients de chacune, permettant ainsi au pouvoir politique de trancher. Les différentes options doivent être portées à la connaissance des citoyens. La confiance dans l’intelligence collective doit remplacer le pédagogisme paternaliste. Les difficultés doivent être expliquées et les erreurs éventuelles reconnues (voir le changement du discours gouvernemental sur l’utilité des masques et des tests en fonction leur disponibilité) pour susciter la confiance et l’adhésion de la population. En dehors des périodes de crises, ces agences doivent s’assurer de l’état des stocks de sécurité des équipements stratégiques et de la fonctionnalité et de la pertinence des plans à déclencher en cas de crise. L’état des stocks d’équipements stratégiques doit faire l’objet d’un vote annuel au Parlement.
Le dispositif actuel de santé publique et de sécurité sanitaire repose sur un ministère de la Santé qui s’appuie sur les Agences régionales de santé (ARS) et de diverses agences sanitaires : Santé publique France (SpF), Agence du médicament et des produits de santé (ANSM), Agence de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail (ANSES), Établissement français du sang (EFS) et Agence de biomédecine (ABM) s’occupant des greffes, de la PMA et des tests génétiques, auxquels il faut ajouter la Haute Autorité de Santé (HAS) responsable des recommandations de bonne pratique, de la certification des établissements et de l’évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes en vue de leur remboursement.
Le ministère de la Santé est lui-même un millefeuille administratif avec ses cinq directions générales et un secrétariat général. Il est soumis aux décisions du ministère du Budget et des Comptes publics, devenu de facto véritables décideurs de la politique de santé. Les ARS sont essentiellement des structures administratives de gestion sur fond de regroupement d’établissements et de réduction des moyens : la santé publique est passée au second plan.
Au vu de la gestion de la pandémie, la division du travail entre le ministère assurant décision et stratégie et les agences assurant veille et expertise, doit être revue. Le service de santé publique et de sécurité sanitaire devrait reposer sur une direction générale unique au ministère, chef d’orchestre des directions du ministère des agences sanitaires et des ARS, avec :
3.1. Une réforme des ARS selon deux principes : 1) La priorité doit être donnée à la santé publique en région et non à la gestion budgétaire. 2) Il faut renforcer la démocratie sanitaire en région. Les ARS ont deux missions : d’une part, la régulation de l’offre de soin selon les principes d’égalité d’accès aux soins, de graduation de l’offre de soins et de complémentarité des établissements, d’autre part, la santé publique.
L’ARS met en œuvre la stratégie nationale de santé et le Projet régional de santé (PRS) d’une durée de cinq ans.
La Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA), représentant l’ensemble des acteurs de santé (usagers, professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux, établissements…), réalise à mi-mandat un état des lieux de la santé en région et élabore ses propositions d’évolution de la politique de santé régionale, soumises à la région et à l’ARS.
De plus, chaque année, l’ARS doit soumettre son programme annuel régional au débat et au vote indicatif de la Conférence régionale de santé et de l’autonomie ainsi qu’au conseil régional, avant son adoption définitive. Sur des sujets de santé importants pour les populations, la conférence régionale de santé et de l’autonomie peut proposer aux collectivités territoriales d’organiser des consultations citoyennes.
3.2. L’octroi de compétences en santé publique aux collectivités territoriales. Il faut mettre un terme à la logique technocratique toujours plus centralisatrice dont on a vu les limites lors de la gestion de la pandémie, et donner toute leur place aux collectivités territoriales, en particulier les régions, les conseils départementaux, les communautés de communes et les municipalités, en leur fixant des missions de santé afin de décliner la santé dans toutes les politiques et de pouvoir agir au plus près des populations. Les décisions en matière de santé prises par les collectivités territoriales pour répondre à des besoins spécifiques, doivent être financées et être cohérentes avec le projet régional de santé. Cette démocratisation de la gestion régionale de la santé au plus près des populations ne remet en cause ni la déconcentration des services de l’État, ni la solidarité nationale exprimée par le service public de l’assurance-maladie, ni le nécessaire rôle des préfets dans la gestion de crise sanitaire épidémique.
3.3. Une révision des périmètres et des missions des différentes agences en particulier de l’HAS. L’HAS doit revenir à ses missions d’évaluation des pratiques professionnelles. Quelles sont les améliorations souhaitables et réalisables des prises en charge par rapport aux recommandations basées sur les données scientifiques ? À défaut de données probantes dans la littérature, elle doit organiser des conférences précisant les points qui font consensus et les points qui restent en débat.
Les modalités de l’accréditation à la fois bureaucratique et infantilisante pour les professionnels doivent être révisées, allégées et restreintes aux objectifs de santé publique. Leur but est d’aider les établissements et les professionnels à s’améliorer en partant des besoins exprimés localement par les professionnels et les usagers, et en s’appuyant sur les autoévaluations réalisées par les établissements de santé.
3.4. Un développement du dossier médical partagé (DMP). Il devrait permettre, au-delà de l’amélioration de la qualité des soins, la constitution de base de données de médecine de ville (diagnostics, résultats d’examens complémentaires…), complétant les bases de données hospitalières (le PMSI) et de la Sécurité sociale (le SNIIRAM). Le recoupement des données fournies par ces différentes bases dans le Système national des données de santé (SNDS), permettra d’améliorer les études de santé publique et de mieux évaluer les résultats des politiques de santé. Les bases de données doivent être sécurisées, stockées sur le territoire national et rester gérées par des établissements publics et non par des entreprises privées.
3.5. Un accroissement des moyens consacrés à la prévention. Ils doivent être portés de 6,2 à 10 % du budget des dépenses de santé. Les efforts doivent porter :
– sur les déterminants de santé (tabac, alcool, nutrition, santé sexuelle, santé mentale, conditions de vie et de travail…) ;
– sur la prévention des maladies non transmissibles : obésité, hypertension artérielle, dyslipidémie, diabète, cancers et santé mentale. Il faut en particulier promouvoir une activité physique quotidienne, dès le plus jeune âge ;
– sur le développement de la prévention du risque environnemental, y compris professionnel. Les cibles sont multiples : pollutions physiques, chimiques et microbiologiques (air, sol, eau), expositions professionnelles, changement climatique. Pour ce faire, des études épidémiologiques et sociologiques d’exposition aux risques et de surveillance de certaines pathologies sont indispensables.
Quant aux services de santé au travail, dont le rôle a été fortement réduit lors des quinquennats précédents, leur importance est soulignée par la crise sanitaire actuelle. Ils doivent développer au-delà des visites médicales individuelles, des approches populationnelles, y compris sur les risques émergents (nanomatériaux et perturbateurs endocriniens).
Une politique de prévention suppose :
– un réel pilotage régional de santé publique par les ARS rénovées dont les professionnels, médecins ou non médecins, doivent être des professionnels compétents en santé publique ;
– l’attribution de compétences en santé aux collectivités territoriales ;
– l’inscription de la santé dans toutes les politiques (éducation, ville, logement, alimentation, agriculture, transports, sport, écologie, égalité des genres…) ;
– l’implication des citoyens et des associations dans une logique de démocratie participative ;
– une politique d’éducation à la santé et de prévention reposant sur l’éducation à l’école et les lieux de travail, l’information des consommateurs ;
– la lutte contre les inégalités sociales et territoriales avec un soutien renforcé aux services de prévention (santé au travail, PMI, santé scolaire). L’épidémie de Covid-19 et le confinement ont considérablement aggravé les inégalités sociales touchant les populations les plus vulnérables (habitants des banlieues paupérisées, sans papiers, migrants, SDF, personnes incarcérées…) en raison de leurs conditions de vie (travail, habitation, transports…) ainsi qu’en raison de la fréquence accrue des comorbidités dans ces populations. Pour des raisons à la fois humanitaire, de santé publique et finalement de gain financier, il faut inclure les personnes en précarité dans la Protection universelle maladie (PUMA) et intégrer l’Aide médicale d’État (AME) dans le régime général de la Sécurité sociale. Une politique volontariste doit porter sur les déterminants sociaux de la santé (revenus, éducation, conditions de vie et de travail) et impliquer des médiateurs sociaux proches des populations. Elle permettrait de réduire « le gradient social de santé » avec treize années d’écart d’espérance de vie entre les populations les plus aisées et les plus pauvres ;
– le renforcement de la prévention en utilisant la fiscalité comportementale, par exemple une taxe sur l’alcool et les boissons sucrées comme on le fait pour le tabac (et non la pratique assurantielle du bonus/malus individuel) ;
– la lutte contre les discriminations d’accès aux soins dont sont victimes les personnes bénéficiant de la CMU ou de l’AME.
3.6. Le développement d’un pôle de production industrielle de la santé à but non lucratif. La pandémie du Covid-19 a montré la nécessité d’une production industrielle à but non lucratif nationale et européenne de Médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) passés dans le domaine public et de l’ensemble des dispositifs médicaux nécessaires à la sécurité des patients et des soignants. En effet, l’épidémie a été l’occasion d’une pénurie de matériels de protection et de médicaments nécessaires à l’anesthésie-réanimation. Cette pénurie était certes liée à une augmentation brutale des besoins à l’échelle mondiale, mais elle était aussi le résultat d’une politique ancienne visant à optimiser les chaînes de valeurs et à sacrifier la sécurité au profit à court terme. Ces pénuries de MITM, dues à des ruptures de production et d’approvisionnement, préexistaient à la crise et se sont multipliées depuis une dizaine d’années, concernant des médicaments passés dans le domaine public de toutes spécialités (anticancéreux, antibiotiques, antihypertenseurs, corticoïdes, vaccins…). L’industrie pharmaceutique, pas intéressée par ces produits anciens peu onéreux et donc pas assez rentables, a fait le choix, afin de maintenir une bonne rentabilité de délocaliser 80 % de la production des principes actifs en Chine et en Inde, et de confier la fabrication du produit fini à des sous-traitants avec une production à flux tendu. Il convient :
– d’imposer immédiatement la constitution de stocks correspondant à au moins six mois de consommation standard. Ces stocks doivent être gérés par les industriels détenteurs des Autorisations de mise sur le marché (AMM) ;
– de relocaliser la production des principes actifs en France et en Europe ;
– de créer un établissement public national produisant avec l’aide des laboratoires de la chimie et des façonniers nationaux des MITM à prix coûtant. Une collaboration entre pays européens devrait permettre de couvrir l’ensemble du champ des MITM.
3.7 La mise en œuvre du principe de transparence dans la politique de prix des médicaments sous licence et des dispositifs médicaux.
Les innovations thérapeutiques dont les prix explosent, voire sont totalement déconnectés des dépenses engagées par les industriels pour la recherche, le développement et la production.
Il convient notamment :
– de fixer pour des médicaments vitaux innovants, un prix public permettant un accès universel en recourant si besoin à la clause de la licence d’office (autorisant un pays à faire fabriquer un médicament sous licence à un prix adapté à ses moyens). La pandémie du Covid-19 devrait entraîner une suppression de tout monopole concernant l’ensemble des dispositifs et traitements : des masques aux tests, en passant par les vaccins et par les médicaments actifs contre le virus et contre l’« orage » cytokinique ;
– d’imposer aux industriels la transparence des coûts de recherche, développement et production, ce qui suppose d’assurer la traçabilité des financements publics et privés tout au long du circuit de recherche, développement et production des produits de santé ;
– de mettre en place une clause du « juste prix » lors des négociations entre unités de recherche publiques et industriels pour le développement de nouveaux médicaments et d’exiger le respect rigoureux des critères de brevetabilité des inventions en santé quand les conditions de santé publique l’exigent ;
– d’exiger la transparence et la publicité dans les négociations au niveau du comité économique des produits de santé (CEPS) ;
– de faire financer par l’industrie pharmaceutique, une évaluation post-AMM conduite par des structures publiques indépendantes contrôlant en « vraie vie » l’efficacité et la sécurité des traitements, grâce à l’utilisation des bases de données médico-administratives et de l’intelligence artificielle ;
– de poursuivre l’encadrement des liens et des conflits d’intérêts multiples des professionnels de santé mais aussi des autres professionnels concernés (économistes, gestionnaires, journalistes, éditeurs…) et des élus.
Il convient en effet de rétablir la confiance des citoyens dans notre système de santé érodé par les scandales sanitaires, l’absence de transparence dans la détermination des prix des médicaments et des dispositifs médicaux, les profits records reversés par l’industrie à ses actionnaires, les conflits d’intérêts… Cette perte de confiance favorise l’audience des propagateurs de fake news et des faux lanceurs d’alerte. Elle suscite la défiance à l’égard des experts et explique le rejet de soins dont l’efficacité et la sécurité sont amplement démontées comme les vaccinations, à l’heure même où le monde entier attend une vaccination efficace contre le Covid-19.
Cette politique devrait être défendue par la France au niveau européen pour obtenir si ce n’est un assentiment unanime, du moins l’accord de plusieurs pays, pour peser face aux entreprises pharmaceutiques multinationales.
4. Le service public de l’enseignement de la formation continue
4.1. L’entrée dans les études médicales doit se faire à partir des différentes filières universitaires et des écoles d’ingénieurs et non plus par une première année spécifique à la santé. Une passerelle permettra aux infirmiers(ères) de pratique avancée de rejoindre le cursus médical.
L’évaluation du nombre d’étudiants à admettre dans les études de santé, devrait être déterminée sur la base d’une prospective à dix ans des besoins, réalisée par des professionnels de santé, des démographes et des épidémiologistes puis publiquement discutée. L’adoption de cette évaluation devrait entraîner l’octroi aux universités de moyens d’accueil et de formation en adéquation.
4.2. La formation doit comprendre en alternance des périodes d’enseignement théorique et des stages cliniques à plein temps. Il faut développer au sein des universités, une filière dédiée à la recherche parallèlement au cursus médical.
4.3. Le programme des deux premiers cycles des études de médecine (avant l’internat de spécialité) doit être orienté vers la formation générale de médecins cliniciens indépendamment de leur spécialité, donnant une place particulière aux disciplines transversales comme la psychologie et les soins palliatifs. Il faut donc que les enseignants de médecine générale et d’autres spécialités collaborent pour fixer ensemble les connaissances et les compétences à acquérir pour chaque enseignement et non chacun pour sa spécialité. Les évaluations des étudiants doivent correspondre à ces objectifs partagés entre les différents collèges d’enseignants.
4.4. La pédagogie doit inclure, l’apprentissage à la résolution de problèmes ainsi qu’à la relation soignant/soigné, au travail d’équipe pluriprofessionnelle et à la collaboration pluridisciplinaire. Elle doit utiliser les outils de simulation. La formation au cours des études de médecine et de l’internat inclut les concepts de médecine basée sur les preuves et la lecture critique de l’information médicale au-delà de la critique de la littérature médicale scientifique. Elle doit évoluer pour intégrer la compréhension et l’usage des nouvelles technologies (apport de l’intelligence artificielle et du traitement des données massives de santé au développement de la médecine de précision, télémédecine, robotique, santé environnementale…) et l’enseignement des sciences humaines (économie de la santé, anthropologie, sociologie, politique de santé, éthique et philosophie). Les médecins cliniciens appelés à suivre des patients atteints de maladies chroniques doivent être formés à la médecine narrative et à l’éducation thérapeutique des patients dans un cadre pluriprofessionnel.
4.5. Il faut revoir la formation et la sélection des enseignants en découplant en partie les carrières de l’enseignement, de la recherche et du soin. Les médecins cliniciens doivent pouvoir être enseignants et rémunérés comme tels, même si leur activité de recherche est limitée. Inversement, des médecins chercheurs enseignants peuvent avoir une activité clinique limitée. L’ensemble des rémunérations pour ces différentes activités devrait être inclus pour le calcul de la retraite. Il faut assurer la parité homme/femme dans tous les parcours professionnels, y compris dans les carrières universitaires.
4.6. La formation en soins infirmiers et paramédicaux vise à développer les compétences techniques spécifiques mais aussi les compétences relationnelles, en éducation thérapeutique du patient, en santé publique, en recherche clinique et l’aptitude au travail en équipe. L’universitarisation des métiers du soin suppose de transformer les facultés de médecine en faculté de santé où l’ensemble des étudiants paramédicaux suivraient leur cursus initial et partageraient certaines unités d’enseignement avec les étudiants en médecine. Il devient en effet impératif de considérer les professions de soins à la personne comme un ensemble. Se former ensemble est un levier majeur pour travailler ensemble.
Certaines facultés de médecine vont dans ce sens en créant des Départements universitaires en soins infirmiers et rééducation (DUSIR) et en décloisonnant les différents cursus en accord avec le processus européen de Bologne (1999) intégrant les professions paramédicales dans la réforme LMD. La formation des infirmiers(ères) de grade licence doit se prolonger par les grades de master et doctorat débouchant sur diverses spécialisations de pratiques avancées dans l’ensemble des disciplines de la santé. Au-delà des spécialisations anciennes d’anesthésie, de bloc opératoire, de puéricultrice ou de cadre de santé, il convient de développer les spécialités de pédiatrie, néonatologie, gériatrie, diabétologie, psychiatrie,
soins intensifs, urgences, oncologie, soins palliatifs, traitement de la douleur, éducation thérapeutique, santé publique, management, coordination, enseignement, recherche…
D’ici la mise en place de cette nouvelle approche, il est nécessaire de reconnaître et de valoriser financièrement la Validation des Acquis professionnels et la Validation des Acquis de l’expérience.
4.7. La formation postuniversitaire validante doit impliquer les universités, les sociétés savantes et des organismes professionnels indépendants des industries de la santé. Elle devrait se dérouler préférentiellement sous la forme de séminaires théorico-pratiques centrés sur la clinique et travaillant en groupes interactifs. Aujourd’hui, les seules formations médicales postuniversitaires indépendantes de l’industrie sont les Diplômes universitaires (DU), le Développement professionnel continu (DPC) et le Fond d’assurance formation de la profession médicale (FAF-PM) financé par les cotisations des professionnels. Malgré des droits d’inscription élevés pour les étudiants, les DU reçoivent peu de soutien des universités et sont peu intégrés au DPC. Le dispositif DPC est réalisé par des organisations de statut variable, le plus souvent privées. Le système a montré ses limites, impliquant seulement 50 % des médecins, pour un nombre de journées de formation très insuffisant et ne débouchant pas sur un véritable processus de recertification. Le rapport Uzan sur la recertification (novembre 2018) a évalué à un minimum de quinze jours annuels la durée de formation nécessaire au processus de recertification. Malheureusement, le financement et les modalités pratiques d’une telle évolution sont au point mort. À côté de cela, de très nombreuses réunions d’enseignement postuniversitaires sont organisées avec le soutien financier et publicitaire plus ou moins intrusif des industries de la santé. Il en va de même de la participation des médecins à des congrès médicaux, en nombre excessif et dont le financement par l’industrie crée des liens de dépendance. Le financement doit passer par des structures de Formation médicale continue (FMC) indépendantes. Il faut donc mettre en œuvre une politique ambitieuse de formation médicale permanente incluant un processus de recertification pour la totalité des médecins. Cette politique devrait associer tous les acteurs : universités, hôpitaux publics, sociétés savantes, organismes professionnels au niveau local et national. Cet effort considérable doit être intégralement financé par un fonds public bénéficiant de la règle du 1 pour 1 (pour 1 euro consacré à la promotion de leurs produits les industriels doivent verser 1 euro au fonds public pour la formation postuniversitaire) ou à défaut par un pourcentage du montant des dividendes versés aux actionnaires.
5. Le service public de la recherche en santé
La recherche est une composante essentielle de la médecine non seulement parce que ses résultats contribuent à son progrès mais parce que sa pratique a une valeur formatrice. Son champ est vaste. Il va de la recherche fondamentale aux recherches en santé publique et en sciences humaines et sociales, en passant par les recherches translationnelles et cliniques. Une partie de cette recherche se développe dans le cadre de la triple mission historique des CHU mais celui-ci a peu évolué. La création en 1980 d’un corps de praticiens hospitaliers sans valence universitaire de recherche et d’enseignement a créé des disparités injustifiées. Et la loi HPST de 2009 a accordé une prérogative excessive à l’administration hospitalière. La recherche nécessite aujourd’hui un travail d’équipes pluridisciplinaires, des plateformes expérimentales, informatiques et cliniques bien structurées. La création d’instituts de recherche hospitalo-universitaires (IHU) de masse critique suffisante a été une avancée. Mais le financement public de la recherche en sciences de la vie est très insuffisant (2,5 milliards d’euros en 2019, moins qu’en 2018) avec en conséquence le bas niveau des salaires des chercheurs, ingénieurs et techniciens qui réduit l’attraction de la recherche française auprès des jeunes.
Il faut :
5.1. Augmenter significativement le budget de la recherche actuellement de 41 milliards soit 2,27 % du PIB, ce qui nous place en 10e position des pays de l’OCDE. Le budget de la recherche devrait être porté progressivement à 3 % du PIB et au moins 1 % devrait relever de la recherche publique. Pendant que le budget de la recherche a stagné en France, l’Allemagne l’a augmenté en quinze ans de 50 %. L’annonce par le Président de 5 milliards sur dix ans est insuffisante. Le montant devrait être au moins doublé (1 milliard par an) pour revaloriser les salaires des chercheurs au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE, mettre fin à des situations de précarité anormalement prolongées et accroître la part des dotations pérennes attribuées aux équipes de recherche. À noter qu’une fraction du crédit impôt recherche (plus de 6 milliards d’euros par an) souvent réduite à une forme de subvention déguisée aux entreprises, pourrait être utilisée à meilleur escient pour le soutien à la recherche publique.
5.2. Diminuer drastiquement le nombre de guichets d’attribution de crédits de recherche sur projet, préserver intégralement le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) et le rapprocher de l’Inserm pour créer un institut couvrant l’ensemble de la recherche médicale, en assurant une juste répartition entre les différents domaines de recherche, et en incluant la recherche en soins primaires et en soins infirmiers, aujourd’hui non financée.
5.3. Utiliser les crédits attribués à la recherche pour financer les équipes de recherche au sein des CHU et non pour combler le déficit des budgets hospitaliers.
5.4. Diminuer les strates administratives et simplifier les procédures pour la mise en place des projets de recherche. La pandémie de Covid-19 a montré que cela était réalisable. Il est primordial que cet acquis soit maintenu après la crise pour que la recherche ne soit pas étouffée par l’abus de réglementations. La rapidité des procédures ne doit cependant pas être contradictoire avec la qualité de sélections des études.
5.5. Impulser la recherche en santé publique et en prévention, parallèlement au renforcement de la discipline elle-même.
5.6. Renforcer le programme de formation en recherche des étudiants en médecine et en pharmacie en soutenant une filière recherche au cours des études.
5.7. Favoriser les activités de recherche des personnels soignants non médicaux notamment sur la relation de soins et promouvoir les postes de recherche (ou des valences recherche) pour des infirmiers(ères).
5.8. La triple mission classique des médecins hospitalo-universitaires – soin, enseignement, recherche – a toujours été impossible à remplir conjointement d’autant qu’à ces trois fonctions sont venues s’en ajouter deux autres : la gestion et la santé publique. Cela a été aggravé par le développement d’une bureaucratisation excessive à l’hôpital comme dans les institutions de recherche. En pratique chaque individu ne peut raisonnablement assurer que deux fonctions à la fois (les cinq fonctions ne sont assurées que par des équipes). Le déroulement des carrières de praticiens hospitaliers, leurs progressions et les émoluments doivent être révisés. La création de cinq valences doit permettre l’accomplissement de deux tâches prédominantes différentes au cours de la vie, gardant ouverte la possibilité d’éventuelles formations nécessaires à la réorientation professionnelle.
5.9. La « gouvernance » hospitalière reposant sur le trépied – soignants, usagers, gestionnaires – doit inclure dans les CHU les responsables de l’enseignement et de la recherche. Toutes les dimensions de la recherche au sein des CHU doivent impliquer l’université.
Des mesures immédiates doivent être prises pour que notre système de santé qui a fait face au premier assaut de la pandémie, puisse tenir dans la durée et que le jour d’après ne soit pas le retour à l’anormal du jour d’avant :
1. La gratuité intégrale des dispositifs de protection, de dépistage et de soins liés au Covid-19.
2. L’augmentation du prochain budget de la santé (Ondam) autant que nécessaire pour répondre aux besoins en ville et à l’hôpital et reconstruire la psychiatrie sinistrée.
3. La revalorisation des bas salaires des personnels travaillant à l’hôpital, en ville et en Ehpad, pour atteindre en trois ans le niveau moyen des revenus correspondants dans les pays de l’OCDE.
4. L’arrêt de la politique de fermeture de lits et l’annulation de leurs réductions programmées mais, au contraire, l’ouverture du nombre de lits hospitaliers pour répondre aux besoins, notamment pour l’aval des urgences et la réadaptation. L’embauche et la formation de personnels soignants pour assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
5. Le vote d’une loi de démocratie sanitaire formalisant l’association aux prises de décisions sur la santé des professionnels et des usagers, en plaçant la gestion au service du soin et de la prévention. Cette loi limitera la place de la T2A et révisera la « gouvernance d’entreprise » mise en place par la loi HPST.
Les mesures proposées sont pour certaines onéreuses et entraîneront une augmentation des dépenses de santé à laquelle concourent aussi l’allongement de la durée de vie et l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques. Des économies doivent et peuvent être faites notamment sur les frais de gestion, la pertinence des prescriptions et des actes, l’organisation graduée et coordonnée des soins. La lutte contre les prix excessifs des médicaments et des dispositifs médicaux innovants suppose une action concertée au niveau des pays européens et de l’OMS. Quoi qu’il en soit, il paraît indispensable que l’augmentation du coût de la santé, et en conséquence des recettes de la Sécurité sociale, fasse l’objet d’un débat démocratique pour que les décisions expriment le choix de la nation sur ses priorités de vie.
La rédaction de ce manifeste a été coordonnée par André Grimaldi, Olivier Milleron et François Bourdillon.
Ont participé à la rédaction collective :
André Baruchel, Alain Beaupin, Hakim Bécheur, Christian Bensimon, Francis Berenbaum, François Boué, François Bourdillon, Julie Bourmaleau, Michel Canis, Sophie Crozier, Sébastien Czernikow, Stéphane Dauger, Bruno Devergie, Alain Fischer, Alain Gaudric, Julien Gaudric, Anne Gervais, Yves Gervais, Nathalie Godard, André Grimaldi, Jean-Pierre Hugot, Hugo Huon, Paul Jacquin, Xavier Lecoutour, Évelyne Lenoble, Philippe Lévy, Anne-Marie Magnier, Dominique Méda, Didier Ménard, Olivier Milleron, Isabelle Montet, Bernard Odier, Fabienne Orsi, Antoine Pélissolo, Jean-Charles Piette, Carine Rolland, François Salachas, Rémi Salomon, Alfred Spira, Pierre Suesser, Juliana Veras, Jean-Paul Vernant…
En approuvent l’orientation en faveur du service public de santé avec ses 5 piliers et l’essentiel des propositions présentées : Catherine Adamsbaum, Pierre Amarenco, Fabrizio Andreelli, Emmanuel Andres, Isabelle Andreu, Daniel Annequin, Giséle Apter, Jean-Marc Baleyte, Thierry Baudet, Dominique Bégué, Chérine Benzouid, Étienne Bérard, Jean-François Bergmann, Hélène Bihan, Ségolène Billot, Philippe Bizouarn, Alexandre Blebtreu, Catherine Boileau, Olivier Bonnot, Philippe de Botton, Clara Bouché, Chistophe Bouché, Raphaël Briot, Éric Bruckert, Claire Carette, Simon Cattan, Éric Caumes, Lucy Chaillous, Jean-Marc Chabannes, Philippe Chanson, Céline Chauleur, Jean-Philippe Collet, Line Commery, Justine Corli, Julie Cosserat, Barbara Coué, Patrice Darmont, Sophie Demeret, Isabelle Desguerre, Alain Devidas, Camille Deybach, Brigitte Dormont, Olivier Drunat, Caroline Dubertret, Marion Duguet, Yves Dulac, Laurent Dupic, Jehan Dupuis, Anne Dutour, Gilles Edan, Fabienne Eymard, Bertrand Fontaine, Philippe Fossati, Irène Frachon, René Frydman, Vincent Gajdos, Nicolas Gaillard, François Godwaser, Philippe Grimbert, Philippe Guerci, Ghislaine Guillemet, Christian Guy-Coichard, Julien Haroche, Agnès Hartemann, Axel Hoffmann, Marie-Line Jacquemont, Sandra Janson, Guillaume Jondeau, Jean-Luc Jouve, Christine Katlama, Matthieu Lafaurie, Sandrine Lafille, Marie Lagrange, Étienne Larger, Joëlle Laugier, Thomas Laurent, Céline Laville, Vania Leclercq, Pierre Lecomte, Anne Léger, Claire Le Jeunne, Étienne Lengline, Pierre Lombrail, Sylvie Lotton, Catherine Lubetzki, Michèle Maestracci, Luc Mallet, Marion Malphettes, Xavier Mariette, Christophe Marguet, Paulette Morin, Joël Ménard, Marie Rose Moro, Alexis Mosca, Luc Mothon, Philippe Moulin, Israël Nisand, Michel Nonent, Philippe Nuss, Sylvia Oghina, Alex Pariente, Thomas Papo, Fabien
40
Paris, Marc Paulin, Alfred Penfornis, Antoinette Perlat, Georges Picherot, Florence Pinsard, Marie-Astrid Piquet, Oriane Plumet, Marc Popelier, Bernard Pradines, Vincent Rigalleau, Jean-Pierre Riveline, Gilberte Robain, Christophe Rodriguez, Benjamin Rohaut, Ronan Roussel, Philippe Rousselot, Caroline Sault, Jean Scheffer, Nicole Smolski, Antoine Tabarin, Mélanie Tessier, Bernard Teper, Laurent Thines, José Timsit, Jacques Trévidic, Christophe Trivalle, Magali Trouvé, Roland Tubiana, Laurent Vassal, Cécile Vigneau, Daniel Wallach, Jacques Young…
André Grimaldi est professeur émérite de diabétologie, CHU Pitié-Salpêtrière, Sorbonne Université.
Dernière parution chez Odile Jacob : Santé : urgence (2020)
1 La T2A a été instauré en 2004 puis généralisée en 2008, avec pour objectif initial de mettre en concurrence l’hôpital public avec les cliniques commerciales sur un pseudo-marché administré. En 2012, cet objectif a été officiellement abandonné. La T2A est devenue un outil de régulation du budget voté chaque année par le Parlement, en déconnectant les tarifs de la T2A (payés par la Sécurité sociale aux hôpitaux) des coûts réels avec l’application d’une règle prix/volume (quand l’activité augmente, les tarifs baissent).
2 Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de Sécurité sociale, instituée à compter d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité sociale donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application.
|