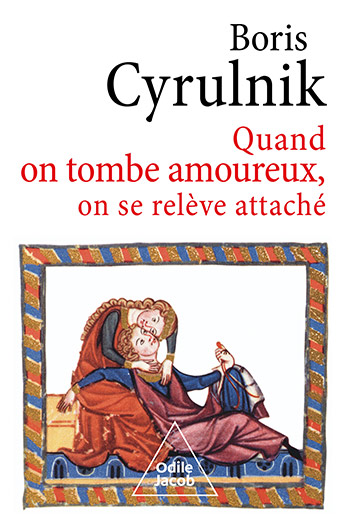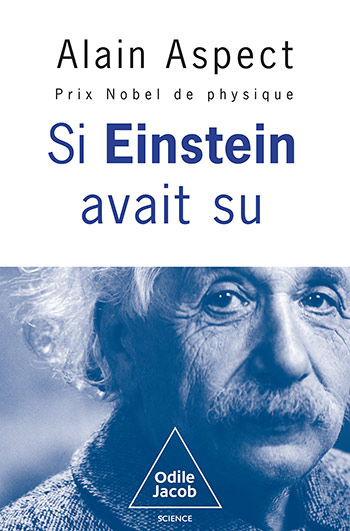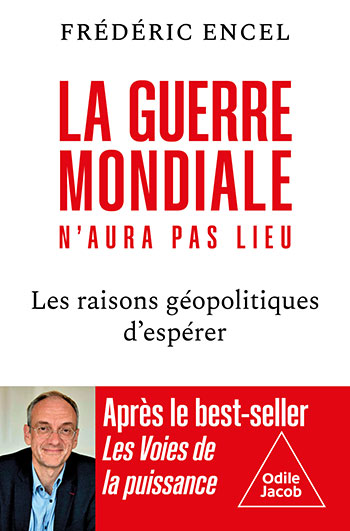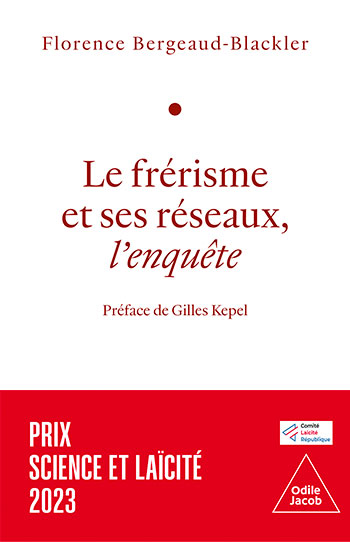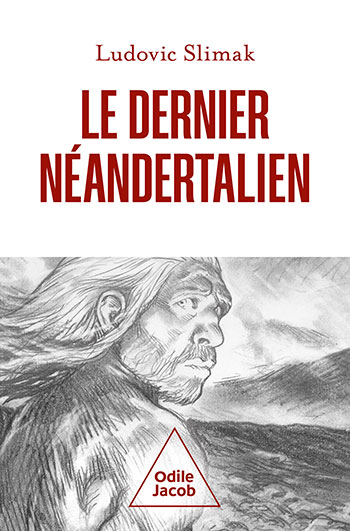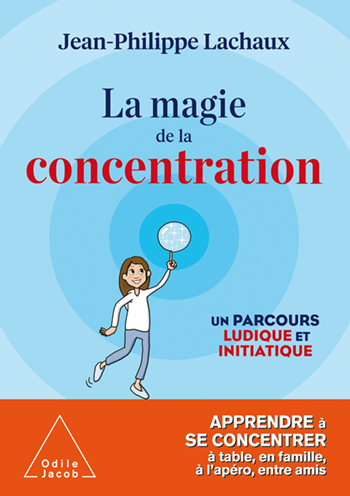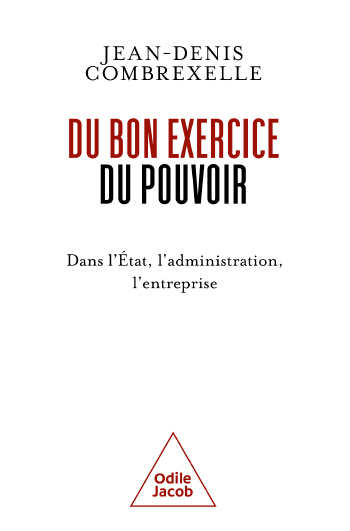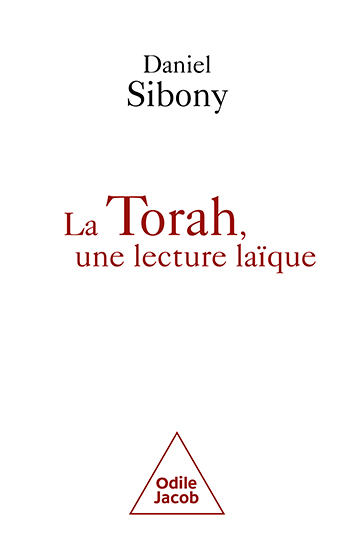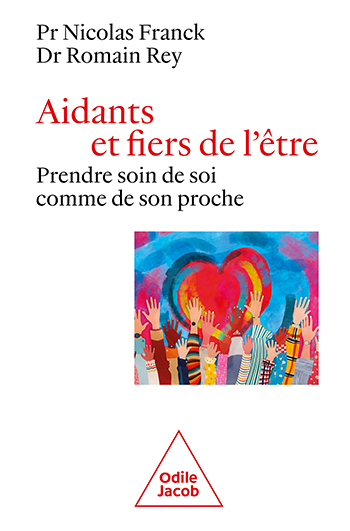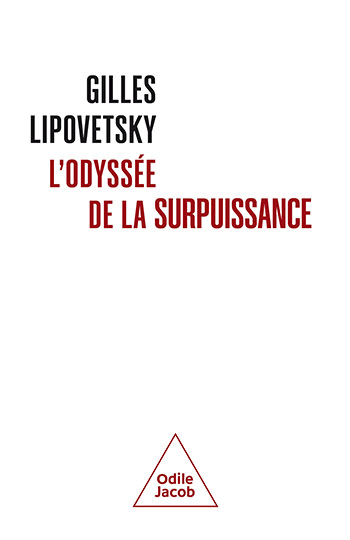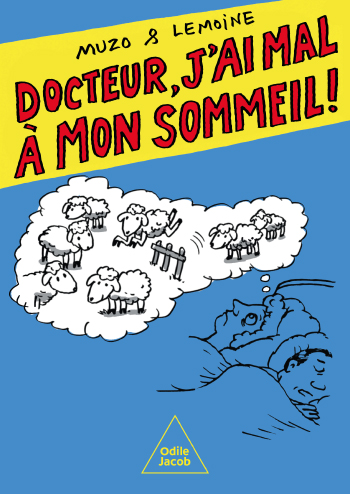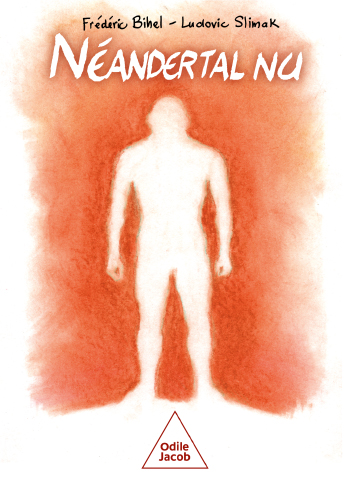SOMMAIRE
INTRODUCTION
LES ÉPIDÉMIES AU XXe SIÈCLE : UNE CERTAINE INDIFFÉRENCE
COMPORTEMENTS PENDANT LA CRISE ÉPIDÉMIQUE
L’attitude devant la mort
Les anticipations d’un « monde d’après »
Anomie, dissolution des liens sociaux
De la recherche des causes et des remèdes à celle de coupables. Boucs émissaires
« L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION » : LES CONSÉQUENCES DE DEUX
PANDÉMIES MAJEURES
La peste de Justinien (VIe siècle)
La peste noire (1347-1352)
LES VILLES DE LA PESTE À L’ÂGE CLASSIQUE
Un monde fermé, une société contrôlée
Les inégalités dévoilées et exacerbées
L’ÉCONOMIE DES VILLES DE LA PESTE
L’économie à Londres en 1665
Sorties de crises et évolution à long terme
EN CONCLUSION : RETOUR SUR LA COVID-19
INTRODUCTION*
« Tout simplement nous ne savons pas », c’est ainsi que Keynes caractérisait l’incertitude radicale[1], quand l’avenir n’est pas probabilisable car on ne peut même pas établir la liste des éventualités. Lorsqu’elle dure, elle génère une forte instabilité des anticipations, généralise le mimétisme ; d’où des comportements et des équilibres qui oscillent brutalement entre des extrêmes. On le voit avec les bulles financières qui gonflent hors de toute raison, éclatent brutalement précipitant des phénomènes cumulatifs à la baisse aussi peu rationnels. Tel est également le cas des épidémies lorsqu’elles sont nouvelles ou lorsqu’on ignore jusqu’où elles peuvent s’étendre, lorsqu’elles ne sont pas balisées ou banalisées, lorsqu’il n’est nul remède connu. La covid-19 est une épidémie de ce type, caractérisée par l’incertitude sur son origine, son évolution, sa durée, l’évolution de la maladie, son caractère saisonnier ou non, ses rebonds, les médicaments actifs, etc. Cela ne signifie certes pas que l’on ne sait rien, loin de là. Les connaissances sur la covid-19 sont importantes et croissantes. Son génome a été séquencé très rapidement et, en moins d’un an, des vaccins ont été mis au point, mais on ne sait pas ce qui va advenir.
Une telle incertitude concernant la vie et la mort, lorsque les taux de létalité d’une épidémie sont élevés et la contagion forte, suscite – comme on le disait du choléra – une « peur bleue »[2], individuelle et collective, mais pas seulement, pas si simplement. On peut en effet observer des évolutions quasi chaotiques de la psychologie collective, de la négligence à la panique, avec de brèves bouffées festives libératrices, puis à l’accoutumance, à la lassitude, voire à la négation du danger, et des retours de panique. Quand l’épidémie s’évacue, l’oubli de la catastrophe peut venir rapidement. Un énorme choc létal comme lors de la peste noire de 1348 fait alterner l’effroi et le désespoir avec des espérances messianiques ; son retour périodique fait qu’une atmosphère de peur finit par imprégner la société provoquant le sentiment d’un monde en chute vers sa fin.
On ne sait pas, mais on cherche à comprendre, à trouver les causes, scientifiquement ou en s’appuyant sur de vagues croyances, on recherche des responsables. Durant des siècles, au-delà des « mouches minuscules » ou des miasmes, au-delà des signes comme des pluies de grenouilles, des nuages en forme de cheval et autres passages de comètes, la cause profonde des épidémies demeura un châtiment infligé par Dieu (ou par les dieux ou par la déesse Némésis) aux hommes pour leurs péchés. De nos jours nombreux sont ceux qui voient les épidémies comme le châtiment des fautes de l’être humain envers la nature. Se répandent les rumeurs les plus folles, elles activent les peurs, elles font rechercher des boucs émissaires, elles renforcent la méfiance – voire la défiance – envers les autorités.
Les autorités, elles aussi, sont prises dans l’incertitude, leurs décisions peuvent être extrêmes, erratiques, oscillant sous l’aiguillon de la peur, peur des émeutes, des révoltes, de passer en jugement ou simplement de perdre les élections. Religieuses, expertes, ou politiques, les autorités sont généralement amenées à utiliser les peurs pour renforcer leur pouvoir. Pouvoir sur les âmes, et partant sur les comportements : les prêtres imposent des sacrifices, des pénitences, des processions, dirigent les consciences (comme les sorciers des peuples « premiers » imposent des danses sacrées). Les autorités politiques visent toujours à renouer et renforcer le pseudo contrat d’échange de leur protection contre la soumission du peuple et, dans ce but, consciemment ou non, elles manipulent les angoisses du peuple. Les « sachants », experts, médecins et autres, vrais ou faux, affirment leur pouvoir. Ils cherchent à s’imposer, eux ou leur école, à leurs pairs et prescrivent aux autorités et à la population des politiques et des comportements normés.
Dans l’épais brouillard de l’incertitude, il nous faut trouver une boussole, d’où l’importance des enseignements que l’on peut tirer de l’histoire. Mais la prudence est de mise. Ces leçons de l’histoire, en effet, sont énigmatiques et souvent ambigües. L’histoire parle, mais un peu à la manière du Sphinx de Delphes. Il faut interpréter le message. Je suis donc loin de partager la vision de Paul Valéry lorsqu’il estimait que « l’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré »[3]. Il faut cependant reconnaître que l’histoire est délicate à manier. La crise sanitaire me donne le prétexte d’employer un vieux terme médical pour la qualifier. Elle est ce que les Anciens nommait un pharmacon, c’est-à-dire à la fois un poison et un remède[4]. S’il est vrai qu’un peuple qui oublie son histoire peine à affronter son avenir, il faut admettre d’une part, qu’elle risque de ranimer des braises anciennes, de faire flamber à nouveau des haines recuites, d’autre part, que le recours à l’histoire comparative peut donner des exemples de tout, voire de n’importe quoi. Je parlais naguère « d’histoire ambiguë » rappelant que, bonne fille, elle donne une preuve à tout le monde. Il en va ainsi de l’histoire des épidémies. S’il faut y recourir pour éclairer les épidémies contemporaines, c’est d’une main tremblante.
Il en va des « enseignements de l’histoire » comme de ce que Ionesco racontait à propos de Manès Sperber[5] qu’il considérait comme un sage. On allait le voir, explique-t-il, lorsqu’on était dans l’embarras (dans l’incertitude), et après l’avoir entendu, on était toujours dans l’embarras, mais dans un embarras en quelque sorte supérieur.
Pour qu’il soit envisageable de tirer des leçons de l’histoire, il faut qu’elle repère des constantes ou des analogies. Face à la manière dont les sociétés ont réagi à l’épidémie de covid-19, le « donneur de leçons historiques » se trouve embarrassé : il n’existe aucun précédent de confinements généralisés à l’échelle, quasiment, de la planète. Avec cette mesure, il y a irruption d’une nouveauté majeure : pour la première fois, les sociétés dans leur diversité ont réagi en cherchant à privilégier la vie par rapport à l’économie. À l’arrière-plan de cette innovation qu’est le confinement généralisé, il y aurait un changement de l’attitude face à la mort, particulièrement face à la mort collective.
Ce qui a été sacrifié, cependant, ce n’est pas seulement l’économie, c’est aussi l’éducation, la culture, les relations sociales, les activités festives, une part du sacré qui subsiste dans nos sociétés. Lors de la deuxième vague de covid-19, à l’automne 2020, les politiques prophylactiques des États ont sacrifié ces dernières activités tout en tentant de préserver l’économie, ce qui s’est avéré impossible.
Si le confinement généralisé est une innovation majeure, il n’est cependant pas une innovation radicale. Ainsi le recours à l’histoire comparative s’avère pertinent aujourd’hui. En effet les épidémies majeures du passé – comme la peste ou encore le choléra – ont provoqué une fermeture des villes et des régions infectées – aussi bien dans leurs relations avec l’extérieur qu’à l’intérieur des cités –, la clôture des frontières, des états de siège, des quarantaines, le port de masques, la mise à distance. Ces mesures d’enfermement ont généré un arrêt cardiaque de l’économie, une explosion du chômage, l’accroissement du paupérisme, des famines. Le choc démographique causé par la peste est sans commune mesure avec la covid-19 (qui, en outre, tue essentiellement les personnes âgées) : la peste noire avait, approximativement, un taux de mortalité 1.000 fois plus élevé que celui de la covid-19[6]. En revanche le confinement généralisé nous fait renouer aujourd’hui avec des effondrements économiques et des privations de liberté qui rappellent ceux des « villes de la peste ». Il ne s’agit donc pas de comparer des chocs démographiques, mais leurs conséquences sur la pétrification de l’économie, sur les mentalités, les comportements, les relations sociales.
Trois leçons peuvent être tirées des sorties de crises épidémiques majeures du passé : 1) L’épidémie terminée, une reprise post-traumatique en V ou en aile d’oiseau – d’abord forte, puis ralentie – est l’éventualité la plus crédible. Malgré une mortalité très élevée – entre 20% et 60% de la population pour la peste –, les villes ou les nations frappées par le fléau se sont avérées dans l’ensemble étonnement résilientes à court terme ; 2) Les conséquences sont très différentes selon les catégories sociales, les entreprises et les secteurs : d’une part, les inégalités sociales sont révélées et renforcées par l’épidémie (les plus pauvres, les plus précaires sont durement atteints, les plus riches s’en sortent bien) au risque de révoltes sociales ; d’autre part, elle renforce les entreprises les plus solides (fortement capitalisées) et les secteurs dynamiques, et elle fait disparaître les entreprises fragiles, enfonce davantage les secteurs archaïques ; 3) À plus long terme, les pays qui ont les institutions les mieux adaptées et qui sont les mieux dotés dans les nouveaux secteurs porteurs en sortent renforcés au détriment de ceux dotés d’institutions sclérosantes et embourbés dans les secteurs traditionnels. Les villes ou nations aux structures économiques et sociales fragiles ou en déclin paraissent récupérer, mais l’essor s’essouffle (courbe en aile d’oiseau) et dans le long terme la tendance décliniste en est confortée. L’épidémie tend à pousser les économies et les sociétés dans le sens où elles penchaient déjà. Elle accentue les tendances antérieures, jouant un rôle d’accélérateur de l’histoire.
LES ÉPIDÉMIES AU XXe SIÈCLE : UNE CERTAINE INDIFFÉRENCE
Il n’est pas nécessaire de revenir plusieurs siècles en arrière pour observer un changement de l’attitude face à une épidémie et à une mortalité massive. Cent ans suffisent, voire moins, pour observer les différences de réactions des individus, des médias et des autorités lors des épidémies – disons entre la grippe espagnole de 1918 et la covid-19. Rétrospectivement on est frappé par une relative tolérance collective face aux décès dus aux épidémies ou aux catastrophes encore pendant les années 1950-2000. On s’accommodait avec la mort. En particulier, la disparition de vieillards emportés par une épidémie ou la canicule (celle de 2003 a fait en France 20.000 victimes) apparaissait dans l’ordre des choses. Dans le combat de la science contre la maladie, les morts étaient une sorte de résidu fatal.
Il ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur les attitudes passées face à la mort, mais seulement de constater qu’aujourd’hui la mort, et particulièrement la mort collective, est devenue socialement injustifiable, un scandale. L’épidémie de covid-19 a provoqué un confinement massif, quasi-général à l’échelle du monde avec des conséquences majeures, économiques, mais pas seulement, loin de là. Jadis, des maisons pestiférées étaient fermées, des quartiers isolés, des quarantaines instituées, des villes s’entouraient de « murs de la peste » comme autour de la région marseillaise en 1720, on contrôlait les entrées et les sorties, on se barricadait, le commerce intérieur et surtout extérieur s’arrêtait, mais l’histoire ne comporte aucun épisode de confinement mondial. Alors même que notre civilisation place l’économie au centre de ses préoccupations, divinise la croissance, confrontée à l’épidémie de coivid-19, les autorités finalement se sont très largement ralliées au « quoi qu’il en coûte », et le coût est effectivement exorbitant, le confinement généralisé ayant, dans la foulée, sacrifié une part importante de la vie sociale et même familiale, de la culture et de l’éducation.
Si l’on regarde les réactions collectives face aux épidémies du dernier siècle, comment ne pas s’étonner d’une certaine passivité.
Considérons la grippe espagnole de 1918-1919[7]. Elle s’est développée en trois vagues : avril à juillet 1918 ; fin août - début septembre à novembre 1918, février et mars 1919. La deuxième a été de loin la plus meurtrière (mutation de la souche ou nouvelle souche ?). Le taux de mortalité de la grippe espagnole était nettement plus élevé que celui de la covid-19. Globalement, elle a fait entre 30 et 50 millions de morts dans le monde, soit entre 1,7% et 2,7% de la population (1,860 milliards en 1920), deux fois plus que la Première Guerre mondiale (certaines estimations récentes comptent cent millions de morts, soit plus de 5,3% de la population). Quant à la covid-19, elle a déjà tué (janvier 2021) 1.836 millions d’êtres humains dans le monde sur une population totale de près de 8 milliards (soit un taux de mortalité de 0,023%)[8].
En ce qui concerne les seules nations belligérantes, les chiffres comparés restent impressionnants : la grippe fait approximativement 250.000 victimes en France, la guerre 1.400.000. Les États-Unis comptent 550.000 décès de son fait et la Chine entre cinq et neuf millions. Elle a frappé essentiellement la tranche d’âge des jeunes adultes. Il s’agit donc d’une des pires catastrophes de l’histoire des épidémies : en nombre de mort elle tue autant que la peste noire entre 1347 et 1352, et en pourcentage, neuf siècles après, vingt fois moins. Cette saignée majeure a certes été violemment ressentie, cependant – en partie du fait de la guerre et de la censure de guerre – elle n’a pas provoqué une réaction médiatique et institutionnelle à la hauteur du drame.
|
Pratiquement aucun article sur la grippe en France jusqu’à fin juin 1918, quelques rares articles en juillet-août (le 31 août, Le Matin parle d’une « petite épidémie »), à peine plus en septembre. On explique que le soldat français résiste bien mieux que « le boche ». Ce n’est qu’en octobre, au sommet de la mortalité, que les journaux publient régulièrement des articles sur la grippe, donnent le nombre de morts, et en novembre surtout pour expliquer que l’épidémie retombe. Ils donnent des conseils prophylactiques (se laver les mains, les dents, se gargariser à l’eau oxygénée, isoler le malade, désinfecter ou laver les vêtements, porter un masque ou, si on n’en a pas « une simple compresse hydrophile trempée dans l’eau bouillie, posée sur le nez et la bouche et attachée par-dessus les oreilles avec un cordonnet », écrit un médecin, ne plus balayer les lieux publics). Ils conseillent d’éviter les réunions trop nombreuses. Ils proposent des remèdes (l’aspirine et la quinine, les grogs au rhum, une mixture contenant aspirine, citrate de caféine, benzoate de soude, tisanes d’orge, de chiendent, de queues de cerises, teinture de cannelle, de quinquina, du sirop d’écorce d’orange amère). Les réclames pour des médicaments miracles prospèrent (la « Farine tutélaire » qui permet une suralimentation souveraine contre le mal, la Fluatine qui soigne toutes les maladies épidémiques – choléra, peste, typhoïde, variole, rougeole, scarlatine, etc. –, le Rheastar qui guérit aussi la tuberculose). Les charlatans s’en donnent aussi à cœur joie lors de la troisième vague. Quelques rares articles critiquent les autorités. Ainsi le 19 octobre, Le Journal accuse les autorités de s’être contentées de placarder des affiches et de publier des circulaires, de ne pas avoir lancé de lutte sérieuse. Il faudrait fermer les écoles, interdire les rassemblements, établir un cordon sanitaire aux frontières[9]. |
Aux États-Unis qui ont connu 500.000 morts et d’où la grippe espagnole s’est propagée vers l’Europe, certains gestes barrières et la distanciation sociale ont été imposés dans quelques villes, en particulier à Saint-Louis, à Seattle, avec fermeture des écoles, interdiction des attroupements, quarantaines, et le port du masque a été parfois recommandé. À New-York, on a désinfecté des rues et des transport publics, les horaires des entreprises ont été harmonisés, on recommandait aux salariés des promenades d’un quart d’heure, matin et soir, pour respirer le bon air (d’où la déambulation de groupes dans les rues). Dans ce même esprit, à San Francisco, il y eut des sessions du tribunal en plein air. En Grande-Bretagne, il n’y eut pas davantage de lutte coordonnée centralement. Si Arthur Newsholme (de la Royal Society of Medicine) avait rédigé un « memorandum for public use » en juillet 1918 recommandant d’éviter les grands rassemblements et aux malades de rester chez eux, le gouvernement l’enterra. Newsholme, ultérieurement, tout en expliquant que le suivre aurait sauvé de nombreuses vies, ajoutait qu’il est des situations (la guerre) où « the major duty is to “carry on”, even when risk to health and life is involved. » Quelques dancings, théâtres, églises fermèrent, on porta un peu le masque ; mais les pubs, les stades, etc. restèrent ouverts. En France, il n’y eut pas de dispositions réglementaires générales, quelques rares communes ont fermé les cafés, des lieux publics. Alors que les hôpitaux étaient complètement débordés, l’État s’est contenté d’incitation à des mesures contre la contagion. La Société des nations créera l’Organisation internationale d’hygiène pour lutter contre la propagation des épidémies, ancêtre de l’OMS (1949)[10]. L’impact économique de l’épidémie a été fort : le PIB mondial aurait baissé de près de 5% de son fait.
Plus près de nous, on peut s’étonner rétrospectivement d’une relative indifférence collective face à des épidémies de type grippal, généralement moins graves que la covid-19 – et plus encore de la grippe espagnole – mais néanmoins de grande ampleur.
|
Pour ce qui concerne l’attitude face à la mort de l’autre, même s’il ne s’agit pas d’une maladie respiratoire, il faut parler, pour le mettre à part, du Sida. Le nombre de morts liés à cette maladie depuis 1982 est, selon les estimations, de 25 à 42 millions. Or, dans les années 1980 surtout, il y eut pire que l’indifférence, une innommable stigmatisation des victimes[11]. Comme elle a frappé d’abord principalement la communauté homosexuelle, un déferlement de haine et de panique a accompagné la montée de la maladie. Comme elle semble s’être propagée à partir de Haïti, elle a fait se multiplier les discours racistes. On parle de « cancer gay », de maladie des 4 H : le sida est censé atteindre les Haïtiens (entendons les Noirs), les héroïnomanes (tous les toxicomanes), les hémophiles et les homosexuels (et certaines pratiques sexuelles), et simultanément on accuse ces catégories de le transmettre par la salive, un simple contact, voire volontairement : on parle d’attaques menés par des « sidaïques » (l’expression « sidaïques » est forgée par Jean-Marie Le Pen[12]) pour contaminer des gens « normaux ». Le personnel hospitalier est souvent lui-même effrayé, on parle de mise en quarantaine, d’hôpitaux spécialisés comme pour les lépreux au Moyen Âge[13]. Se répand l’idée dans les milieux intégristes que le sida est la punition divine du péché de sodomie (ou d’autres). Et bien entendu se multiplient les théories du complot, les thèses négationnistes, les croyances ésotériques. |
L’épidémie de 1957-58 (A (H2N2)) (la « grippe asiatique » aux origines chinoises) aurait fait 2 millions de morts dans le monde sur une population alors de 3 milliards d’habitants (soit un taux de mortalité de 0,066%). En termes de taux de mortalité, cette épidémie est donc très proche de celle de la covid-19 pour ce qui concerne l’Europe et les États-Unis ; à l’échelle mondiale la covid-19, avec son taux de mortalité de 0,023% début 2021, reste encore bien en deçà.
En France, 25% de la population est atteinte (dont 5% asymptomatiques). Les autorités l’assimilaient à une grippe saisonnière, les média l’ignorèrent. Les évaluations de l’époque minorent massivement les victimes : 15.000 morts recensés officiellement alors qu’il y a eu probablement entre 30.000 et 50.000 (certaines évaluations parlent de 100.000 morts). Un vaccin ne sera pas développé avant 1969 et la grippe de Hong-Kong (cf. infra l’erreur alors commise). Elle a été occultée, y compris par ceux qui la subirent, un cas type d’oubli de la catastrophe. Les conséquences économiques furent importantes. Aux États-Unis, la Bourse (S&P 500) baisse de 20% (entre juillet – l’épidémie a commencé en juin – et décembre 1957). La récession est forte (-3,6%, la plus forte de l’Après-guerre, jusqu’en 1973), mais brève (reprise dès avril 1958), le chômage atteint 6,8%, les ventes de voitures chutent de 31% en 1957. Cette récession, cependant, ne saurait être attribuée entièrement à la grippe : c’est aussi une récession classique dans le cycle de ces années-là : l’expansion a été très forte entre 1954 et 1957, l’inflation s’est accrue et une politique monétaire restrictive (taux d’escompte à 3,5%) est mise en place tandis que la politique budgétaire se fait restrictive. Au doigt mouillé la grippe est sans doute responsable d’une chute du PIB entre 1,6% et 2%.
La grippe de Hong-Kong de 1968-69 a fait un million de morts dans le monde, 100.000 aux États-Unis. Selon Antoine Flahaut et Alain-Jacques Valleron, elle a fait 31.000 morts en France (chiffre porté à 36.000). C’est la troisième plus grave pandémie du XXe siècle. Elle passe largement sous les radars des médias et les pouvoirs publics l’ignorent pour l’essentiel. Il faut dire qu’en 1968-69, particulièrement en France, d’autres évènements polarisent l’attention ! Pourtant on dispose de témoignages d’hôpitaux débordés, de malades entassés dans d’immenses salles communes, de morts par milliers. Elle frappe en deux vagues, modérément en 1968, sévèrement à l’automne et l’hiver 1969 (25.000 morts en décembre en France). Elle est due au virus A(H3N2) et les scientifiques, croyant qu’il s’agissait d’un virus H2N2 comme en 1957, vont préparer des vaccins qui s’avéreront totalement inefficaces (c’est l’une des causes de la montée des thèses anti-vaccin).
Les conséquences économiques sont importantes : fermeture de nombreux commerces, perturbation des transports et des usines (au pic, 25% des salariés sont atteints simultanément). À l’échelle mondiale on observe un léger infléchissement en 1968 (le PIB mondial aurait baissé de son fait de 0,7% selon la Banque mondiale). Aux États-Unis, la récession commence à l’automne 1968 et se termine en novembre 1970 et elle suit en Europe. On ne peut l’attribuer (uniquement) au virus, même s’il a pu servir de déclencheur. Elle met fin à une très longue phase d’expansion.
Il faut attendre les débuts du XXIe siècle pour que l’état d’esprit se modifie. C’est le cas avec l’épidémie de SRAS en novembre 2002. Partie de Chine, sa diffusion a été rapide du fait de la mondialisation et du trafic aérien. L’épidémie a surtout frappé en Asie (Chine, Hong-Kong, Taïwan, Singapour) où le contrôle de la propagation fut rapidement organisé (gestes barrières, désinfection, quarantaine, masque obligatoire, interdiction de cracher). L’épidémie n’a duré que quelques mois et il n’y a eu que 774 décès. À partir de 2003, la transformation des mentalités s’observe en Asie en particulier par l’usage massif du masque (il est aussi anti-pollution) dans la vie courante, phénomène qui est observé avec étonnement et commisération en Europe ou aux États-Unis. L’Asie était beaucoup mieux préparée que le monde occidental lorsque la covid-19 a frappé, d’où la divergence des résultats en termes de mortalité. En 2009, la deuxième pandémie de type A (H1N1) (après la grippe espagnole) a été prise au sérieux alors même que sa mortalité n’est pas plus élevée en moyenne que celle de la grippe saisonnière ; son taux de mortalité étant, en revanche, beaucoup plus élevé chez les jeunes. S’il y eut probablement 200.000 morts dans le monde, la France a été épargnée.
Pour faire face aux épidémies de SRAS et de grippe A (H1N1), d’importants achats de masques et de doses de vaccin ont été opérés tandis que des entreprises françaises productrices de masques recevaient l’assurance que les achats de renouvellement seraient effectués régulièrement. L’épidémie A (H1N1) s’étant évaporée en France, non seulement la ministre Roselyne Bachelot a été vivement critiquée (y compris par la Cour des comptes) pour le coût jugé exorbitant de ces précautions, mais cette politique a été abandonnée. En 2009, selon un rapport du Sénat, le stock de masques FFP2 (destinés aux professionnels) était de presque 600.000 et celui de masques chirurgicaux de plus d’un milliard. Ultérieurement, surtout après le « changement de doctrine » opéré en 2013 selon lequel la gestion des stocks ne serait plus assurée par l’État, mais par les établissements hospitaliers, les EHPAD, les médecins de ville, les entreprises, ces masques (ne correspondant plus aux nouvelles normes) ont été détruits et non remplacés, les entreprises françaises n’ont plus reçu de commandes et ont dû laisser péricliter « l’outil de travail », aucun avis n’étant adressé aux établissements et médecins pour leur demander de constituer des stocks. L’EPRUS (Établissement de Préparation et de Réponse aux Urgences sanitaires) créé en 2007 pour gérer « les produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves » est même dissout en mai 2016 (théoriquement, il est fusionné avec d'autres organismes au sein de Santé publique France ; de fait il disparait)[14]. À la veille de l’épidémie de covid-19, le stock de masque FFP2 était tombé à zéro et il y avait un manque crucial de moyens matériels (respirateurs, blouses, gants, tests, nombre de lits …) et humains (manque de personnel médical, particulièrement infirmier). L’austérité budgétaire en matière de santé avait provoqué cet effondrement des moyens et les capacités de production nationale avaient été éradiquées par l’absence de commandes (les commandes résiduelles étant passées auprès d’entreprises chinoises). Après quelques années de précaution au début des années 2000, on était revenu à une certaine indifférence, une sorte de « malign neglect ». Résultat : à partir de février 2020, la réponse publique à l’épidémie de covid-19 n’est pas sans faire penser à l’effondrement de l’armée française pendant l’étrange défaite[15] de mai – juin 1940. Comment expliquer ce désarmement sanitaire ? Ont pu jouer la constatation que les épidémies de type grippal perdaient de leur importance depuis la grippe espagnole et le fait d’avoir échappé au retour de cette grippe H1NI en 2009. Sans doute faut-il faire la part de l’incapacité d’une bureaucratie centralisatrice, mais l’explication principale est l’obsession des économies à réaliser, les dépenses de santé (comme celles des autres services publics) étant considérées seulement comme un coût qu’il faut réduire pour assurer la compétitivité globale de l’économie (à cette fin le pouvoir a été confié dans l’hôpital aux « managers »), d’où l’effondrement des moyens matériels et humains (en relation avec la faiblesse des salaires).
Plus généralement, comment expliquer la relative indifférence envers les épidémies du XXe siècle ? Sans doute, la proximité des guerres mondiales avec leurs millions de morts notamment civils explique pour une part la relative acceptation de la mort collective. En outre, la science n’avait pas encore fait reculer suffisamment les maladies « tueuses de masse» comme la tuberculose, la pneumonie, la typhoïde, la poliomyélite et tant d’autres. Il faut ajouter que la sphère médiatique et les réseaux sociaux ont pris une ampleur considérable, ils gonflent les mouvements, suscitent des bulles de peurs, pèsent lourdement sur les décisions des autorités. En 1969, les médias de masse étaient encore largement contrôlés par certains États (France), mais s’il y a une part de silence imposé, il reste que les journaux indépendants ne se souciaient guère des épidémies meurtrières.
Peut-être paradoxalement, alors que depuis les années 1980, la vague libérale a fait reculer l’État, le besoin de protection par un « État-providence » est devenu encore plus puissant, surtout en matière de santé publique. Sous l’Ancien Régime, le roi était censé « nourrir le peuple », et il était considéré comme responsable des famines ; d’où les émeutes frumentaires. Au XXIe siècle, les gouvernements sont tenus responsables des morts dus à l’épidémie. D’où les craintes politiques des gouvernants, d’où leur quasi-impossible refus du confinement général en l’absence de moyens pour lutter contre la contagion (masques, tests etc.) et soigner (lits, respirateurs, …) surtout lorsque d’autres pays l’eurent mis en œuvre. La stratégie traditionnelle de l’immunité collective, le « laisser-faire » (comme Boris Johnson l’a d’abord tenté) qui préservait l’économie s’est révélé intenable lorsque le système hospitalier menaçait d’être – ou était – débordé. La Chine, première frappée par la covid-19 fut aussi la première à mettre en œuvre un confinement de masse, et particulièrement sévère. On aurait pu imaginer que ce genre de régime n’était pas à quelques centaines de milliers de morts près, qu’il allait les sacrifier sur l’autel de l’économie. Ce n’était plus possible et, bien au contraire, les armes de la surveillance dictatoriale ont été mises au service du confinement (que ce soit par peur des révoltes, des réactions du reste du monde, par volonté d’apparaître exemplaire). Le confinement a été généralisé à des pays émergents alors même que l’absence de sécurité sociale, d’allocations-chômage (et de mesures de chômage technique), de soutien suffisant de l’économie et de l’emploi augmentait la paupérisation et condamnait une part importante de la population à la sous-nutrition.
La croissance économique quasi-divinisée au XXe siècle a été reléguée au second plan. Par rapport aux années 1950 ou 1960, la « valeur » de la vie humaine se serait élevée, et cela à l’échelle mondiale, quelle que soit la culture et le niveau de développement. En tous cas, le spectacle médiatisé de la mort en masse est devenu intolérable. Certes, de tous temps, l’amoncellement des agonisants et des morts dans les rues et les places de villes où la peste (ou les grandes famines) sévissait était un spectacle d’horreur (de Thucydide à Procope, Boccace et Ibn Khaldoun ou Pepys), mais aujourd’hui l’horizon du spectacle s’est élargi à la dimension du monde et la médiatisation rend sa répercussion universelle.
COMPORTEMENTS PENDANT LA CRISE ÉPIDÉMIQUE
Si l’on quitte les rivages contemporains pour aborder l’histoire longue, on observe certes de profonds changements des comportements, mais aussi des constantes ou des réminiscences. L’attitude devant la mort s’est profondément modifiée. Les peurs évoluent. Les figurations du « monde d’après » l’épidémie en sont bouleversées, même si on peut retrouver quelques similitudes. En revanche, les conséquences de l’épidémie sur les relations sociales et la montée de l’anomie ne sont pas sans traits communs. Enfin, malgré les développements de l’esprit scientifique, la recherche des causes de l’épidémie par l’opinion publique aujourd’hui – celle qui s’exprime sur les réseaux sociaux en particulier – conserve des aspects parfois étonnamment archaïques, comme le développement de croyances irrationnelles, la désignation de responsables imaginaires, de boucs émissaires.
L’attitude devant la mort
Les attitudes face à la mort ont changé profondément. De grands historiens comme Alberto Tenenti, Philippe Ariès, Michel Vovelle[16] – et beaucoup d’autres – ont étudié ces changements des mentalités.
L’effroi de nos jours ne concerne (mises à part quelques exceptions) que la mort corporelle. Dans les siècles antérieurs, dans le monde occidental, si cette mort physique de masse, avec son cortège d’horreurs, générait terreur et panique, la mort spirituelle était cause d’un effroi sans pareil. Jusqu’au XVIIIe siècle, mourir avec les secours de la religion, purifié par la confession, entouré des siens était certes angoissant, mais à la façon d’un grand départ, auréolé par l’espérance du salut. La peur des temps anciens était avant tout celle de la damnation.
Lors des grands chocs épidémiques, la peste noire de 1348 bien sûr, mais aussi pendant les épisodes pesteux qui frappent à tour de rôle villes et régions jusqu’au début du XVIIIe siècle, la mort de masse génère un effroi spécifique devant la soudaineté de la mort épidémique et le risque de disparaître sans les sacrements de l’Église lorsque, dans le paroxysme de la crise, les cadavres sont jetés directement dans les fosses communes, entassés recouverts de chaux vive (ce qui ne sera le cas que tardivement). Plus que la mort elle-même, l’épouvante tient à la désacralisation, à l’abandon des rites (même si souvent tout était fait pour en préserver un minimum), à l’effondrement des liens familiaux et sociaux qui se nouent autour du mourant. Nous avons largement perdu de vue que la tragédie humaine était alors dépassée par la tragédie de la mort à Dieu, et parfois, scandale absolu, du fait de la désertion des prêtres (cf. infra les témoignages lors de la peste noire), d’où l’importance, encore en 1720 pendant la peste de Marseille, d’un Mgr de Belsunce qui secoure les corps, mais surtout sauve les âmes des pestiférés[17]. Croyants ou non, n’avons-nous pas retrouvé l’ombre de cet ancien effroi lorsque le confinement dû à la covid-19 a interdit d’entourer le mourant dans ses derniers moments et aux proches de participer aux cérémonies ultimes ?
Il serait cependant lourdement erroné de croire que l’importance accordée au salut et l’angoisse devant la mort spirituelle fassent relativiser la mort corporelle lors des épisodes de mort de masse. Depuis la plus haute Antiquité, on observe au contraire, nous le verrons, que la « peur bleue » pousse à des comportements de panique, à braver les lois humaines et divines, à jouir follement de l’instant. Elle explique que des prêtres aient pu déserter leur devoir alors même qu’ils croyaient à la vie éternelle. Pour les contemporains, un des aspects particulièrement scandaleux, effroyable, de l’épidémie de masse est cette prise de possession de l’âme humaine par la peur de la mort corporelle, son emprise sur les comportements qui font négliger les devoirs sacrés de l’amitié, de la famille, de la recherche du salut. Le triomphe du Mal, du diable.
L’importance accordée à la mort spirituelle n’est qu’un aspect de l’évolution des attitudes face à la mort. Sur la très longue durée, Philippe Ariès et Michel Vovelle ont observé plusieurs processus à l’œuvre (étant entendu qu’à une même période, dans des lieux ou des milieux différents, il y a coexistence d’attitudes différentes). Ainsi la « dénaturalisation », soit la lente érosion de la « mort naturelle, « sans phrases », attendue, organisée par le mourant, une attitude qui domine jusqu’au XIIe siècle, mais qui reste présente jusqu’à nous (Ariès parle même d’achronie). Ainsi l’individualisation, soit la valorisation dès la fin du Moyen Âge de la « mort de moi », où chacun cherche à assurer son salut, mais aussi où se dévoile l’amour de la vie (les danses macabres du XVe siècle seraient davantage son expression qu’une figuration sépulcrale). Cette individualisation ne doit pas être confondue avec la désocialisation, la mort solitaire, le délitement des liens familiaux, ce phénomène typique des grandes épidémies.
L’attitude devant la vie et la mort de soi est différente selon les milieux sociaux, ou selon la représentation collective qui en est faite (via la littérature). Le paysan médiéval ou d’Ancien Régime est censé être pleutre ; le pauvre – dit-on – n’a que sa vie, la perdre est tout perdre, mais on lui attribue aussi une conception de la mort naturelle. Le guerrier, l’aristocrate est supposé mépriser la mort, voire la désirer, glorieuse, au combat[18]. Ne pas avoir peur de la mort est une attitude de gentleman et quand Thomas Hobbes au cœur du XVIIe siècle avoue avoir peur de la mort[19] – et en fait le ressort universel au centre de sa thèse – il détonne et provoque. Cette attitude aristocratique devant la mort se perpétuera en Europe jusqu’à la Première Guerre mondiale[20] (sans parler du Japon !).
L’attitude face à la mort de l’autre varie non moins fortement selon l’identité de cet autre. La mort du père vénéré, surtout s’il était un grand personnage, couvert de gloire, endeuillait cruellement les proches[21]. À l’exception du discours amoureux, la mort des femmes (de la mère ou de la sœur) importait moins que celle des hommes (le père, le frère). Notre époque a fait de la mort des enfants le drame suprême. Le Moyen Âge et les Temps modernes, au contraire, minoraient l’importance de cette mort (Montaigne ne savait plus combien il avait perdu d’enfants en bas âge, il faut dire que la mort des nourrissons était fréquente) et longtemps l’infanticide des petites filles fut une pratique courante. Quant à la mort des pauvres, elle était sans grande importance, des « bouches inutiles », malgré la doctrine chrétienne qui donnait toute sa dignité au pauvre – et cette charité importait[22] – même si les pratiques étaient souvent différentes.
Confronté à la mort de masse lors des épidémies de peste, à la mort qui semblait frapper au hasard, épargnant celui-ci qui, pourtant, paraissait chétif, tuant celui-là qui semblait bâti « à chaux et à sable », les hommes et les femmes du temps jadis se savaient dans la main de Dieu. Face aux épidémies, face à la covid-19, nos contemporains tentent de raisonner en termes de risque probabilisable. Même quand ils sont confrontés à l’incertitude, ils s’efforcent de domestiquer le hasard. Certes les hommes des Temps modernes font tout (et d’ailleurs n’importe quoi) pour échapper à la maladie, mais jusqu’au XVIIIe siècle, non seulement c’est illusion et vanité de penser que l’on peut s’affranchir des voies choisies par Dieu, mais c’est un péché mortel. Cette croyance doit être mise en relation avec la condamnation des jeux de hasard – ce qui n’empêche pas leur fréquence – un comportement estimé diabolique (dans les représentations de la crucifixion, les légionnaires jouent aux dés). Et le lien avec la condamnation de l’usure est direct : le temps est à Dieu (d’où aussi les réticences de l’Église face aux assurances, et l’accent mis sur le partage des risques). Lors de la Grande Peste de 1665-1666, Samuel Pepys (dans son Journal qui couvre les années 1660-1669[23]), un haut fonctionnaire affairiste de la marine, est l’un des derniers à quitter Londres, il se sait « à la grâce de Dieu » et semble vivre chaque jour comme s’il pouvait être le dernier. Alors que l’incertitude, en brouillant les anticipations, tend à restreindre l’activité, se savoir à la merci de Dieu peut la maintenir dans les tempêtes, parfois en en changeant l’orientation.
Les anticipations d’un « monde d’après »
Pendant l’épidémie de covid-19, on a vu se développer une multitude d’articles et d’ouvrages sur le thème « rien ne sera plus comme avant ». Cette littérature du « monde d’après » souvent non dépourvue de naïveté, gonflée de craintes et d’espérances, s’est développée en tout sens, chacun voyant midi à sa porte. Ces visions ne sont que les projections des espoirs et des peurs de ceux qui les énoncent : espérance écologiste ou peur du collapsus final, fin du libéralisme ou du « système », essor d’un néo-communalisme, démondialisation, souverainisme, nouveau dirigisme ou crépuscule de l’État, triomphe ou effondrement de l’Europe .... Toute proportion gardée, ce n’est pas sans faire penser aux espoirs et aux terreurs des temps de la Grande Peste de 1348 et des vagues de peste qui se succédèrent pendant trois siècles et demi. Alors se développent des espoirs et des terreurs eschatologiques.
Le choc causé par la Peste noire est si violent que le sentiment se répand que la mort n’épargnera personne, que l’Apocalypse approche portée par ses quatre cavaliers. Les retours réguliers de l’épidémie tout au long du XIVe siècle et pendant le XVe siècle s’ajoutant aux famines et aux guerres transforment cette crise paroxystique en un temps indéfini d’insondables malheurs collectifs, créent un sentiment collectif d’effondrement du monde. Les figurations des danses macabres, les représentations du Dict des trois morts et des trois vifs, du Jugement dernier se multiplient.
L’épidémie, comme les autres catastrophes, était considérée comme un châtiment divin pour les péchés du peuple. Ce faisant, le christianisme comme l’islam donnent du sens à l’épidémie et proposent un remède spirituel. En même temps, les clercs imposent leur pouvoir, leur système de valeur, ils soutiennent l’ordre établi[24] et désignent comme responsables ceux qui le remettent en cause, révoltés, hérétiques, jansénistes[25]. Les prêtres appellent à la prière et à la pénitence pour le pardon des péchés, organisent des processions[26] (elles furent initiées par le pape Grégoire le Grand lors de la peste de 590 à Rome). Les gens cousent dans leurs vêtements des prières manuscrites qu’ils écrivent parfois eux-mêmes. La croyance que la cause profonde des épidémies est la punition des péchés infligée par Dieu est une constante de l’Antiquité au XVIIe siècle, la « Prima et primaria causa est justissima summi Dei ira » (« la justissime colère de Dieu ») écrit encore le médecin hollandais Isbandis Diemerbroek lors de la peste de Nimègue de 1635[27].
D’où aussi des comportements extraordinaires. Je pense à ce Quaker dont nous parle Samuel Pepys qui, au lendemain de la Grande Peste de Londres (en juillet 1667), est venu quasi nu dans Westminster Hall en criant « Repentez-vous, repentez-vous ! »[28] et que retrouve Daniel Defoe dans son Journal de l’année de la peste (une fiction écrite en 1720 alors que la peste à Marseille effrayait les Anglais, un texte considéré comme une bonne source documentaire[29]). Le prétendu rédacteur du Journal[30] rencontre (la première fois au début de l’épidémie), un prêcheur nu (hormis un caleçon autour des reins) hurlant nuit et jour « Ah ! Grand Dieu, Dieu terrible » (Defoe, p. 56-57), un lointain inspirateur du prophète Philippulus dans L’étoile mystérieuse d’Hergé annonçant le châtiment, la fin des temps. Plus généralement, Defoe nous décrit une ville pleine de magiciens, d’astrologues, de faux prophètes (p. 64).
Au cours du Moyen Âge, mais encore au XVIIe siècle (avec même une force nouvelle), les croyances eschatologiques prennent deux formes antagoniques portées par des groupes sociaux et des communautés aux espérances conflictuelles. D’un côté – celui largement majoritaire de l’orthodoxie – se renforce ce que Jules Michelet nomme « l’effroyable espoir » du Jugement dernier, le royaume de Dieu dans l’au-delà pour les justes. De l’autre se développent de folles espérances millénaristes, celles que prêchent des clercs plus ou moins hérétiques et qui poussent à la révolte (et au massacre des juifs, des clercs, des nobles, c’est selon) : après l’apocalypse annoncée viendraient les mille années du royaume de Dieu sur terre (thèse condamnée depuis Saint Augustin)[31].
Si le thème d’une fin du monde imminente était omniprésent, le royaume céleste ou terrestre du Christ étant à l’horizon, le retour des chocs pesteux aléatoires entre le milieu du XIVe siècle et la fin du XVIIe siècle – et même 1720 à Marseille, dernière grande peste européenne – a également renforcé l’idée d’une chute continue, d’un déclin. Et il est possible d’établir une relation entre la fin de la pandémie pesteuse et l’essor de l’idée de progrès au XVIIIe siècle. De nos jours, l’épidémie de covid-19 intervient dans un monde où l’idée de déclin est revenue en force suivie par celle d’un effondrement dont l’épidémie ne serait qu’un symptôme.
L’épidémie de covid-19 n’est plus considérée comme une punition divine, du moins dans l’Occident sécularisé. En revanche monte en puissance l’idée que cette épidémie, et celles qui suivront, sont la revanche de Gaïa (notre planète personnalisée), que la folie prédatrice des hommes qui s’exerce sur elle ne peut qu’être sanctionnée : l’épidémie serait la conséquence – et d’une certaine façon le châtiment – de l’hubris productiviste des êtres humains, un aspect du grand « collapse » en cours. Spinoza avait fait scandale avec son célèbre « deus sive natura » (« dieu ou la nature » ou « dieu c’est-à-dire la nature »). La thèse de la punition des péchés de l’homme par Dieu – thèse que Spinoza rejette radicalement[32]– s’est aujourd’hui métamorphosée, la nature se substituant à Dieu pour punir les hommes pour ce qui peut être analysé comme la forme moderne de leurs péchés : « natura sive deus » [33], la nature remplace Dieu comme père ou mère fouettard. L’Apocalypse revient sous une forme renouvelée, mais aussi les espoirs que viendront des temps, sinon iréniques, du moins meilleurs.
Nous vivons une époque rousseauiste, la nature est estimée bonne, l’homme la pervertit et elle se venge. Rousseau s’oppose ainsi frontalement à Thomas Hobbes pour qui la nature est fondamentalement mauvaise, l’état de nature effroyable (la vie des hommes y est « solitary, poore, nasty, brutish, and short »), les institutions artificielles (et plus généralement les artifices) nécessaires pour la rendre vivable. Deux thèses extrêmes qu’il est nécessaire de penser ensemble. « Le beau, le vrai, le bien », les célèbres transcendantaux qu’illustrait Victor Cousin, ne correspondent-ils pas à l’être humain dans la nature, l’artificialisant pour l’améliorer tout en la respectant ?
Anomie, dissolution des liens sociaux
L’épidémie voit aussi le développement de l’anomie, la dissolution des règles morales et des relations sociales, des liens familiaux. Pour l’individu confronté à la contagion effective ou supposée, et que l’on sait potentiellement mortelle, le proche devient un étranger, l’étranger un ennemi, même si les observateurs notent aussi des attitudes solidaires et des comportements héroïques.
L’effondrement de la morale et des lois, la soif de jouissance sont déjà mis en avant par Thucydide[34] lors de la « peste » d’Athènes de 430-426 av. J.-C. : « Nul n'était plus retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines. Voyant tout le monde périr indistinctement, on ne faisait plus de différence entre la piété et l'impiété, on ne pensait pas vivre assez longtemps pour avoir à rendre compte de ses fautes. Chacun redoutait bien davantage l'arrêt déjà prononcé et suspendu sur sa tête. Avant de le subir mieux valait tirer de la vie quelque plaisir. » (Guerre du Péloponnèse, Livre II, 53).
|
La « peste d’Athènes Au début de la Guerre du Péloponnèse (431 av. J.C. – 404 av. J.C.), entre 430 et 426 av. J.C., alors que les troupes spartiates occupent l’Attique et font le siège d’Athènes, une épidémie qui sera dite de peste (il s’agit probablement du typhus) ravage la ville. Elle est décrite par Thucydide dans son Histoire de la Guerre du Péloponnèse. Périclès avait fait le choix d’une stratégie terrestre défensive et offensive sur mer, refusant de se heurter de front à l’infanterie de Sparte (les fameux hoplites spartiates), plus nombreuse que celle d’Athènes et la meilleure de Grèce. Il laisse l’armée spartiate occuper et ravager l’Attique, la ville d’Athènes étant à l’abri derrière ses murailles ainsi que le port du Pirée rattaché à la ville par un corridor protégé par de « Longs murs ». Les ruraux se sont en très grande partie réfugiés dans la ville où ils vivent dans des conditions très précaires, logés dans des cabanes, des « bidonvilles » dirions-nous (Thucydide explique que la présence de ces réfugiés a été une des causes de la gravité de l’épidémie ; particulièrement atteints par la maladie, ils auraient été une source majeure de contagion). Avant la guerre, l’Attique aurait compté 400.000 habitants, dont la moitié vivait à Athènes. L’épidémie aurait fait entre 75.000 et 100.000 morts en Attique, soit plus de 20% de la population. L’armée est durement atteinte : d’après Thucydide, à l’été 430, il mourut en quarante jours 1.050 hoplites sur 4.000 lors de la première vague (Livre II, 58) et, lors de la deuxième vague en 427, 4.400 hoplites et 300 cavaliers (Livre III, 87). Thucydide ajoute : « il est impossible d'évaluer le nombre des autres victimes », cependant, on estime que sur les 40.000 citoyens[35] – un chiffre approximatif – un quart mourut. Ces pertes dues à la peste – et celles dues à la guerre – obligèrent Athènes à élargir les règles de la citoyenneté à des bâtards, à des étrangers et à des métèques, à des esclaves ayant combattu (des rameurs des trières). D’où les critiques des réactionnaires et des partisans des oligarques (Aristophane dans Les Grenouilles compare les nouveaux citoyens à de la mauvaise monnaie) et de tous ceux qui estimèrent qu’après la mort de Périclès (tué par l’épidémie, après ses deux fils légitimes, en 429), la cité d’Athènes a dérivé de la bonne démocratie à la démagogie (c’est la thèse de Thucydide), d’où les erreurs – et les crimes – politiques et stratégiques, d’où la défaite. Une thèse évidemment combattue par les partisans d’une démocratie élargie. De ces polémiques, la pensée politique est née, et les débats sur le « populisme » se poursuivent jusqu’à nos jours. Toujours est-il qu’après la défaite, la réaction sanguinaire des Trente tyrans oligarques s’imposa sous la protection des troupes spartiates. Si la démocratie sera ensuite rétablie, Athènes ne sera plus qu’une cité parmi d’autres. La contribution de la « peste » à ce bouleversement politique fut considérable. |
Paul Diacre ou Procope décrivant la peste de Justinien (cf. infra), mais aussi avant eux Virgile, Ovide, Sénèque, Macrobe, Lucrèce mettent l’accent sur la folle recherche de jouissance, l’effondrement de la morale, des liens familiaux, le chacun pour soi et l’isolement.
Pour ce qui concerne la Grande Peste de 1348 à Florence, le texte le plus célèbre est celui de Boccace au début du Décaméron. S’appuyant sans doute autant sur ses observations que sur des auteurs anciens, il écrit : « les citoyens se fuyaient l’un l’autre et nul n’avait souci de son voisin […] le frère abandonnait le frère, l’oncle le neveu, la sœur le frère, souvent même la femme le mari […] les père et mères, comme si leurs enfants n’étaient plus à eux, évitaient de les aller voir et de les aider ». On retrouve la même idée sous la plume de Louis de Beringen (chapelain du cardinal Giovanni Colonna) décrivant cette même peste à Avignon (alors cité des papes[36] : « Un médecin ne visite plus le malade […] un père ne visite plus son fils, ni une mère sa fille, ni un frère son frère […] à moins qu’il ne veuille subitement mourir avec lui »[37].
Quant à la Grande Peste de Londres de 1665, Daniel Defoe écrit : « La conservation de soi semblait en fait la règle primordiale : les enfants fuyaient leurs parents […] les parents firent de même avec leurs enfants […] La menace de mort immédiate suspendue sur notre tête supprimait tout sentiment d’amour, tout intérêt pour autrui » (p. 184-185). On pourrait multiplier les citations et sans doute s’agit-il, en partie, d’un propos quasi obligé, d’un topos. Comme il était de coutume, tous ces lettrés se citent les uns les autres, tous reprennent Thucydide, les Anciens, Boccace, tous utilisent le langage codé de la catastrophe, particulièrement de la peste. Reste que les observations des contemporains font état du développement du « chacun pour soi », d’une recherche de la jouissance immédiate, de l’oubli des lois morales et du mépris de celles de la Cité. Ces comportements sont corrélés à l’intensité de la peur de la mort et la covid n’est pas la peste ! Mais comment ne pas observer la multiplication de lettres anonymes ou de messages de voisins visant à faire partir une infirmière d’un immeuble (« merci d’aller vivre ailleurs »), de dénonciations de SDF, de comportements d’évitement, et souvent des menaces et des voies de fait envers des personnes au type asiatique (encouragées aux États-Unis par le discours du président Donald Trump).
De la recherche des causes et des remèdes à celle de coupables. Boucs émissaires
Si les liens sociaux se dissolvent, on cherche aussi des causes et des responsables, les théories du complot se répandent, les rumeurs enflent, y compris les plus folles, on produit des fake news, on désigne des boucs émissaires, phénomènes dont Jean Delumeau a si pertinemment rendu compte dans La Peur en Occident[38] et dans nombre de ses travaux ultérieurs. Sans doute n’est-il pas nécessaire d’insister sur la comparaison avec notre époque qui voit l’anomie se développer et, particulièrement au sein des réseaux sociaux, le complotisme ressurgir avec, comme toujours, la recherche de boucs émissaires.
Redisons-le, dans l’esprit des contemporains des grandes épidémies pesteuses ou cholériques, il s’agit fondamentalement d’un châtiment infligé par Dieu pour les péchés du peuple ou de certains de ses éléments. Pour le reste, les contemporains ne comprennent ni le pourquoi, ni le comment, ni le commencement, ni la fin. L’incertitude est radicale, la raison impuissante. Et on retrouve ce désarroi dès Thucydide (« peste » d’Athènes) et Procope (peste de Justinien)[39]. On n’en cherche pas moins des causalités circonstancielles. Si la croyance en la contagion directe est largement partagée, la théorie qui incrimine les miasmes (de miasma, pollution), c’est-à-dire l’air empesté[40], ne l’est pas moins (à rapprocher des microscopiques gouttelettes en suspension dans l’air nommées aérosols à l’ère de la covid-19). Les porteurs et diffuseurs de peste peuvent être aussi bien des mouches minuscules, invisibles, que les chiens, les chats et les rats (ils seront massacrés en masse pendant la Grande Peste de Londres relate Defoe (p. 193)). On scrute les cieux pour y découvrir des signes, « un ange vêtu de blanc tenant une épée » (Defoe, p. 58), une comète passant « au raz des maisons », un nuage étrange, la conjonction des astres, des spectres hantent les rues. Contre les miasmes, particulièrement ceux émis par les malades, les effluves et vapeurs, il faut filtrer l’air par des aromates spécifiques (Hippocrate le recommandait déjà). Au XVIIe siècle se répand une invention du médecin Charles Delorme (1619), un costume conçu pour les médecins des lazarets et plus généralement visiteurs de pestiférés : un grand manteau noir formant comme une armure de cuir, sous le manteau des bottines, des culottes et une chemise de peau (maroquin), des gants, un chapeau noir à large bords, un masque tombant en collerette sur les épaules et prolongé d’un long bec recourbé (bec de corbin) bourré de ces herbes (il fait toujours florès à Venise pendant le carnaval), des bésicles, et à la main une baguette rouge ou blanche. Une bonne protection consiste à placer des feuilles de rue ou une gousse d’ail dans sa bouche (Defoe, p. 144), à fumer du tabac[41] dans une « plague pipe » (Pepys s’estime obligé de se mettre à priser et à chiquer, p. 95), on purifie en allumant de grands feux (Pepys 6 septembre, p. 168 : ce sont les consignes du Lord-maire) et on n’accepte une pièce de monnaie qu’après qu’elle ait été trempée dans un pot de vinaigre. De vrais ou de faux médecins proposent toute sorte d’antidotes, de pilules et de décoctions préventives (Defoe, p. 64).
La recherche de boucs émissaires est une constante des épidémies et celle de covid-19 n’échappe pas à la règle. Les théories du complot croient à une forme ou une autre de « pestilentia manufacta » : l’épidémie est créée ou propagée volontairement par l’homme. Il faut trouver des coupables. La Grande peste de 1348 est à cet égard caractéristique. Ce sont les juifs[42], ils empoisonnent les puits, d’où des massacres collectifs en Espagne, en Languedoc, en Provence, dans la vallée du Rhin (le massacre de la Saint-Valentin à Strasbourg en février 1349 de 2.000 juifs, avant même l’arrivée de l’épidémie dans la ville, le suicide collectif de Spire), dans tout l’Empire germanique, en Suisse, enfin partout où les juifs sont présents. La peste a joué un rôle de catalyseur des haines contre les juifs accusés de « tous les péchés d’Israël », accusation que l’Église entretenait (peuple déicide, hosties profanées, meurtres rituels, pratique de l’usure), elle était aussi un prétexte. Les massacres permettaient de se libérer des dettes envers les juifs et de se partager leurs biens. Ainsi à Strasbourg l’élimination des juifs était une revendication populaire (et d’abord celle des corporations d’artisans) et le pogrom a suivi le renversement du gouvernement bourgeois de la cité. Ce n’était pas un soulèvement spontané de foules, il a été organisé et il fut appuyé par les nobles et l’évêque.
Des sectes hétérodoxes comme les Flagellants amplifient le phénomène. Clément VI, pape en Avignon, réagit pour limiter le massacre (dans une bulle de 1348, puis contre les Flagellants en 1349), ce qui n’exonère pas l’Église de ses responsabilités pour nombre de prêches enflammés. On retrouvera de tels pogroms pendant la Guerre de Trente ans et au cours des siècles suivants, souvent commis par des bandes sectaires prêchant l’arrivée du Royaume de Dieu. Lorsque les juifs manquent, on s’en prendra aux protestants (comme à Lyon en 1628) ou à ceux soupçonnés (étrangers, réfugiés) d’être des « engraisseurs de peste » (ils imprègnent les portes de graisses empoisonnées, d’onguents jaunâtres). Dans certaines régions (Genève, la Savoie, la Franche-Comté, le Piémont) au XVIe et XVIIe siècle, ces « engraisseurs » sont souvent assimilés à des sorciers, ou plus souvent à des « sorcières – semeuses de peste ». Ainsi Jean Bodin dans son De la démonologie des sorciers parle de tels complots de sorcières – une quarantaine furent dénoncées – qui, lors de l’épidémie pesteuse de 1536 à Casal (Casale Monferrato) « graissaient les cliquets des portes, pour faire mourir les personnes », et cela se reproduira à Genève en 1563[43].
Pietro Verri dans son ouvrage contre la torture (Osservazioni sulla tortura, 1777), puis Alessandro Manzoni dans la Storia della colonna infame (1840) ont rendu célèbre le procès et la condamnation à mort après d’effroyables tortures de deux supposés propagateurs de peste à Milan en 1630, un monument étant même érigé pour rappeler leur crime (Manzoni parlera de la « colonne infâme »)[44].
Les accusations vont également cibler les gouvernants (surtout lorsqu’il s’agit d’autorités étrangères, d’occupants, comme les espagnols à Naples en 1656). On retrouve cela lors des épidémies de choléra au XIXe siècle[45]. Pendant celle de 1832 à Paris, la rumeur monte (encouragée par des agitateurs politiques aussi bien républicains que bonapartistes ou légitimistes) que l’épidémie est une invention, que les agents du gouvernement répandent des poudres dans les fontaines, le vin, etc. La rumeur enfle quand le préfet de police Gisquet fait afficher une circulaire accusant des agents provocateurs de répandre des poudres afin de faire croire que le gouvernement empoisonne le peuple. Des journaux comme Le National ou Le Constitutionnel s’en mêlent : il y aurait bien des empoisonneurs, mais ce sont des « chouans », des carlistes. Deux « empoisonneurs » sont lynchés[46], des dizaines d’autres suivront ! Jean Giono dans Le Hussard sur le toit s’inspirera de ces faits divers, Angelo passant si près du lynchage à Manosque qu’il devra se réfugier sur les toits.
« L’ABOMINATION DE LA DÉSOLATION »[47] : LES CONSÉQUENCES DE DEUX PANDÉMIES MAJEURES
À l’opposé des théories endogènes des crises, la crise épidémique ressortit d’une analyse des crises exogènes, des chocs stochastiques venant heurter une structure économique, et tout dépend de l’importance du choc (la violence du choc démographique, la concentration dans le temps de l’épidémie, son extension géographique) et de la plus ou moins grande fragilité de la structure sociale et économique. On retrouve l’idée issue d’Alfred Marshall (le cheval à bascule), celle de Ragnar Frisch distinguant l’impulsion aléatoire et la propagation dans la structure[48] (mais on ne vise pas ici une théorie du cycle exogène).
Les conséquences d’une crise épidémique dépendent évidemment de l’importance du choc. Je commencerai ici par les deux énormes chocs démographiques à l’échelle mondiale, celui du haut Moyen Âge et celui de 1348. J’en viendrai ensuite aux chocs démographiques principalement concentrés sur une ville et sa région, ceux du XVIIe siècle européen (les « villes de la peste »).
Les conséquences sont très différentes selon la solidité de la société et de l’économie, et ses capacités de rebond démographique. Observons qu’en moyenne, si les taux de fécondité sont très élevés dans les sociétés anciennes, la mortalité, et particulièrement la mortalité infantile l’est également, si bien que le taux de croissance naturel de la population européenne tourne autour de 0,3 et 0,6% entre 1347 et 1600, et il y a même stagnation au XVIIe siècle. Après une forte épidémie, cependant, un rebond démographique est la règle.
Le choc épidémique révèle les fragilités de la structure ou au contraire, sa stabilité ; il va être un accélérateur de l’histoire, accentuant le déclin lorsque celui-ci se faisait déjà sentir, mais sans infléchir une trajectoire expansionniste lorsqu’elle était solidement ancrée dans la structure socio-économique, voire la boostant. L’épidémie pousse le monde dans la direction où il penche. L’économie de la peste épouserait une courbe en K (« ‘K-shaped’ recovery ») : la chute est globalement rapide, les activités qui « avant » périclitaient tendent à s’effondrer (jambe descendante), le redressement et l’envol ne concernent que les activités qui étaient déjà les plus dynamiques avant le déclanchement de l’épidémie (bras ascendant). Dès lors l’évolution dépend du pourcentage entre ces deux types de secteurs. Et il ne s’agit pas seulement de secteurs. « Institutions matter » explique Douglass C. North et le destin se joue aussi à ce niveau.
Voyons donc d’abord comment ont réagi les sociétés confrontées aux deux pandémies majeures que furent la peste du Haut Moyen Âge (dite de Justinien) et la peste noire de 1347.
La peste de Justinien (VIe siècle)
La peste dite de Justinien ou du haut Moyen Âge[49] frappe le bassin méditerranéen à partir de 541. Elle se prolonge pendant tout le VIe siècle, en des poussées successives, jusqu’en 767. Au cours du seul Ve siècle, elle aurait tué entre 20% et 40% de la population mondiale. C’est celle décrite par Procope de Césarée dans Les guerres de Justinien[50] à Constantinople en 542, celle dont parle Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs qui la décrit à Arles en 549, à Clermont en 567 (en « un dimanche, on compta, dans la seule basilique de Saint Pierre [de Clermont], trois cents corps morts »[51]), à Marseille en 588 (une description étonnamment voisine de ce qui sera observé lors de la peste dans cette même ville en 1720)[52]. Naturellement l’idée qu’elle est un châtiment infligé par Dieu est très présente (c’est ce qu’explique Jean d’Éphèse ; Procope, quant à lui, se refuse à disserter sur les causes du fléau[53]). En 590, la peste est à Rome où le pape Grégoire le Grand organisa une immense procession de toute la population romaine (sept processions dans tout Rome se retrouvant devant la Basilique de Marie, chacun étant pieds nus, la tête couverte de cendres, la foule chantant des litanies derrière le portrait de la Vierge). Le résultat : « dans l’espace d’une heure […] quatre-vingt personnes avait succombé et rendu l’esprit » (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Paris : Renouard, 1838, X, 1, p. 15), mais le pape exhorta la population à continuer de prier. Jacques de Voragine, dans cette mythologie chrétienne qu’est la Légende dorée, prétend qu’à mesure que la procession avançait, les miasmes de la peste disparaissaient.
Une quinzaine de vagues se succèdent jusqu’au milieu du VIIIe siècle. La première vague (541-544) est presque certainement venue d’Égypte, elle serait originaire d’Éthiopie, mais la recherche contemporaine[54] lui prête une origine en Asie centrale et une arrivée sur les rives de la Méditerranée par les routes maritimes ou la route de la soie. En 541, elle est à Péluse, un port égyptien, à Alexandrie et de là, via la Syrie, elle atteint Constantinople et y sévit pendant quatre mois (trois avec une très grande force). Dans ce qui est alors l’une des plus importantes agglomérations du monde, elle aurait fait (selon Évagre le Scholastisque dans son Histoire ecclésiastique) 300.000 victimes (5.000 d’abord et jusqu’à 10.000 par jour[55]), soit la moitié ou le tiers de la population. Procope nous décrit l’effondrement économique de la capitale : « On ne voyait personne dans les places publiques de Constantinople, durant cette effroyable affliction. Ceux qui se portaient bien demeuraient dans leurs maisons, pour y assister les malades ou y pleurer les morts. Si quelqu'un apparaissait dans les rues, ce n'était que pour enterrer des corps. Il n'y avait plus de commerce, plus d'affaires, plus d’artisanat. Cette cessation générale fit venir la famine dans une ville, où l'abondance était d’ordinaire continuelle. Il était si difficile d'y avoir du pain, que plusieurs moururent de faim. »[56].
De Constantinople, la peste gagne la Méditerranée occidentale par Gênes et Marseille, elle remonte jusqu’à Clermont et Reims. L’Empire perse sassanide est submergé par la peste, mais on ignore les conditions de sa diffusion vers l’Inde. Les poussées vont se succéder tous les dix ou douze ans affectant essentiellement les pays riverains de la Méditerranée.
À l’Est et au Sud du bassin méditerranéen, l’épidémie ravage les deux grands empires rivaux, Byzance et l’Empire perse, et les affaiblit tous les deux considérablement, les amène à conclure des trêves, puis la paix (561), mais les hostilités reprendront dix ans plus tard. Sont particulièrement affectés par l’épidémie la Palestine, la Syrie, l’Égypte et la Lybie, le Maghreb. La dépopulation semble avoir été massive, mais il est impossible de donner des chiffres, même approximatifs.
Au nord de la Méditerranée, on recense six attaques pesteuses successives, à peu près une tous les dix ans[57], jusqu’en 600. Elle entre toujours par Marseille, Gênes, Rome ou Ravenne, elle ravage l’Italie, l’Espagne. En Gaule elle pénètre en profondeur en progressant le long de l’axe de communication Rhône-Saône-Loire. À partir de 600, cet axe de pénétration n’est plus actif ; la peste n’affecte plus (en Europe) que l’Italie, Marseille et Arles. Si les retours de la peste se succèdent jusqu’en 740, si les rives orientales de la Méditerranée restent périodiquement secouées par les vagues épidémiques, l’Europe de l’Ouest et du Nord sont hors d’atteinte du fléau.
Il est possible d’attribuer partiellement à la pandémie de peste, à ses retours et à sa géographie, les grandes évolutions de l’époque.
Dans l’Empire byzantin, la main d’œuvre manque, les systèmes d’irrigation sont abandonnés, l’agriculture recule, le désert avance. La Libye ou l’Égypte qui avaient servi de « grenier à blé » pour l’Empire romain subissent une régression agriculturale majeure. Les échanges se réduisent fortement le long des voies commerciales et les villes se dépeuplent. Lorsque la peste frappe Constantinople en 542, l’Empire byzantin sous le règne de Justinien est à son apogée (527-565). Celui-ci semblait en voie de rétablir l’Empire romain dans sa puissance et son étendue ayant reconquis une fraction considérable de sa fraction occidentale, au Nord (dont l’Italie) comme au Sud. La peste pourrait être le principal responsable de l’échec d’une résurrection, mais peut-être était-elle déjà hors de portée ? Pour Kyle Harper, le climat et la peste (deux phénomènes liés) sont responsables de la chute de l’Empire romain d’Orient[58], ce qui est très exagéré étant donné la survie sur sept siècles de cet Empire. Cette thèse attire cependant l’attention aujourd’hui dans la mesure où, pour certains, le réchauffement climatique générerait de nouveaux virus qui participeront au « collapse » général en cours : les visions du présent et de l’avenir ont toujours influencé les conceptions du passé. Si la peste n’est pas la cause de la chute de l’Empire d’Orient, en revanche elle a participé à son déclin.
La reconquête, la protection des nouveaux territoires (Afrique, Italie[59]), les guerres avec la Perse imposent à Constantinople un effort financier considérable. La dépopulation, la paupérisation font que la fiscalité parvient de plus en plus difficilement à remplir les caisses impériales. En outre, les salaires ont augmenté massivement avec l’effondrement de la population laborieuse, aussi bien les soldes des soldats que les salaires des fonctionnaires ou des artisans qui construisent les fortifications, d’où un accroissement des dépenses publiques. La pression fiscale s’accroît vivement sur une population considérablement réduite et une économie affaiblie, elle devient difficilement supportable (d’où des critiques, en particulier venant de Jean le Lydien).
Le grand rival de l’Empire romain d’Orient, l’Empire perse, est lui aussi fragilisé. Dès lors, les bouleversements géopolitiques de l’Orient au VIIe siècle pourraient s’expliquer par les ravages que la peste récurrente a provoqués depuis le milieu du VIe siècle : les conquêtes arabes à partir de 630, l’effondrement de l’Empire sassanide (la bataille d'al-Qâdisiyya en 636), les défaites de l’Empire byzantin (bataille de Yarmouk en 636, siège et prise de Jérusalem en 637 ; après un long siège – 674-678 –, Constantinople sera finalement sauvée après la destruction de la flotte musulmane, la ville et l’Empire survivront à un second siège en 717-718, et l’Empire durera encore sept siècles).
De même, en Occident, la peste rendrait compte du basculement de l’économie, et du pouvoir, du Sud vers le Nord. La peste justinienne est essentiellement méditerranéenne. Si jusqu’à la fin du VIe siècle, elle atteint la Gaule du Nord et de l’Ouest, à partir du début du VIIe siècle, l’Europe du Nord est épargnée. Alors que les circuits commerciaux méditerranéens sont affaiblis, voire se réduisent à un cabotage à courte portée, les circulations nordiques prennent de l’ampleur grâce aux marchands frisons et saxons, puis danois, scandinaves. La richesse devient moins méditerranéenne et davantage nordique, et les forces politiques qui se constituent dans cette Europe prennent leur envol. Elles aboutiront à la fin du VIIIe siècle à une esquisse de reconstitution de l’Empire romain d’occident, l’Empire carolingien.
Attribuer à la peste de Justinien le rôle de cause principale dans cette double évolution est sans doute exagéré, mais l’Empire byzantin a été affaibli, son déclin précipité. La Grande Peste a révélé que la tâche de reconstitution de l’Empire romain était un objectif de toute manière hors de sa portée, trop coûteux pour un empire affaibli. Ce n’est pas la seule cause de son déclin, et peut-être pas la cause principale (Jean-Noël Biraben[60]), le vers était dans le fruit antérieurement. Mais la Grande Peste a révélé ses fragilités, elle l’a poussé sur la pente déclinante. Sa faiblesse a laissé la place libre à l’expansion arabe et aux forces nouvelles qui se faisaient jour au Nord de l’Europe. La peste a aidé à l’accouchement de nouveaux rapports de force, politiques et économiques, elle ne les a pas générés.
La peste noire (1347-1352)
En 1347, il y avait six siècles que la peste n’avait pas frappé l’Europe et le bassin méditerranéen. Elle venait de Chine, elle a suivi les routes de la soie, elle est arrivée à Caffa sur la mer noire en 1347[61] d’où les galères génoises l’amènent à Constantinople, puis dans les ports méditerranéens, dont Marseille. Elle tue entre un tiers et 40% de la population européenne (voire, selon certaines estimations, plus de 50% : selon les régions le pourcentage varie entre un huitième et jusqu’aux deux-tiers). Il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour retrouver le niveau de population du début du XIVe.
Ce choc démographique massif s’est accompagné d’un effondrement mondial de l’économie, et en particulier de celle du continent européen et du bassin méditerranéen – et cela en deux ou trois ans. L’extension territoriale dans un laps de temps réduit, la mort à cette échelle et en si peu de temps, font qu’aucun autre épisode postérieur ne lui est comparable[62].
La peste noire de 1347-1348 inaugurait la deuxième grande pandémie pesteuse. Elle se prolonge par vagues successives jusqu’au XVIIIe siècle. Pour l’Europe occidentale, on observe 31 poussées entre 1347 et 1720. Jusqu’en 1534, les poussées sont assez régulières (tous les 9 à 11 ans), de cette date à 1683, les retours épidémiques sont moins réguliers (de 7 à 31 ans) avec des différences d’amplitude et d’expansion territoriale considérables. Pour la France, la période la pire est entre 1600 et 1640, surtout autour de et après 1630 (cette année-là on compte au moins cent villes ou bourgades frappées)[63]. Le ralentissement est net après 1684 (seulement trois chocs, localisés) et cette épidémie pluriséculaire se termine avec la peste de Marseille en 1720.
Revenons au XIVe siècle pour prendre le cas de la Provence. Après 1348, la peste frappe à nouveau en 1361, dans les années 1370, à l’été 1383, puis en 1390. Souvent, ce ne sont pas les mêmes localités qui sont affectées, mais plus de 40% des localités existantes en 1315-1316 auront disparu au milieu du XVe siècle tandis que, dans les villages qui subsistent, le nombre de « feux » par village diminue fortement[64]. En Bourgogne, on peut retenir le témoignage du Chroniqueur bourguignon qui résume ainsi le drame d’une localité de sa région : « En mil trois cent quarante et huit / À Nuits de 100 restèrent huit ».
Partout en France les villes et les campagnes se vident, les récoltes fondent, les activités cessent, la famine s’installe, massive, le prix du pain explose et, paradoxalement, le manque de bras qui explique l’effondrement des récoltes se double d’un chômage de masse lorsque les hommes ne trouvent plus à s’employer, l’activité ayant cessé.
Dans sa Chronique (celle qui lui est attribuée), Jean de Venette[65] décrit la peste de 1348-49 à Paris et plus généralement en France. Sa chronique est la plus complète sur le sujet. Une comète (ou « un autre phénomène formé d’exhalaisons d’air ») vers l’Ouest à l’heure de Vêpres, très lumineuse, bientôt désintégrée en avait – peut-être – été le présage. L’épidémie avait commencée « chez les infidèles », elle s’est répandue, par l’Italie, Avignon, la Gascogne, l’Espagne et l’Allemagne, jusqu’en France. Il décrit les symptômes (les bubons), la soudaineté de l’attaque et de la mort, les jeunes frappés plus que les vieux. La maladie venait « par contact et contagion, car l’homme en bonne santé qui visitait un malade n’échappait que de peu, et rarement, à la mort […] Et, très vite, de vingt hommes, il n’en restait pas deux vivants. » Réfléchissant sur les causes, il ne croit guère aux accusations d’empoisonnement des puits et fontaines, particulièrement contre les juifs – et il relate « la cruauté du monde [qui] se déchaina contre eux », les chrétiens les massacrant par milliers (en Allemagne et ailleurs où ils vivaient) –. « La cause en fut autre, peut-être la volonté de Dieu, peut-être des humeurs corrompues ou la mauvaise qualité de l’air ou de la terre. » Jamais dans le passé il n’y avait eu pareille mortalité (« Il y eut durant ces deux années un nombre de victimes tel qu’on ne l’avait jamais entendu dire, ni vu, ni lu dans les temps passés ») : « À l’Hôtel-Dieu de Paris, la mortalité était telle que souvent plus de 500 morts étaient portés chaque jour au cimetière des Saints Innocents pour y être ensevelis. » La peur de la contagion était telle que « les prêtres frappés de crainte s’éloignaient », se refusant à donner aux mourants les derniers sacrements, laissant à d’autres, plus courageux, cette tâche[66].
Lorsque la peste cessa, Jean de Venette observe que les villes et les campagnes étaient comme vides d’habitants. Mais il note la rapidité avec laquelle les mariages et la natalité s’accrurent par la suite. Sur le terrain économique, il observe aussi que, malgré l’abondance de toutes sortes de biens, il y eut une très forte inflation : « les prix de toutes choses doublèrent », ceux des denrées alimentaires et des objets manufacturés, ainsi que les salaires des mercenarii et les rémunérations des paysans, serfs et libres. À l’exception, précise-t-il, de certaines terres et maisons que le dépeuplement rendait superfétatoires. Le patrimoine de l’Église, des monastères s’accrut considérablement des héritages qu’ils reçurent lorsque les mourants recevaient l’absolution, leurs héritiers étant souvent morts avant eux[67].
Sur l’autre rive de la Méditerranée, nous avons le témoignage d’Ibn Khaldoun. En 1348, la peste le rattrape à Tunis (où il est né et où il fait ses études). Il a alors seize ans. Elle tue sa mère, puis son père, ainsi qu’une grande partie de sa famille, elle décime ses amis, l’élite intellectuelle de la ville, ses professeurs (« la grande peste qui enleva nos hommes les plus distingués, nos savants, nos professeurs »). Il livrera dans la Muqaddima (Prolégomènes) en 1377[68] une présentation des conséquences de l’épidémie de peste. Elle est particulièrement précieuse car Ibn Khaldoun n’est pas un simple témoin, mais un savant ès sciences sociales avant la lettre, un philosophe de l’histoire alliant connaissances historiques, sociologiques et économiques à la volonté de rechercher le pourquoi et le comment. Retenons trois points : 1) la peste est survenue en un temps de décadence universelle, alors que le monde ancien (les empires) était proche de sa fin ; 2) la peste a été une catastrophe effroyable à l’échelle mondiale et la description qu’il en donne est littéralement apocalyptique ; 3) il s’agit d’un processus de destruction créatrice cataclysmique, la crise accouche d’un monde nouveau.
Écoutons Ibn Khaldoun : « Une peste terrible vint fondre sur les peuples de l'Orient et de l'Occident. Elle maltraita cruellement les nations, emporta une grande partie de cette génération, entraîna et détruisit les plus beaux résultats de la civilisation. Elle se montra lorsque les empires étaient dans une époque de décadence et approchaient du terme de leur existence ; elle brisa leurs forces, amortit leur vigueur, affaiblit leur puissance, au point qu'ils étaient menacés d'une destruction complète. La culture des terres s'arrêta, faute d'hommes ; les villes furent dépeuplées, les édifices tombèrent en ruine, les chemins s'effacèrent, les monuments disparurent ; les maisons, les villages, restèrent sans habitants ; les nations et les tribus perdirent leurs forces, et tout le pays cultivé changea d'aspect »[69]. Mais si la Grande peste a détruit l’ancien monde, cela a permis une renaissance sur d’autres bases : « lorsque l’univers éprouve un bouleversement complet, on dirait qu’il va changer de nature, afin de subir une nouvelle création et de s’organiser de nouveau. » (ibid.). Et la compréhension de ce monde nouveau est le débouché de son histoire universelle.
Par-delà les témoignages et les analyses des contemporains, quelles furent les conséquences économiques et sociales de la peste noire ? Comment le monde en est-il sorti ?
Voyons d’abord le cas de l’Europe occidentale. L’expansion démographique et économique y avait été vive au XIIe et XIIIe siècle ; elle a abouti à ce que Pierre Chaunu avait nommé « un monde plein » et même, pourrait-on dire, un monde trop plein : une surabondance des humains par rapport à l’espace cultivable, pour l’état des techniques et des rapports sociaux (un taux de prélèvement trop élevé – encore accru fin XIIIe-début XIVe siècle – et employé non productivement, que ce soit pour la guerre, les édifices religieux ou le luxe). Les défrichages étaient arrivés à une limite, les nouveaux essarts n’étant plus réalisés que sur de mauvaises terres, d’où la chute des rendements agricoles et la hausse de la rente foncière (ce que validera la théorie ricardienne quelque siècles plus tard). Réciproquement, le travail ne valait pas grand-chose. C’était vrai des rémunérations des manouvriers ou des artisans et de leurs compagnons, et les serfs étaient souvent surnuméraires dans les domaines. À cela s’ajoutait l’arrivée du petit âge glaciaire[70].
Le monde trop plein et le changement climatique se sont conjugués pour produire des famines. La grande famine de 1315-1317 (après des précipitations trop importantes entre 1314 et 1316) est rapportée par la plupart des chroniqueurs. Elle est la plus importante à l’échelle européenne (surtout en Europe du Nord) depuis celle des années 1030. Elle a tué plusieurs millions d’êtres humains. Il faut encore ajouter les débuts de la guerre de Cent ans (Crécy, 26 août 1346).
|
La relation entre peste, guerre et famine est fréquente lors des épidémies pesteuses. Les épidémies se sont souvent développées à la suite de guerres (la peste suit les armées pendant la guerre de Trente ans, de Lyon à Mantoue, Milan, Venise et en Provence en 1628-1630), et c’est vrai aussi du choléra et particulièrement du typhus (la maladie de la misère, de la promiscuité, d’une hygiène déficiente, celle des armées mal entretenues, de la guerre, des camps de concentration). Les famines précèdent souvent les grandes épidémies, elles affaiblissent la résistance des populations, mais elles sont aussi souvent le résultat des mesures de fermeture prises pendant l’épidémie. En outre, pendant les années où l’épidémie sévit dans les campagnes, les travaux agricoles ne se font plus et les prix (surtout du blé) flambent, ce qui pèse sur les salaires réels. |
L’énorme choc démographique fait que l’on passe brutalement du « monde plein » au dépeuplement massif. Les conséquences économiques et sociales sont ambivalentes.
Après un tel choc démographique, le PIB chute brutalement à l’échelle européenne et mondiale. Mais le produit par tête augmente avec la productivité du travail et le rendement des terres. Comment se répartit entre les catégories sociales ce produit par tête plus élevé ?
Économiquement la paysannerie a probablement été la principale bénéficiaire de l’évolution. Les maîtres des terres doivent attirer de nouveaux bras ; ils ont dû souvent faire venir d’ailleurs – et même de très loin – des groupes entiers. Parfois l’ancien village dépeuplé a été abandonné pour en bâtir un autre. Les rentes, les droits seigneuriaux et les servitudes baissent pour retenir ou attirer les exploitants. Le prix des terres s’effondre. La dépopulation a conduit à l’accroissement de la taille des exploitations paysannes et à la réduction des essarts (les terres défrichées surtout depuis la fin du XIe siècle pour subvenir aux besoins de la population croissante). Les moins fertiles (ou les plus lointains) sont abandonnés, d’où un accroissement des rendements. L’alimentation des paysans, mais aussi des citadins des couches populaires, s’accroît et s’améliore : plus de céréales, de meilleure qualité, et plus de viande (le ratio nombre de bêtes / nombre d’hommes s’est beaucoup accru : on ne retrouvera une telle part d’alimentation carnée qu’à la fin du XIXe siècle).
On observe une forte accélération du mouvement d’affranchissement des serfs. Depuis le début du siècle, en France du moins, le servage était considéré comme dérogeant au droit naturel, le principe étant la franchise : en 1315, Louis le Hutin avait permis l’affranchissement des serfs du domaine royal moyennant finance (en outre, il incitait les seigneurs à en faire autant), et si la rentrée financière était clairement une motivation importante, le principe de liberté et le « privilège de la terre de France » étaient affirmés (« selon le droit de nature, chacun doit naître franc » ; n’est-ce pas le royaume des Francs ? la chose doit s’accorder au nom). Trente-deux ans plus tard, la peste noire renforce un processus initié antérieurement. Il faut cependant contraster les deux moments : avant la peste noire, les révoltes paysannes sont celles de la misère en relation au « monde plein » et l’affranchissement surtout une opération financière, après l’épidémie, si l’intérêt financier continue d’être un mobile pour les princes et les seigneurs, l’affranchissement tient à un nouveau rapport de force d’une main d’œuvre servile raréfiée, et les révoltes, souvent celles de libres, se font souvent contre le raidissement des puissants.
Les salaires nominaux ont augmenté fortement. Dans les villes, on ne trouve plus de main d’œuvre et les employeurs doivent consentir des augmentations souvent considérables. Dans les villages, les champs se sont vidés des travailleurs, la population servile et celle des manouvriers a fondu. L’effondrement de l’offre de travail fait basculer les rapports de force dans les négociations. On a longtemps cru que les salaires réels avaient eux aussi augmenté pendant les décennies qui ont suivi l’épidémie. Il semble cependant que l’inflation ait rogné l’accroissement des salaires réels. En Angleterre elle est forte pendant les trente années qui suivent la peste noire, les salaires réels auraient même baissé jusqu’à la fin des années 1360 (ils augmentent après 1370)[71]. En France, l’inflation est forte également. Les augmentations des salaires nominaux se traduisent par la hausse des prix, en particulier des céréales. En outre, à l’inflation d’origine salariale s’ajoute celle due aux mutations monétaires (des dévaluations au sens actuel) que la guerre de Cent ans impose[72]. Même si le taux de salaire réel n’a pas augmenté, ou moins qu’on ne l’a cru longtemps, il reste que le chômage a disparu, que les journées de travail s’allongent et donc que le revenu des salariés ruraux et urbains augmente. Mais faire des lendemains de la Grande peste « l’âge d’or des travailleurs » est clairement exagéré.
D’autant que les changements ne se sont donc pas faits sans conflits sociaux. Confrontés à la hausse des salaires, les employeurs se plaignent et s’organisent. Les réactions des autorités locales (les municipalités en Italie) et à l’échelle des royaumes ne se font guère attendre. En France, en Espagne[73] et en Angleterre, le contrôle des travailleurs et des salaires se met en place. Dans ce dernier pays, en 1349, l’Ordinance of Labourers (complété par le Statute of Labourers de 1351) impose à toute personne de moins de 60 ans, et qui n’a pas d’autres moyens de vivre, de travailler au service de toute personne qui le requerra (« be required to serve, he shall be bounden to serve him which so shall him require ») à un salaire égal à celui d’avant la peste, sous peine de prison, interdit l’assistance des pauvres aptes au travail, l’embauche de travailleurs en excès et met en place un contrôle des prix des biens de premières nécessité afin qu’ils soient raisonnables, les profits des commerçants pas excessifs (sous peine de rembourser le double). Les effets de ces ordonnances semblent avoir été limités peut-être à cause des révoltes qu’elles ont contribué à susciter.
Les tensions sociales débouchent en effet sur des révoltes d’une force exceptionnelle tout au long de la fin du XIVe siècle. Partout la répression fut terrible. À ce prix, en définitive, l’ordre politique, social et religieux a pu être maintenu.
En 1349, le mouvement des Flagellants déferle dans toute l’Europe, et particulièrement en Allemagne. Leur but est de se purifier et de purifier le peuple, les seigneurs et les clercs en attendant l’Apocalypse. Ils participent activement aux massacres de juifs et se livrent à des exactions et des pillages contre les moines. Ils seront excommuniés par l’Église. Les jacqueries, les insurrections se multiplient en Europe occidentale, dans les campagnes comme dans les villes, en Italie, en France, dans les Flandres, en Angleterre. En 1355-58, c’est la révolte d’Etienne Marcel à Paris tandis que la Grande Jacquerie de 1358 soulève les campagnes du nord de la France, brûle les châteaux, de l’Artois à l’Île de France, de la Normandie à la Champagne[74]. On est seulement dix ans après la peste noire : ces révoltés sont des survivants.
On peut même parler d’une révolution européenne autour de l’année 1380[75], soit une génération après la Peste noire, une révolution avortée. Les contemporains ont conscience de cette mutation. Ainsi Jean de Venette, explique qu’après la peste il y eut une explosion de la natalité et que la nouvelle race est marquée par la cupidité, l’avarice et l’envie, entendons par là la volonté d’imposer un nouvel ordre des choses ![76] En 1378-1383, ce sont les révoltes des Tuchins en Languedoc et des Maillotins à Paris comme en Normandie, en Champagne, en Picardie (après la famine de 1382). À la même époque éclate la révolte populaire (prolétarienne même) des Ciompi à Florence (1378). Trois ans plus tôt, la cité, guelfe pourtant, était entrée en guerre contre la papauté (la Guerre des huit saints, le pape Grégoire XI étant établi à Avignon), avec sur ses bannières rouges, inscrit en lettres blanches, le mot Libertas. Florence placée sous interdit avait réagi par une flambée anticléricale majeure, des assassinats de prêtres, la destruction du palais de l’Inquisition, la suppression des tribunaux ecclésiastiques, des confiscations massives des biens du clergé et le retour en force des Flagellants, des confraternités et des fratelli, tous plus ou moins hérétiques. L’insurrection avait gagné toutes les villes de l’État pontifical avec des revendications de « républicanisme à l’antique ». Rappelons qu’en 1348 la peste aurait tué, selon Boccace, 100.000 personnes à Florence (une exagération, Florence ne comptant alors guère plus que ce nombre d’habitants) et que l’épidémie est revenue en 1363, en 1374. En 1379 à Gand, se déclenche l’insurrection des Chaperons blancs (des guildes guerrières de tisserands et d’autres métiers), elle essaime dans toute la Flandre (Bruges, Damme, Courtrai) mettant le pays en état de guerre.
En Angleterre, en 1381, menées par Wat Tyler et Jack Straw, les masses paysannes ainsi que les travailleurs urbains et ruraux se révoltent après que Richard II ait instauré un nouvel impôt par tête (la poll tax, c’était la troisième taxe de ce genre en quatre ans). Ils étaient enflammées par les prêches de John Ball et influencées par la doctrine d’égalité et de pauvreté évangélique de John Wycliffe et par celle des Lollards ou des « poor priests » qui sont ses disciples égalitaristes et millénaristes et qui, dès 1380, prêchent sa doctrine dans les campagnes anglaises. Les révoltés venaient de milieux différents, des marginaux, des pauvres, des paysans, libres ou encore asservis, les artisans et compagnons des métiers urbains, des couches intermédiaires, mais aussi des marchands. Contrairement à ce qu’écrivent les chroniqueurs de l’époque, ils étaient souvent bien armés et bien organisés. Une de leurs revendications principales était l’abolition du Statute of Labourers de 1351, mais les causes sont des plus diverses, fiscalité, cherté, politique urbaine, exactions seigneuriales, haines sociales (les nobles, les hommes de loi), religieuses (redoublée de considérations économiques pour ce qui concerne les juifs). Là-dessus soufflait souvent un fond de revendications égalitaristes (John Ball) et des prédicateurs condamnaient l’Église pour ses richesses. Le millénarisme religieux est très présent comme on le voit aussi avec la multiplication des bégards et des béguines plus ou moins hérétiques, l’essor du mouvement du Libre-Esprit, des Turlupins (la Compagnie de pauvreté largement représentée à Paris, mais aussi en Artois et en Flandres). Ils seront pourchassés par l’Inquisition, accusés par celle-ci de tous les vices, de pratiquer la nudité, le communisme des femmes et l’amour libre.
Les révoltes furent écrasées, non sans que soient menées de véritables guerres.
Patrick Boucheron[77] se demande « pourquoi, après une telle épreuve [la peste noire] au cours de laquelle meurt près de la moitié de la population européenne, tout continue comme avant ? Pourquoi croit-on au même Dieu ? Pourquoi obéit-on au même roi ? »[78]. Il affirme même « fondamentalement en Europe, la pandémie ne change rien. Comme si ce monde qui a été terrorisé par la peste ne doutait pas de lui-même et repartait sur les mêmes bases ». C’est sans doute exagéré. Certes, le monde occidental a tenu dans les tempêtes du XIVe siècle, et cela en grande partie parce que les bases de la société étaient fortement structurées par le pouvoir de l’Église, mais il n’est pas resté statique, loin de là.
Un nouvel ordre productif et politique émerge et il va s’avérer hautement performant. Sur le terrain politique, un système qu’on peut qualifier de « monarchie féodale », une phase de transition entre la féodalité et l’État monarchique, s’est mis en place et va se consolider. Les trente années qui suivent la Grande Peste ont été des années difficiles, la guerre est revenue périodiquement dévaster telle ou telle région[79], la récurrence de la peste (en Angleterre 1360, 1369, 1375[80]) est venue compromettre la reprise démographique (mais les morts diminuent à chaque épidémie) et économique, les révoltes ont fait vaciller l’ordre social, mais peu à peu les transformations sociales (le recul du servage) et l’amélioration des conditions de vie dans les campagnes et les villes commencent à développer leurs conséquences positives en termes de croissance. En tous cas elles préparent, tout particulièrement en Italie, à partir de Florence et de la Toscane, ce que sera la Renaissance dès les années 1430.
Avec Werner Sombart et Fernand Braudel, on peut dater de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle l’émergence d’un capitalisme commercial et manufacturier en Italie, en Flandres, aux Pays-Bas. Même si les Cités-États, et plus généralement les villes-pôles, avec leurs capitaux, leurs banques, leurs marchands, leurs flottes comme Venise, Gênes, Florence, Anvers, les villes de la Ligue hanséatique, Amsterdam restent le cœur de ce capitalisme, les espaces économiques nationaux émergent et ces cités commencent à être subordonnées aux États-nations. À la veille de l’épidémie, une crise financière majeure à Florence (1340-1346, avec la faillite des banques Bardi et Peruzzi) survenant après cinq années florissantes (1355-1340), avait provoqué une désintégration des circuits vénitiens, de l’Italie du Nord et une crise européenne. Si Florence et Venise rebondissent après cette double crise économique et sanitaire, les Cités-États ne retrouveront pas leur hégémonie antérieure. L’avenir est aux grandes monarchies et à un capitalisme à leur échelle, et les Cités-États tireront leur richesse en se mettant à leur service plutôt qu’en les exploitant.
Hors d’Europe, la peste noire a pu être considérée comme responsable de ruptures géopolitiques majeures. Jean Noël Biraben a étudié les conséquences économiques de l’épidémie dans le monde arabe[81]. La peste s’y est doublée d’une famine générale. Dans les campagnes, les semailles ou les moissons ne sont pas faites, les blés pourrissent sur pied faute de bras et les prix augmentent, ils vont jusqu’à doubler. L’eau n’arrive plus dans les champs, les appareils élévatoires ayant cessé de fonctionner. À Gaza, en 1349, seulement la moitié de la récolte habituelle sera obtenue. Les troupeaux sont livrés à eux-mêmes, les pêcheries abandonnées. Faute de main d’œuvre, on tente parfois, sans succès, de recourir à l’armée. Les transports ne se font plus, les routes sont parsemées de cadavres d’hommes et de chameaux. Dans les villes, les blés surtout, les vivres en général, manquent cruellement, les marchés ne se tiennent plus ou les étals sont vides, les activités artisanales et commerciales disparaissent avec la mort de ceux qui s’y livrent. En outre, il n’y a plus de débouchés pour les produits manufacturés et cela d’autant moins que les biens des morts sont vendus à l’encan (ce qui sera d’ailleurs une cause de mortalité renforcée pour les acheteurs), les prix des vêtements, de la lingerie, des objets ménagers divers, des meubles s’effondrent au cinquième de leur valeur. Les survivants perdent leurs moyens d’existence et souvent le pillage devient leur seul moyen de survie.
Élargissons la focale. Boucheron observe : « Après le passage de la peste, la seconde moitié du XIVe siècle verra s'effondrer le règne turco-mongol de la Horde d'or, ainsi que la disparition des Yuan, au profit de la dynastie Ming, en Chine. [...] Il est fort probable que la peste fasse rupture. » Observons cependant que, en ce qui concerne la Chine, s’il y eut rupture politique, les révoltes liées à la crise économique et sociale en lien avec la peste noire emportant l’ancienne dynastie, le redressement sera effectif dès les débuts du XVe siècle[82]. Quant à l’effondrement de la Horde d’or, s’il est difficile d’appréhender les conséquences économiques de la peste noire, il reste que cette épidémie a été particulièrement virulente en Asie centrale (n’oublions pas que l’armée mongole affaiblie par la peste a été obligée de lever le siège de Caffa et que, de là, elle s’est répandue sur toutes les rives de la Méditerranée) que l’Empire mongol s’est (immensément) développé au cours du XIIIe siècle – et a tenu – grâce à des formes diverses de prédation (et d’une fiscalité prédatrice élaborée) et que la mortalité de masse a provoqué une crise du prélèvement, fragilisant l’ensemble : si entre 1275 et 1300 l’Empire mongol est à son apogée, en 1360, il est devenu marginal en Asie (cependant Tamerlan tentera – et réussira pendant quelques décennies – de reconstituer un Empire turco-mongol à la fin du XIVe siècle).
La pandémie de la Grande peste a causé un ébranlement mondial majeur. Elle a révélé les failles des sociétés. Si le choc a partout été immense, les structures économiques, sociales ou politiques les plus fragiles se sont effondrées, celles de l’Europe ont résisté en évoluant et, à terme, en ont même peut-être bénéficié. L’épidémie a été un accélérateur de tendances antérieures.
LES VILLES DE LA PESTE À L’ÂGE CLASSIQUE
Les capitales et les grandes villes frappées les unes après les autres de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe nous permettent de cerner une « ville de la peste » (Michel Foucault, Surveiller et punir). Pour ne retenir que les « grandes pestes » – car ces villes furent frappées à plusieurs reprises – citons Venise en 1575, Lyon et Montpellier en 1629, Mantoue et Milan en 1629-1630, Naples en 1656, Londres en 1665, Marseille en 1720. Le phénomène semble avant tout urbain, pourtant les campagnes ne sont pas épargnées. Si l’épidémie y est moins mortifère, sans doute est-ce dû à la faible densité et à l’isolement relatif. Surtout, la mort à la campagne a moins attiré le regard des observateurs. Il reste que, par exemple, la peste de Naples de 1656 frappe l’ensemble du royaume, villes et campagnes, et que celle de Marseille en 1720 ravage l’ensemble de l’arrière-pays et une part importante de la Provence urbaine et rurale[83].
Même s’il faut se méfier des sources littéraires – descriptions ou fictions – et iconographiques qui nous offrent souvent une présentation apocalyptique, un tableau « clinique » de ces pestes urbaines et de leur dynamique peut être synthétisé : un mort, puis deux ou trois, cent par jour, et la courbe exponentielle grimpe à mille, voire plus quotidiennement ; les hôpitaux débordés, l’apparition brutale des symptômes (fièvre, gonflement des ganglions lymphatique, les bubons, toux), les agonisants et les morts confondus s’entassant dans les rues, sur les places, l’odeur de charnier, les charrettes ou tombereaux des « corbeaux » ramassant les cadavres, les morts jetés par les fenêtres ou descendus par une corde à poulie, celle-là même qui fait remonter les paniers de nourriture, les fosses communes, véritables charniers, la chaux vive et, pour les morts enterrés individuellement ou en petit nombre, généralement ni cercueil, ni linceul[84]. Ce tableau est bien connu, souvent illustré par les peintres. Je voudrais mettre l’accent sur deux aspects : la clôture et l’inégalité.
Un monde fermé, une société contrôlée
L’existence de l’épidémie admise par les autorités, commence le temps de la suspension des libertés, particulièrement celle d’aller et de venir, de la fermeture autoritaire et du contrôle des populations. Souvent ces politiques interviennent après un certain délai, les autorités cherchant à cacher l’épidémie. Les villes empestées se mettent ou sont mises en état de ville assiégée[85]. La clôture est imposée à l’intérieur comme vis-à-vis de l’extérieur, du fait de la municipalité ou imposée par les autorités supérieures. Si dans un premier temps on expulse les « indésirables » tandis que les riches s’enfuient, rapidement ne peuvent sortir ni les hommes ni les marchandises et personne n’entre (les subsistances sont achetées hors les murs en des lieux spéciaux). Les ports sont bloqués. Toute navigation sortante est impossible du fait du blocus et simplement parce que les navires battant pavillon de la cité empestée sont partout interdits et la navigation entrante très réduite. Les routes se ferment, des murs s’édifient, des lazarets ou pest houses où sont enfermés les voyageurs s’édifient.
Rocco Benedetti (un notaire vénitien) compare le lazaret de Venise lors de la peste de 1575-1577 à l’Enfer de Dante : « « Cela ressemblait à l’Enfer. Toute la journée, on voyait des nuages de fumée qui se répandait dans l’atmosphère à cause de la crémation des corps. On était à trois ou quatre par lit et on ne faisait que sortir des morts des lits pour les jeter dans des fosses. Bien souvent, les agonisants et ceux qui ne parlaient ou ne bougeaient plus étaient expédiés par les “corbeaux” [les pizzigamorti] sur le tas de cadavres »[86]. Lors de l’épidémie de choléra, en 1830, Flaubert est enfermé dans le lazaret de Beyrouth. Il écrit : « Nous sommes claquemurés dans une presqu’île et gardés à vue. L’appartement dans lequel je t’écris n’a ni chaises, ni divans, ni tables, ni meubles, ni carreaux aux fenêtres. On fait même petits besoins par la place des carreaux desdites fenêtres »[87]. Voyager suppose des « billets de santé », des sauf-conduits, ces « billettes » dont on somme Angelo dans le Hussard sur le toit de Giono[88] de se pourvoir lors de cette même épidémie de choléra en Provence en 1832.
Au cours des siècles, les techniques de clôture et de contrôle des populations se sont perfectionnées. Le premier lazaret destiné à mettre en quarantaine les pestiférés est créé à Venise en 1423, le deuxième est à Gênes en 1467, celui de Milan date de 1488. Le premier lazaret marseillais daterait de 1526 (peut-être un premier dès 1477). Paris n’est doté d’un lazaret (l’hôpital Saint Louis) qu’en 1607[89]. Lyon disposera d’un hôpital pour pestiférés servant de quarantaine dès 1476-1509[90] et les lazarets se multiplièrent lors de la peste de 1628[91]. Londres dispose de quelques cabanes au milieu des champs lors de l’épidémie de peste de 1625 (antérieurement la ville avait été frappée par la peste en 1594 et en 1603) et en 1665, la capitale ne compte que cinq pest houses qu’on ouvre quand l’épidémie menace. On peut multiplier les exemples : Nantes, 1569, Le Havre, une simple cabane en bois en 1596, Toulon, 1657. Peu à peu, épidémie après épidémie, les villes s’organisent, contrôlent mieux les déplacements, enferment, surveillent, administrent, secourent, et ce n’est qu’au milieu du XVIIe siècle que se précise l’organisation de la « ville de la peste », étant entendu que la réalité reste à distance de « l’idéal-type » foucaldien.
La fermeture concerne aussi, au sein des villes, les lieux publics, écoles et collèges, parfois même (lors des épidémies tardives) les églises. Sont interdits les spectacles susceptibles de provoquer des attroupements, les banquets, parfois les prêches en plein air, les tavernes et cabarets sont fermés, les mendiants et vagabonds pourchassés. Les déplacements sont contrôlés, particulièrement la nuit, souvent alors interdits (couvre-feux). Lorsque la peste s’est déclarée dans une famille, tous sont enfermés au risque de les faire périr tous (c’est d’ailleurs le cas général), la maison est marquée d’une croix rouge (en Angleterre avec l’inscription « Lord, have mercy upon us » ) ou blanche (certaines régions en France), surveillée par des gardes municipaux, approvisionnés par ceux-ci ou d’autres ravitailleurs. Samuel Pepys (7 juin, p. 95) et Daniel Defoe observent tristement ces maisons et ces familles condamnées lors de la peste de Londres en 1665. Selon ce dernier il y aurait eu 10.000 maisons infectées et fermées (p. 160), et il raconte les stratégies employées pour en sortir. Les maisons sont « désinfectées » (par des « parfumeurs » municipaux à Lyon). Des quartiers peuvent être totalement bouclés, en murant les rues ou en installant des barrières. Notons que le confinement peut être volontaire de la part de riches bourgeois ou aristocrates, propriétaires d’hôtels particuliers aptes à tenir un véritable siège[92].
Pour Foucault[93], la « ville de la peste » devient « cet espace clos découpé, surveillé en tous ses points, où les individus sont insérés en une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où tous les événements sont enregistrés, ou un travail ininterrompu d'écriture relie le centre et la périphérie, où le pouvoir s'exerce sans partage, selon une figure hiérarchique continue, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts – tout cela constitue un modèle compact du dispositif disciplinaire. « À la peste répond l'ordre ». Selon Foucault, l’idéal-type de la ville de la peste peut s’analyser, sans doute trop systématiquement[94], comme une première expérience de panoptisme destinée à éviter la propagation de l’épidémie, les pillages et vagabondages et à imposer un dispositif disciplinaire : interdiction sous peine de mort de sortir de la ville et de son terroir, quadrillage rue par rue, inspection maison par maison[95], stricte limitation ou interdiction des déplacements dans la ville (ne circulent que les syndics, les intendants, les gardes et les « corbeaux »), purification des maisons, surveillance des aliments, de la circulation des marchandises, assurer les approvisionnements (par des poulies et des paniers, des petits canaux de bois entre l’extérieur et l’intérieur). « Le regard partout est en éveil : “un corps de milice considérable, commandé par de bons officiers et gens de bien”, des corps de garde aux portes, à l’hôtel de ville, et dans tous les quartiers pour rendre l’obéissance du peuple plus prompte, et l’autorité des magistrats plus absolue, “comme aussi pour surveiller à tous les désordres, voleries et pilleries”. Aux portes, des postes de surveillance ; au bout de chaque rue, des sentinelles. » [96]
Déjà, un an après la parution de son célèbre roman La peste (1947), Albert Camus avait explicité le lien entre la peste et la dictature dans sa pièce, L’état de siège : dans une ville que la peste ravage, un tyran prend le pouvoir en s’appuyant sur la peur et la nécessité d’enrayer l’épidémie. Il suspend les libertés, instaure une législation oppressive, impose l’arbitraire (un couple d’amoureux se révoltera, l’homme y perdra la vie, la femme survivra et la ville sera sauvée, la peste s’enfuira).
C’est probablement à Marseille en 1720[97] que la réalité se rapproche le plus de l’idéal-type foucaldien.
|
Le Grand Saint Antoine arrive à Marseille le 25 mai avec une cargaison de tissus de grande valeur, l’essentiel était destiné à la foire de Beaucaire et une fraction appartenait au premier échevin, Jean-Baptiste Estelle. Mais la peste est à bord. Neuf matelots et le chirurgien en sont morts. Livourne avait interdit l’accostage, mais laissé repartir le navire en ne mentionnant que la présence de « fièvres pestilentielles » (et non pas la peste), ce qui était pour le moins insouciant. Les règles de quarantaine des navires, des équipages, passagers et cargaisons à Marseille étaient particulièrement strictes et efficaces. Après tergiversations, elles vont être pour le Grand Saint Antoine abusivement allégées par le Bureau de santé : le bateau étant suspect, il aurait dû être mis en quarantaine à Jarre, on le laisse se rendre à Pomègue, les passagers sont mis en quarantaine aux Nouvelles infirmeries d’Arenc, un lazaret nouveau (il date de 1663) à 300 mètres des remparts de la ville, sans précautions particulières, et on abrège leur quarantaine et surtout une partie des marchandises, elles aussi en quarantaine aux Nouvelles infirmeries, va en sortir rapidement en contradiction avec les règlements, et transmettre la peste. Les premiers cas apparaissent fin juin – début juillet. À la fin du mois et en août l’épidémie explose. Négligence ou influence des propriétaires des marchandises, en particulier de certains échevins ? Le capitaine Jean-Baptiste Chataud sera emprisonné au château d’If pendant près de trois ans. Estelle, d’abord suspecté, sera finalement anobli deux ans plus tard (pour son comportement courageux pendant l’épidémie). |
Un matelot meurt aux infirmeries le 27 mai, un surveillant y meurt le 13 juin. Les médecins se gardent de parler de peste. Celle-ci arrive en ville le 20 juin et, dès lors, les morts se succèdent rapidement. Ce n’est que le 9 juillet que les médecins Peyssonnel père et fils posent le diagnostic. La maladie se répand rapidement.
Le 30 juillet, le Parlement de Provence interdit toute relation commerciale avec la ville, fait fermer les portes, barricader les faubourgs, chasser les vagabonds et les juifs. La peste s’étendant, le terroir est fermé par un blocus militaire, maritime et terrestre (avec 89 postes de gardes). Un quart de l’armée est mobilisé pour encercler Marseille et sa région, la flotte de Méditerranée veille au respect du blocus des ports de Marseille et Toulon. La plus grande partie de la Provence, en effet, est contaminée d’Aix à Arles et Saint-Rémy, d’Apt à Toulon, vers l’Ouest le Languedoc et le Gévaudan. Même si on a construit le « mur de la peste » pour isoler le Comtat Venaissin, Avignon et Orange sont atteints ainsi que le Vivarais. Classiquement, les groupes à risque sont soumis à une quarantaine, les maisons pestiférées sont fermées et marquées d’une croix rouge, on crée de nouveaux lazarets, des hôpitaux spécialisés (de véritables mouroirs) et des maisons de convalescence. L’épidémie continue de progresser.
Début septembre, au sommet de l’épidémie, le pouvoir central (c’est l’époque de la régence de Philippe d’Orléans) prend en main la lutte contre l’épidémie et les débordements de toute nature qui sont à craindre. La militarisation de la cité apparaît nécessaire pour éviter la contagion et maintenir l’ordre. Un commandant militaire est nommé le 4 septembre (Charles Claude Andrault de Langeron) doté des pleins pouvoirs. La circulation des hommes et des marchandises est strictement contrôlée, tout déplacement suppose une « billette » de bonne santé signée par un surveillant de quartier, les espaces publics (y compris les églises) sont fermés, une « police de la peste » est créée (elle sera temporaire), 300 commissaires de la peste sont recrutés, les militaires cernent la ville, patrouillent dans la ville quadrillée quartier par quartier, puis rue par rue, surveillent les comportements estimés dangereux, les lieux supposés de débauche, traquent les « sans-papiers », une justice d’exception expéditive est mise en place. Si l’idéal pré-panoptique n’est pas atteint – la description de Foucault restant un point-limite que l’Ancien Régime ne saurait atteindre – on s’en rapproche. Et l’on se surprend à penser que la ville de la peste idéale ressemble à la « safe city » que les techniques de surveillance d’aujourd’hui permettent de réaliser.
L’épidémie de covid-19 a remis à l’ordre du jour la très ancienne formule hippocratique (peut-être est-elle de Gallien) toujours répétée dans les ouvrages sur la peste, surtout au XVIIe siècle[98] « Cito, longe, tarde » (« Cito, longe fugeas et tarde redeas » : « pars vite, loin, et reviens tard »)[99]. Déjà Boccace nous avait montré de riches patriciennes (accompagnées de quelques compagnons) quittant Florence pestiférée en 1348 pour s’enfermer dans une belle résidence campagnarde et se conter des histoires ; elles constitueront le Décaméron.
Malgré la mise en quarantaine des villes de la peste, ou dans la crainte qu’elle soit mise en place, tous ceux qui le peuvent cherchent à quitter la ville au plus vite, gagnent leurs résidences secondaires. Bien entendu, il s’agit d’abord des souverains, des parlements, des corps constitués et autres notables, des classes aisées. En 1585, la peste ravage Bordeaux. Montaigne en était le maire, il n’hésita pas longtemps avant de fuir la ville. Devant y revenir en juillet pour l’élection d’un nouveau maire, il préféra rester aux portes de la ville « vu le mauvais état où elle est ». Pendant la Grande Peste de Londres, Pepys (29 juin, p. 112) constate qu’à la Cour tout le monde fait ses bagages pour la campagne et Defoe décrit les embouteillages de charrettes de déménagement des riches londoniens se hâtant de fuir, munis des sauf-conduits indispensables (obtenus d’abord aisément, du moins dans leur cas), avant que les routes se ferment aux habitants de la ville pestiférée. Defoe (p. 52) observe que ces riches fuyards sont d’abord essentiellement des oisifs ou des hauts fonctionnaires, les commerçants, les hommes d’affaires devant rester pour gérer leurs entreprises. Ce qui montre que toute activité ne cesse pas, du moins jusqu’au paroxysme de la crise sanitaire. On retrouve pratiquement partout le même phénomène de fuite rapide des classes aisées. Ainsi à Marseille, le négociant Roux raconte que 30 000 personnes, voire 40 000 (sur une population estimée à 90 000 habitants) auraient quitté la ville dès la fin juillet[100]. L’annonce des confinements lors de la covid-19 a de même provoqué d’immenses embouteillages à la sortie des métropoles.
La possibilité de partir « vite et loin » est réservée aux plus fortunés. Les pauvres restent, pour l’essentiel, sur place ou ne partent que tardivement. Ceux qui ont un emploi, même très précaire, s’y accrochent, les autres survivent comme ils peuvent dans leur quartier prenant parfois des risque inouïs (les pires emplois sont évidemment ceux de « corbeaux », mais les infirmiers n’ont guère plus de chance de survie) et nombreux sont ceux qui vivent de la charité privée, paroissiale ou des subsides municipaux. En ce qui concerne l’Angleterre, le Settlement Act de 1662 (donc trois ans avant la Grande Peste) systématise des règlements datant des Tudor. Il interdisait aux pauvres de quitter leur paroisse, sauf à se munir d’un « settlement certificate » garantissant que celle-ci paierait les frais de leur retour. Defoe note que les indigents sans domicile légal (« legal settlement ») et/ou sans ce certificat étaient condamnés à rester sur place, ne pouvant que survivre des subsides municipaux. Quant aux autres travailleurs pauvres, le désespoir aidant, nombreux furent ceux qui finirent par s’enfuir : « la mort les surprenait alors sur la route et ils ne furent plus que ses messagers », en s’enfuyant ils répandirent la peste jusqu’aux limites du royaume (p. 158). Une même observation peut être faite pour l’épidémie de choléra à Paris en 1832[101] : nombreux furent les travailleurs qui, devenus chômeurs, retournèrent au village (comme c’était alors l’habitude). On peut suivre les traces de ces chômeurs car nombreux sont ceux qui moururent le long des chemins qui les ramenaient chez eux, jusque dans la Creuse. Ces déplacements d’ouvriers sans emploi supposaient qu’ils soient en règle avec leur livret ouvrier (sinon, le risque était d’être enfermé comme vagabond). Le même phénomène s’observe alors en Angleterre où ne peuvent se déplacer que les travailleurs en règle : si depuis 1832 (Reform Act) l’assistance à domicile des pauvres a été supprimée, elle a été remplacée par l’enfermement dans une workhouse. Quarantaine ou workhouse, la mobilité de l’indigent restait très contrainte.
Les inégalités dévoilées et exacerbées
L’inégalité devant l’épidémie est attestée depuis la « peste » d’Athènes[102] et la peste noire en passant par toutes les épidémies des Temps modernes qui ravagent les villes les unes après les autres, enfin le choléra, le typhus et jusqu’à nous. Les pauvres deviennent plus pauvres et leur nombre augmente. C’est le cas avec la covid-19. La Banque mondiale (7 octobre 2020) estime que la grande pauvreté (moins de 1,90$/jour) devrait s’accroître d’ici fin 2021 de 150 millions de personnes dans le monde. Aujourd’hui comme hier, lorsque l’économie se pétrifie, les pauvres perdent leurs emplois et donc leurs sources de revenus. Ils n’ont ni épargne, ni capital, leur pouvoir d’achat devient quasi inexistant, et lorsqu’ils avaient réussi à mettre de côté de modestes sommes, elles sont rapidement épuisées. Leur endettement augmente auprès des usuriers ou des commerçants. Cet effondrement se prolonge alors bien au-delà de la fin de l’épidémie. Souvent, chassés de leur logement ou de leur lopin de terre, ils voient leur famille s’enfoncer encore davantage dans la misère et leur précarité peut être renforcée pendant plusieurs générations. Souvent, ceux qui avaient réussi à accéder aux premiers échelons des classes moyennes sont brutalement rejetés vers les niveaux les plus bas dont ils avaient réussi à grand peine à s’extraire. D’où la recrudescence de la criminalité et surtout la peur des notables ou des plus riches qu’il en soit ainsi, ou que cette plèbe se révolte (ce qui explique – certes en partie seulement – les subsides versés aux pauvres).
La pire des inégalités est celle devant la mort. Ce sont les pauvres, toujours, qui payent le plus lourd tribut en nombre de morts. Pour les maladies contagieuses, le choléra par exemple, il faut incriminer les conditions de vie, les taudis, l’entassement, l’absence d’hygiène. Pour la peste, l’explication tient au lien entre ces conditions d’existence, le rat et les puces qui infectent l’homme après l’avoir été par le rongeur[103]. Elle tient aussi à ce que les pauvres privés de leurs précaires moyens de subsistances souffrent de malnutrition, voient leur état de santé se détériorer ou meurent littéralement de faim.
L’épidémie de peste ou de choléra frappe d’abord les quartiers où les indigents sont entassés, et elle y prend une ampleur considérable. De là, elle gagne les quartiers résidentiels, et c’est pour cela que les autorités sont particulièrement vigilantes à ériger des murs de séparation, à mettre en quarantaine ces quartiers pauvres empestés : il s’agit avant tout de protéger les catégories sociales aisées. Et l’inégalité se poursuit au-delà de la mort : les membres des classes supérieures sont enterrés individuellement, avec un minimum de cérémonie. Les pauvres sont ramassés « à la pelle » (tirés par des crocs) et jetés dans les fosses communes avec, au mieux, une prière et un signe de croix collectif[104].
Une des pires épidémies du XVIIe siècle est celle de Naples et du Royaume de Naples en 1656-1657[105]. Elle tue près de la moitié des habitants (200.000 personnes sur une population de 400.000 ou 450.000 habitants à Naples – avec un sommet à 20.000 morts par jour –, 800.000 pour le reste du royaume, voire 1.250.000 pour l’ensemble, soit entre 43% et 50% de la population[106]). Ces morts se recrutent essentiellement chez les pauvres lazzari entassés dans les bassi insalubres, chez les réfugiés (des campagnards miséreux) très nombreux après l’éruption du Vésuve en 1631. Dans les quartiers espagnols, le quartier Lavinaio densément peuplé à proximité du port, autour de la Piazza Mercato (d’où était partie la révolte populaire de Masaniello en 1647, d’où les rumeurs accusant les Espagnols) s’entassent les agonisants et les morts par milliers. Si les pauvres fournirent les principaux bataillons de morts, la bourgeoisie, la noblesse et les élites culturelles furent durement frappés et il n’y eut guère de survivants dans les couvents[107].
On retrouve une configuration voisine lors de la grande peste de Marseille en 1720. C’est dans la vieille ville insalubre, au nord-est du port, que la mort frappe le plus, là où l’épidémie partie des marchandises sorties du Grand Saint Antoine s’est d’abord diffusée. Un quartier aux rues étroites où se trouvent les artisans, de nombreux commerces, mais aussi où les populations pauvres sont concentrées. À l’extrémité nord du quartier se trouve l’esplanade de la Tourette d’où le chevalier Roze, commandant un détachement de forçats (encadrés par des soldats), fait enlever mille deux cents cadavres entassés, pourrissants (sur la troupe de 150 hommes, il y aura quatre survivants, dont le chevalier). Une des premières mesures (30 juillet) prises par les échevins est l’expulsion des vagabonds et mendiants et l’enfermement des indigents à la Charité. Il n’y aura pas de famine, mais un début de disette : les prix du pain, de la nourriture augmentèrent, des troubles s’ensuivirent[108] qui forcèrent les autorités à multiplier les distributions gratuites.
Pendant cette même épidémie, à Arles, le quartier des Arènes, alors densément occupé par une population démunie vivant dans des masures, est dévasté[109]. Une quarantaine y est instaurée, ces pauvres étant nourris aux frais de la ville, puis c’est toute la paroisse de la Major qui est mise en quarantaine, 3.000 personnes y sont enfermées. Comme ils risquent de mourir de faim, on les autorise à sortir par une des portes de la ville, mais avec une croix rouge à leur chapeau, sous peine de mort[110].
À Londres en 1665, Pepys note dans son Journal (31 août) : « the poor that cannot be taken notice of through the greatness of the number »[111]) et Defoe fait dire à son supposé rédacteur : « Nous nous rendions compte que l’infection se tenait principalement dans les paroisses extérieures qui, très populeuses et habitées surtout par les plus pauvres, offraient plus de prise à la maladie que la cité » (47). Les classes aisées avaient largement quitté la ville, ce sont les indigents qui, massivement, moururent. L’auteur de Robinson Crusoé (publié en 1719, un an avant le Journal de l’année de la peste) n’était pas dépourvu de cynisme. Il observe que la mort de trente à quarante mille pauvres sans emploi entre août et octobre 1665 (sur cent mille en tout, estime-t-il), certes « une circonstance bien triste en soi » (« a melancholy article in itself »), n’en a pas moins été « une délivrance » (« a deliverance ») (Defoe, eng, 124) car, s’ils étaient restés en vie, la charge de les nourrir aurait été trop importante pour la municipalité, et ces indigents auraient été amenés à se livrer à des pillages (des maisons des riches).
Déjà, à l’époque où Defoe écrit, le débat sur le coût des lois sur les pauvres se développe : il y a trop de pauvres, cela revient trop cher de les nourrir, ils sont inutiles et ils sont dangereux (il parle de « useless mouths », de « dangerous people », Defoe, eng 251). Les mercantilistes veulent avant tout les mettre au travail, comme par exemple William Petty. Mais, comme il n’y a pas assez d’emplois, si une « bonne peste » ou une « bonne guerre » vient à nous en débarrasser, ce n’est pas un malheur ! Dix ans plus tard, dans sa Modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d’être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public (1729), avec une ironie grinçante, adoptant le style « arithmétique » de William Petty, Jonathan Swift propose de traiter les enfants irlandais comme un bétail destiné à la consommation. Il faudra attendre la fin du siècle pour que Malthus propose son « principe de population » et écrive « au banquet de la nature le pauvre n’a pas son couvert » (2e éd. 1803[112]).
Les indigents, en outre, sont perçus comme « une classe dangereuse ». À cause des pillages auxquels ils peuvent être amenés à se livrer, mais aussi à cause des troubles, attroupements revendicatifs, révoltes qu’ils suscitent. « Heureusement », explique Defoe, comme il en mourait près d’un millier par jour « cette calamité rendit les gens fort humbles » (p. 161 ; eng, 124) (« this calamity of the people made them very humble »). La mort en masse allégea les finances municipales et assagit le peuple !
L’ÉCONOMIE DES VILLES DE LA PESTE
Il y a d’abord le temps de l’effondrement économique, une « crise » due à un choc exogène. Les chocs épidémiques sont d’ampleurs très variables. Pour simplifier, il faut distinguer les pandémies qui, en quelques années, atteignent le monde entier et y tuent aux environs d’un tiers de la population et les épidémies qui frappent une ville, sa région, qui y tuent un pourcentage comparable, voire davantage. Si parfois – souvent même – elles gagnent d’autres villes, elles peuvent être considérées comme relativement localisées. Il nous faudra ensuite observer « le monde d’après », les sorties de crise et l’évolution de long terme.
L’économie à Londres en 1665
Londres 1665 est un cas emblématique ; on détient le « vrai » Journal de Pepys et le « faux-vrai » Journal de Defoe, tous deux attentifs à la vie économique, et John Graunt, le statisticien initiateur des Bills of mortality, publie en décembre 1665 London's dreadful visitation, or, A collection of all the bills of mortality for this present year, qui recense les morts du 20 décembre 1664 au 19 décembre 1665 par semaine, maladies, paroisses, et se centre sur la Grande Peste. La courbe de la sévérité de la dépression correspond assez précisément à la courbe de mortalité, une courbe en V. D’un côté, même si la fermeture et l’isolement familial sont la règle, la contagion est foudroyante et, après un moment paroxystique, la maladie régresse rapidement quelles qu’en soient les raisons[113]. De l’autre, l’économie redémarre vivement lorsque la maladie est terminée. L’épidémie est un révélateur de force et de faiblesses. Londres est alors une ville extraordinairement dynamique. Si nous reprenons l’image de la courbe en K, (l’économie subit une chute rapide et forte suivie d’une dissociation entre d’un côté les secteurs qui se développent et de l’autre ceux qui chutent), le bras ascendant y est nettement plus fort que la jambe descendante.
La courbe de mortalité[114] pour l’ensemble de la ville de Londres peut être ainsi résumée : début de l’épidémie en juin, la City est atteinte fin juin, les gens aisés commencent à quitter la ville, accroissement rapide de l’épidémie en juillet, fulgurant en août, le maximum est atteint en septembre, la peste tue toujours massivement en octobre, mais elle est en chute libre, en novembre l’épidémie est enrayée. Elle semble rebondir légèrement en décembre, mais à la fin de l’année elle est terminée.
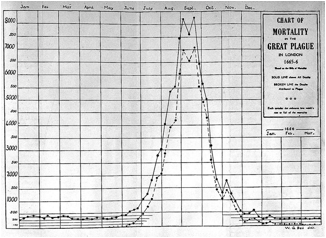
[ligne pointillée : les morts dus à la peste ; ligne continue : les morts toutes origines]
Le Journal de Pepys rend compte de cette évolution[115]. La tragédie a duré six mois, dont deux ou trois mois effroyables, l’essentiel des morts se situant entre le 8 août et le 10 octobre (Defoe estime qu’il y eut en tout 100.000 morts, donc au-delà des 68.590 officiels tirés des statistiques de Graunt, Edward Hyde, Earl of Clarendon, le Lord High Chancelor, parle de près de 140.000 morts sur une population totale de 460.000 habitants, soit entre 20% et 30%). Le profil de la courbe de mortalité à Londres est assez général, ainsi à Marseille en 1720 on aura quatre mois de forte épidémie, deux mois paroxystiques, août et mi-septembre[116].
À Londres comme dans les autres « villes de la peste », certaines professions furent davantage atteintes, d’autres moins, sans qu’alors une explication soit donnée. On estime aujourd’hui que la raison est à chercher du côté des rats et de leurs puces. Ainsi furent davantage exposés les meuniers, boulangers ou gestionnaires et gardiens de greniers à blé, également les bouchers, et les professions du vêtement (tailleur, fripier, drapier), les chiffonniers bien sûr. Inversement les métiers qui éloignent les rats, à cause du bruit (comme les forgerons, les tonneliers) ou parce qu’ils sont en relation avec les chevaux (les rats craignent leur odeur, de même pour les béliers) ou encore les marchands d’huile (par l’odeur ou graissage du corps) auraient été moins atteints.
Pepys donne quelques éléments pour appréhender l’effondrement de l’activité. Le 16 août, il se rend à la Bourse (London Exchange, ou the ‘Change), il observe qu’il y a très peu de monde, que les rues sont vides, que deux boutiques sur trois, voire davantage, sont fermées (Pepys, p. 152-153)[117]. Mais les affaires y continuent. La preuve est que ce même jour, les rumeurs sur les dangers que court la flotte anglaise font baisser la Bourse (« Every body is at a great losse and nobody can tell. »). Lui-même continue de s’activer, il observe même qu’il brasse trop d’affaires. En octobre il peut se réjouir des bénéfices réalisés durant les derniers mois. Sa femme rentre à Londres en décembre (« Quelle joie de nous retrouver ici », p. 251), il observe que la ville se repeuple densément (p. 259), que les boutiques rouvrent et il se réjouit : « Jamais ma vie n’avait été aussi gaie (outre que je n’ai jamais gagné autant d’argent) qu’en ce temps de peste » (31 décembre, 270).
Defoe est beaucoup plus précis (p. 155-156 et 317 ss), il nous livre une analyse de la situation économique et de l’emploi.
Il observe d’abord que, pour ce qui est des subsistances, l’activité n’a pas cessé. La ville a été approvisionnée depuis les campagnes environnantes et par cabotage. Il en est allé de même pour le charbon de Newcastle. Les boulangers, bouchers ont maintenu leurs activités. Les marchés ont été approvisionnés, y compris pour la viande et les fruits. Il y eut quelques hausses des prix, mais momentanées et faibles. Il faut dire que la demande émanant des classes populaires s’était effondrée avec la croissance massive du chômage et donc la baisse des revenus. Si on prend en compte la population ayant pu quitter Londres, la consommation de la ville aurait, selon Defoe, été diminuée de moitié.
En revanche, dans Londres, pratiquement tous les métiers artisanaux et toutes les manufactures ont fermé, principalement dans les activités les moins nécessaires à la vie (et il en donne la liste) ; ils licencièrent leurs ouvriers et tous ceux qu’ils employaient. Les répercussions furent considérables dans toute l’Angleterre (p. 331). Le commerce d’exportation et la demande londonienne (elle représentait une part considérable de la demande globale) s’étaient effondrés. Le commerce intérieur anglais, par terre, fleuves et même par mer fut fortement réduit (à nouveau hors subsistances et charbon). S’il y eut « stagnation des affaires manufacturières dans tout le pays », notons cependant que les maîtres artisans les plus importants, ceux qui étaient largement dotés en capital, au sommet de leur puissance, purent continuer leurs affaires et « maintenir les pauvres au travail » estimant que l’épidémie terminée, les affaires repartiraient rapidement et qu’ils récupéreraient le chiffre d’affaire perdu pendant l’épidémie. Ce fut le cas en particulier de riches drapiers. Mais, les entreprises les plus fragiles durent cesser le travail. Les riches et puissants manufacturiers tirèrent leur épingle du jeu, ce qui n’empêcha pas la forte croissance du chômage dans toute l’Angleterre.
Toutes les activités relatives à la construction immobilière s’arrêtèrent purement et simplement, tous les salariés étant mis au chômage. Personne n’avait à cœur de bâtir en ces temps de calamités et où des milliers de maisons étaient vidées de leurs habitants.
Les affaires financières ne disparurent pas complètement. La Bourse est restée ouverte pendant toute l’épidémie, mais elle était désertée (261) au point que l’herbe y poussait comme dans la plupart des grandes avenues de la ville.
Le commerce extérieur s’effondra (156, 317). Aucun navire n’appareillait. Les pays étrangers, pour l’essentiel, se sont refusés à accepter les navires, et les marchandises, en provenance de Londres. Si au début de l’épidémie, seul Londres était affecté, à mesure qu’elle prenait de l’ampleur et que la peur de la contagion gagnait l’étranger, ce fut un « embargo général » contre toute l’Angleterre[118]. D’où la perte d’emploi pour tous ceux qui, directement ou indirectement, dépendaient de la navigation et du commerce extérieur. Quant aux navires entrants, ils se raréfièrent (117), mais ils ne cessèrent leur remontée de la Tamise que durant les deux mois d’août et septembre, les plus durs (323). Ils restaient en aval du pont de Londres, et dès octobre ils entrèrent.
L’effondrement de l’emploi fut encore augmenté par le licenciement en masse des domestiques (157), une classe qui à l’époque représentait une part importante de la population londonienne. La plupart des familles aisées, qu’elles partent ou restent, mirent à la porte l’essentiel de leur domesticité.
L’effondrement économique et la montée vertigineuse du chômage, donc la perte de revenus des travailleurs, eurent des conséquences mortifères. C’est l’occasion de souligner que, lors de telles catastrophes, l’économie peut tuer elle aussi en masse les pauvres sans emploi et sans protection ! Lors de l’épidémie de covid-19, dans des pays comme le Brésil ou l’Inde, sans doute « émergents », mais où les inégalités sont énormes, la grande pauvreté massive, le droit du travail et l’assistance sociale insuffisants, à peine ébauchés ou inappliqués, le confinement et la dépression économique conséquente ont été un fléau pour les pauvres, peut-être plus lourd que l’épidémie.
Defoe nous dit que nombre de pauvres périrent, non de l’épidémie, « mais de ses conséquences, plus précisément de faim, de détresse et de complet dénuement, étant sans logis, sans argent, sans amis, sans moyens de se procurer leur pain » (158). Il mourut de nombreux nourrissons et jeunes enfants. Heureusement, la municipalité distribua d’importants subsides aux pauvres « domiciliés » (disposant d’un « legal settlement ») et ainsi elle évita la plupart des morts de faim[119], l’accroissement du désespoir, donc les pillages et les révoltes. L’ordre a continué à régner tout au long de l’épidémie. Defoe demande à ses lecteurs de 1720 de considérer combien la situation de la ville serait misérable si « tout à coup [tous ceux qui tirent leur pain quotidien de leur travail] devaient se trouver chassés de leur emploi, l’ensemble du travail cessant et plus aucun salaire n’étant versé ! Ce fut le cas à l’époque » (158-9). Il n’y eut pas de famine au sens où la ville resta approvisionnée, mais les indigents n’en souffraient pas moins de la faim ne pouvant acquérir ces subsistances, une apparente abondance dans la misère.
Sorties de crises et évolution à long terme
L’épidémie passée, les choses reprennent leur ancien cours, explique Daniel Defoe dans son Journal de l’année de la peste[120].
Les villes frappées par la peste s’avèrent généralement résilientes à court terme, réussissant leur sortie de crise étonnamment bien. En effet, l’épidémie terrassée, l’économie redémarre vivement, parfois alors même que la peste tue encore par ci par là. Le profil de la courbe en V de la conjoncture épouse celui de la mortalité à Londres, mais aussi à Lyon en 1629, à Marseille en 1720. Il faut un ou deux ans pour que les affaires retrouvent leur dynamisme alors même que certaines activités comme la sortie des navires peuvent être plus durablement freinées. Dans certains cas, si la reprise est d’abord vive, elle ralentit par la suite (une courbe en aile d’oiseau ou en Swoosh, la virgule à l’envers du logo de Nike). Tel semble être le cas à Venise après la peste de 1575-77. À Naples, après celle de 1656, elle est plus tardive, mais le redressement est cependant étonnant étant donnée l’importance de la saignée.
Le cas le plus frappant de reprise éclatante est celui de Londres. Le pire moment de la mortalité avait été l’automne 1665. Dès janvier 1666, l’activité redémarre[121]. Tous les commerces sont rouverts en février-mars. À la fin du mois de mars 1666, le Lord Chancelor (Lord Clarendon) peut écrire « Comme on ne l’a jamais vu, les rues sont bondées, la Bourse animée, partout dans la ville, il y a foule ». L’expansion de la ville reprit, plus forte que jamais, attirant une masse de population nouvelle. Pourtant Defoe note que le commerce extérieur ne redémarra que tardivement du fait du refus des ports étrangers d’accueillir des bateaux venant de Londres ou même anglais (Defoe, 321, 342)[122], le trafic des navires entrant étant immédiatement rétabli. Paradoxalement, du moins en apparence, en Angleterre, la reprise fut favorisée par une autre catastrophe survenue en 1666 à Londres, le Grand incendie qui détruisit une partie importante de la City. Toute l’économie anglaise en bénéficia grandement. Il fallut en effet reconstruire les immeubles, produire une grande quantité de meubles, vêtements et reconstituer tous les stocks, d’où sept ans de prospérité spectaculaire (Defoe, 331-332). Rien n’est plus révélateur du dynamisme économique de Londres et de l’Angleterre que cette capacité à faire d’un drame un facteur de croissance.
Marseille également se révèle résiliente, alors même que la navigation sortante resta impossible durablement, le blocus n’étant levé que peu à peu[123] (il ne sera complètement levé qu’en 1723). Si les entrées de navires en provenance du Levant retrouvent rapidement leur niveau antérieur[124], en ce qui concerne les sorties, on estime qu’il faut attendre janvier 1724 pour que les bateaux marseillais soient accueillis dans les ports étrangers : il aura fallu trois ans et demi. Pourtant, malgré ses 30% ou 40% de morts, Marseille se remet rapidement. La peste ayant beaucoup reculé en octobre et ayant disparu en novembre, dès le début de l’année 1721, l’activité renaît, les commerces rouvrent, la pêche reprend, les marchés s’animent. Noël 1720 est une fête d’espoir retrouvé. La Chambre de commerce avait fermé ses portes en juillet 1720, elle reprend ses délibérations le 19 février de l’année suivante. Les Marseillais survivants semblent s’être livrés à une frénésie d’achats, faisant repartir la consommation ; et il fallait reconstituer les stocks.
Même Naples, avec ses 50% de morts en 1656 et qui, après l’épidémie, était une ville morte, presque complètement dépeuplée, se rétablit relativement rapidement si l’on prend en compte l’importance prodigieuse du choc démographique. Si pendant deux ans, la ville et le royaume de Naples restent en quarantaine, isolés du reste du monde (même si de fait il y a de nombreuses violations des lignes sanitaires), ce qui bloque toute possibilité de reprise économique, dans les quatre années qui suivent les activités économiques renaissent[125], la ville se repeuple grâce à l’immigration massive (pourtant toute la région a subi un fort choc démographique), puis grâce à une natalité explosive (il faudra cependant une soixantaine d’années pour qu’elle retrouve sa population d’avant la peste). Le redressement de l’économie opéré, le rythme de croissance se ralentira.
La rapidité de la reprise de ces villes peut étonner alors qu’entre un tiers et la moitié de la population a disparu, que toute activité économique a été arrêtée plusieurs mois mettant la quasi-totalité de la population laborieuse au chômage, la privant de ses revenus. Une des raisons principales de ce rebond est que le capital n’a pas été affecté, en particulier le capital commercial essentiel dans ces villes portuaires, les réseaux des marchands, leur capital de confiance sont intacts. C’est le cas à Londres, mais ça l’est également à Marseille[126], voire à Naples. Les élites ont été relativement moins frappées, en particulier les grands marchands et les entrepreneurs qui dynamisent l’activité, mais aussi les aristocrates, les grands propriétaires fonciers qui l’encouragent par leurs dépenses[127]. Les marchés extérieurs, proches ou lointains, étaient intacts et les négociants les ont retrouvés dès que le blocus a été levé. D’autre part, une fraction considérable des morts était formée d’indigents sans emploi qui ne contribuaient guère à l’expansion économique, ni du côté de l’offre (chômage), ni du côté de la demande (misère). Surtout, dans le cas de Marseille – mais on retrouve le même phénomène ailleurs – le manque de bras a été rapidement comblé grâce à une immigration importante de travailleurs originaires de Provence (même si elle a été sévèrement affectée par la peste), des autres provinces et de l’étranger. À plus long terme, la population s’est reconstituée grâce à l’explosion des mariages et de la natalité.
La rapidité relative de la sortie de crise n’engage pas pleinement l’avenir. Le choc pesteux affecte différemment les économies ; il renforce celles en expansion longue et affaiblit celles qui déclinent, la reprise en aile d’oiseau étant un indice des difficultés à venir. L’épidémie est un révélateur des forces et des faiblesses de l’économie et de la société et un accélérateur de l’histoire. Prenons Venise après la peste de 1575. À la veille de l’épidémie, malgré la victoire de Lépante contre les Ottomans (1571) qui marque l’hégémonie de ses flottes en Méditerranée, elle est déjà en déclin. Si, après la peste, elle paraît retrouver sa puissance économique, financière, militaire, à plus long terme son déclin est conforté, la peste ayant révélé ses faiblesses, lui portant un coup dont elle ne sera pas capable de se relever pleinement.
La comparaison entre Londres et Naples – alors les deux plus grandes villes d’Europe après Paris – est également éclairante.
Il n’est pas nécessaire de rappeler que le destin de Londres et de l’Angleterre est exceptionnel après 1665. En un siècle et demi, l’Angleterre devient mondialement hégémonique sur les plans économique et politique. Dépassant Paris à la fin du règne de Louis XIV, Londres est alors la plus grande ville du monde, le centre rayonnant de l’Angleterre. Sortie affaiblie de la guerre civile, l’Angleterre a retrouvé son dynamisme sous la République et la Restauration (1660). Comme William Petty le montre (non sans chauvinisme), dix-sept ans après la Grande Peste, l’Angleterre l’emporte déjà économiquement sur la France et Londres, plus qu’aucune ville au monde, concentre une part considérable de ses activités économiques[128]. Après la Glorious Revolution (1688) la puissance économique britannique se développe toujours plus vigoureusement grâce à sa marine et à son commerce, à ses îles à sucre esclavagistes[129], à ses guerres victorieuses, à ses institutions, et l’économie londonienne en est le cœur. L’Angleterre est devenue une puissance globale, alors qu’en 1650, elle n’était qu’une puissance locale, loin derrière la France et même l’Espagne (même si en 1588, l’Invincible Armada s’était dissoute). La peste a frappé une ville en plein essor, non seulement elle sort vite et bien de la crise, mais l’épidémie n’a affecté en rien l’expansion de longue durée qui suit. Le Grand incendie de 1666, une seconde catastrophe en deux ans, a eu comme résultat de relancer le secteur manufacturier londonien et anglais et toutes les industries qui accompagnent la construction immobilière (comme Defoe le note, cf. ci-dessus), une reconstruction qui va durer dix ans. Londres, sa puissance financière, ses grands marchands, sa marine, son positionnement géographique alors que l’Atlantique a enterré la Méditerranée, ses spécialisations industrielles et commerciales porteuses dans le monde nouveau, a dynamisé sa croissance malgré la peste. Elle en a même bénéficié dans une optique schumpétérienne de « destruction créatrice », ses secteurs archaïques laissant place aux secteurs dynamiques. Et, nous l’avons vu, les manufacturiers anglais largement dotés en capital s’en sont bien sortis, mais pas les plus pauvres, d’où une concentration capitalistique. Le puissant bras ascendant de la courbe en K a dynamisé l’économie anglaise. Il est révélateur de ce dynamisme que Londres ait fait de la catastrophe du Grand incendie de 1666 une source d’expansion !
Malgré un taux de mortalité plus de deux fois plus élevé qu’à Londres, Naples réussit à se relever assez rapidement du drame de la peste de 1656 ; même si, évidemment, la sortie de crise lui prendra plus de temps. Naples redevint une grande capitale, la troisième plus grande ville d’Europe. Avant la peste, son économie souffrait de la fiscalité oppressante de Madrid, de la domination d’une aristocratie et d’un clergé prédateurs[130], du processus de « reféodalisation » au détriment des petits propriétaires et au profit des maîtres des latifondi. En outre la Méditerranée et l’Europe du Sud, sont surclassées par la Mer du Nord, l’Atlantique et l’Europe du Nord. Le Mezzogiorno que la ville polarise et qui, pour l’essentiel, constitue le royaume de Naples, est devenu l’espace typique des latifondi, d’immenses domaines de l’aristocratie, des couvents et des princes de l’Église, propriétaires absentéistes, où une agriculture archaïque est menée par des troupes d’ouvriers agricoles peu productifs, proches du servage, dirigés par des caporati (contremaîtres) souvent incompétents, tyranniques et prédateurs. La valeur ajoutée est captée par l’État espagnol « colonialiste » et le surplus résiduel est investi non productivement dans des palais et des Églises, de somptueux édifices. Les dépenses somptuaires des élites gonflent surtout les importations. Les inégalités, déjà, sont excessives, la classe moyenne fait défaut.
Il ne s’agit alors que du commencement d’une évolution déclinante. La ville est riche, les « Arts de la soie » restent dynamiques, une industrie exportatrice (même si, de plus en plus, la matière première est exportée), les activités marchandes sont encore florissantes, le port rayonne et les activités culturelles et intellectuelles sont brillantes.
La terrible épidémie pesteuse de 1656 révèle et accentue les failles de l’économie et de la société napolitaine[131]. L’oppression fiscale madrilène[132] ne fera que s’alourdir, freinant encore le dynamisme des affaires. Le surendettement de l’État renforce l’économie fondée sur la rente financière au détriment de l’investissement productif, consolide encore les féodaux qui en sont les acquéreurs, impose la surévaluation de la monnaie. Le PIB s’est effondré avec l’épidémie et la rente féodale (latifundiaire) chute lourdement en masse[133], la baisse des revenus de l’aristocratie et du clergé réduit leurs dépenses et les effets d’entraînement de celles-ci sur l’économie napolitaine), mais le taux d’exploitation des paysans augmente. Le système latifundiste bloque le mécanisme vertueux lié à l’accroissement de la productivité et du niveau de vie paysan. Le PIB/tête n’augmente pas, la répartition devient encore plus favorable à l’aristocratie et à l’Église, et les surplus qu’elles extraient ne sont pas investis productivement.
Si l’on peut parler de déclin économique, il ne s’agit sûrement pas de décadence. Après l’indépendance (1734), Naples inaugure même un second âge d’or aristocratique ; il concerne essentiellement l’édification d’églises, de somptueux palais dans la ville et en province, ainsi que la vie intellectuelle, culturelle, musicale. La superstructure est somptueuse, mais les bases économiques continuent de s’affaiblir. Le surplus extrait par les classes dominantes est excessif par rapport à la valeur ajoutée générée et il est dépensé de façon improductive. La peste de 1656 n’est pas la cause du basculement de l’économie napolitaine, mais elle l’a poussée dans la direction vers laquelle elle penchait. Le choc pesteux s’est exercé sur une société non seulement ultra inégalitaire, mais aux inégalités archaïques (quasi-serfs et féodaux), il a renforcé ces inégalités. Il a frappé une économie qui manquait de secteurs modernes, de couches sociales et d’institutions capables de la dynamiser. À l’inverse de Londres, son système social et ses secteurs archaïques, les latifondi, son positionnement au cœur de la Méditerranée, ont fait que, lors de la peste, la jambe descendante de la courbe en K était plus développée que le bras ascendant.
Naples et Londres, deux destins divergents à long terme que la peste a confortés. Naples était le centre d’une économie féodale fondée sur deux rentes, la rente latifundiaire et la rente financière. C’est sur ces deux piliers qu’elle se reconstruit, durcissant l’exploitation des travailleurs ruraux via la rente latifundiaire, celle de la population non aristocratique via la fiscalité et la rente financière, et canalisant ces surplus vers des dépenses improductives et des dépenses somptuaires qui conduisent à des importations et pas suffisamment à l’encouragement de la production locale. Londres devient le centre d’une économie capitaliste fondée sur le travail productif, le profit des manufacturiers, des marchands, des compagnies commerciales, des grands armateurs et l’investissement productif de ce surplus. L’économie qui se redresse si vivement après la Grande Peste est cette économie capitaliste tandis que les entreprises peu capitalisées, les secteurs archaïques disparaissaient. Non seulement elle survit aux catastrophes, mais elle en fait un ressort.
« Selon que vous serez puissants ou misérables … » écrivait La Fontaine dans Les animaux malades de la peste …
EN CONCLUSION : RETOUR SUR LA COVID-19
« Tout simplement nous ne savons pas » disait Keynes. Face à cette incertitude radicale, l’histoire peut nous apporter ses pâles lumières. Certes, elle nous laisse dans l’embarras, mais – pour paraphraser Ionesco – dans un embarras supérieur. Et souvent nous n’avons qu’elle pour nous repérer dans l’obscurité. On peut penser à cet homme qui, ayant perdu ses clés dans la nuit noire, les cherchait au pied d’un réverbère. Au passant lui demandant s’il pensait les avoir perdues là, il répondit « Non, mais c’est là où il y a de la lumière ». Si l’histoire est irruption de la nouveauté, il est des permanences – pour l’essentiel, elles tiennent à l’essence inchangée de l’homo sapiens – et des retours de situations apparentées, voire analogiques.
Avec la covid-19 reviennent les temps de la fermeture et de l’isolement, ceux des frontières-clôture, des entraves à la mobilité, du confinement, des quarantaines et des lazarets, du couvre-feu, et jusqu’à la mise en état de ville ou de province assiégée avec enfermement généralisé (comme ce fut le cas pour Wuhan et la province chinoise de Hubei dont elle est la capitale). Des libertés sont suspendues, le contrôle social par les voies traditionnelles – celles que Foucault observait dans les « villes de la peste » - se double du cyber-contrôle par la conjonction d’internet, des big data, de la vidéo-surveillance et de l’intelligence artificielle. La Chine se distingue par la généralisation de ces méthodes d’inquisition et de surveillance, un cyber-panoptisme qui a montré son efficacité et connaît un haut degré d’acceptation sociale. Il est d’autant plus dangereux pour les libertés qu’il s’avère efficace contre l’épidémie et est donc réclamé par la population : la peur et la protection ont toujours été la porte d’entrée de la tyrannie. Si la Chine est en pointe, partout dans le monde le recours à la « safe city » – une smart city de surveillance – est encouragé par l’épidémie. Par ailleurs, le confinement et la fermeture des commerces renforcent massivement les plateformes de vente comme Amazon tandis que le télé-travail, les visio-conférences, donnent un coup de fouet supplémentaire à la société informationnelle et aux GAFAM.
Les grandes épidémies du passé ont été des révélateurs d’inégalités et elles ont contribué à les accroître. La covid-19, elle aussi, nous confronte à l’inégalité devant la mort. Comme toujours, ce sont les quartiers déshérités qui payent le plus lourd tribut en termes de mortalité, comme toujours, ceux qui en ont les moyens ont pratiqué le « Cito, longe, tarde » ou le travail à distance. L’épidémie renforce les inégalités économiques, le chômage affectant surtout les plus pauvres, les plus précaires. Et ces inégalités sont aussi entre pays.
Avec la covid-19, nous voyons revenir les comportements irrationnels – y compris dans la recherche des causes et de remèdes –, les fake news et le complotisme, la recherche de boucs émissaires. La croyance en un châtiment divin lui-même s’est transmutée en « vengeance de Gaïa ». Les visions apocalyptiques se multiplient. L’anomie augmente et – alors même que l’on observe des actes de courage et de dévouement professionnels – une vague d’égoïsme enfle avec l’épidémie. Les tensions sociales risquent de s’exacerber.
Lorsque l’épidémie de covid-19 sera derrière nous grâce à la vaccination de masse, quelle sera l’évolution de l’économie ?
À court ou moyen terme, les expériences du passé permettent d’escompter que la reprise sera rapide et forte lorsque l’épidémie sera terminée. Les « villes de la peste » ont connu de telles reprises post-traumatiques vigoureuses, même si, dans certains cas, au bout d’un an ou deux, on observe un tassement de la reprise. Nous avons des indices d’une telle résilience des économies post-covid. Lorsque cette épidémie s’apaise, l’économie rebondit vivement à des taux pouvant atteindre 33% en rythme annuel[134]. Cet optimisme doit être tempéré. D’abord, il existe une forte hétérogénéité selon les secteurs et les pays et cela aura des conséquences majeures surtout dans le long terme. Ensuite, si l’épidémie s’éternise, le risque est que se développent des phénomènes de dépression cumulative et que l’arrêt de l’investissement et les destructions causées à l’éducation finissent par abaisser la croissance potentielle. Heureusement, la découverte rapide de vaccins permet d’espérer que la durée de la pandémie de covid-19 n’excédera pas une année ou dix-huit mois.
On peut résumer ces observations en trois points :
1. L’épidémie de covid-19, comme celles du passé, a été un choc brutal qui a pétrifié l’économie du fait du confinement et de l’incertitude quant à son évolution (chute de la production, des dépenses de consommation et d’investissement, hausse de l’épargne). Le choc passé, les facteurs dépressifs évanouis, l’économie devrait rebondir à l’instar de ce qui se passait lors des grandes épidémies du passé : les chocs étaient violents et brefs, d’où la force de la reprise.
2. Lorsque se succèdent des phases de confinement et de déconfinement, la reprise est à chaque fois brisée par une nouvelle fermeture, l’économie subissant alors un rythme du type « stop and » go ».
3. Le prolongement de la durée d’une épidémie en lui-même, quelle qu’en soit la cause (stratégie d’aplatissement-allongement pour soulager les hôpitaux, absence de remèdes et de vaccins, nouvelles souches du virus), surtout s’il est doublé d’une mise en « montagne russe » de la courbe de l’épidémie – et donc de celle de l’économie – accroît le risque de mise en œuvre de cercles vicieux, des effets de « second tour » (lorsque le chômage et les baisses de salaire produisent une chute additionnelle de la consommation et par voie de conséquence celle de l’investissement, ces baisses de la demande globale réagissant sur le chômage et la baisse des revenus). D’où le risque d’une spirale descendante que seule une intervention de l’État peut interrompre. D’où le rôle crucial des plans de relance, du « chômage partiel » pris en charge par les États, des déficits budgétaires (baisse d’impôt, hausse des dépenses publiques). Mais ces mesures ne sont pas à la portée des pays les plus pauvres et elles ne peuvent se prolonger indéfiniment. Le risque est de renforcer des tendances stagnationnistes déjà très présentes dans l’économie pré-covid et de conduire à une situation de « déflation contenue ».
À plus long terme, les leçons de l’histoire nous montrent que les chocs épidémiques majeurs ont des conséquences fortement différenciées selon les structures économiques, sociales et politiques des pays ou des villes sur lesquels ils s’exercent. Dans tous ces cas, l’épidémie n’a pas été la cause du basculement, elle a été un accélérateur de tendance. Elle précipite le déclin des économies fragilisées, porteuses de secteurs peu productifs, aux rapports sociaux archaïques, aux institutions inefficientes, elle ne freine pas – et peut même encourager – le dynamisme des sociétés aux rapports sociaux performants, riches en entreprises et en secteurs novateurs, celles qui connaissent une forte croissance de la productivité, détiennent une place dominante dans les relations marchandes mondiales.
Les pestes du moyen-âge ont provoqué une redistribution des rapports de puissance à l’échelle mondiale. Celle de Justinien a accéléré le déclin des Empires perses et byzantins, facilité les conquêtes arabes, permis l’essor occidental et le basculement de la Méditerranée vers l’axe rhénan et la Mer du Nord. Dans la crise provoquée par la peste noire, à travers épidémies, guerres, révoltes sociales, l’Europe occidentale va mettre en œuvre ce qui finira par constituer un nouveau régime politique et économique efficient, les bases de la Renaissance et du capitalisme. Quant aux chocs pesteux frappant les villes européennes au XVIIe siècle, ils auront des conséquences à long terme très différentes selon leurs structures économiques, institutionnelles et sociales. Certes, l’épidémie terminée, ces villes vont se montrer capables d’un sursaut économique. Mais, en partant des cas opposés de Londres et de Naples, on peut observer que dans le premier cas, l’épidémie ne freine pas une croissance de longue durée exceptionnelle alors que, dans le second cas, le déclin s’ensuivra.
Après l’épidémie de covid-19, il y aura également des gagnants et des perdants. C’est le cas, nous l’avons vu, socialement : comme lors de toutes les grandes épidémies, les riches sont les gagnants et les pauvres les perdants, et cela au sein de chaque pays et à l’échelle mondiale. C’est également le cas en ce qui concerne les secteurs et les pays, donc géopolitiquement. Les pays seront affectés différemment selon leur dotation relative en secteurs archaïques et modernes et selon l’efficacité de leurs institutions. L’épidémie de covid-19 a fortement impacté les entreprises et les secteurs issus de la deuxième révolution industrielle (l’automobile, l’aviation) ainsi que le tourisme, elle a en revanche renforcé les secteurs de la révolution communicationnelle, les entreprises qui exploitent les data et les plateformes d’e-commerce, les nouvelles modalités d’organisation du travail (visio-conférence, télétravail), mais aussi la télésurveillance, la captation et la commercialisation des données personnelles, les « safe cities ». Les États-Unis et ses GAFAM (Google, Apple, Facebook et Amazon, Microsoft), la Chine et ses BHATX (Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi) devraient en sortir renforcés par rapport à l’Europe qui est largement passée à côté de cette révolution technique et reste fortement dépendante de secteurs traditionnels. Le risque est qu’elle perde pied définitivement.
Cependant, il n’y a pas de fatalité et les leçons de l’histoire sont énigmatiques. Si l’Europe n’est plus au centre du monde, si elle a perdu son hégémonie, elle n’est pas en déclin. Elle peut même bénéficier paradoxalement – elle qui fut à l’origine de la Révolution industrielle – de l’avantage des tard-venus si elle sait faire de sa faiblesse une force de renouvellement. Non pas par imitation, mais en faisant « un pas de côté ». Le monde est à la veille d’un bouleversement de grande ampleur. Il lui faut affronter le péril climatique, éviter la catastrophe écologique. Le défi d’adaptation est d’une ampleur inégalée et il s’agit de ne pas rater la marche ! Le défi est scientifique et technologique, et l’Europe est capable de mettre en œuvre des techniques écologiquement compatibles. Il est aussi social, sociétal et institutionnel. Sur ces terrains aussi, le capitalisme est doté d’une capacité d’adaptation considérable. Il a réussi jadis à faire une force de sa capacité à intégrer la démocratie sociale et il peut, de même, s’adapter à l’impérieuse nécessité d’une révolution écologiste. L’Europe est bien placée pour réussir cette mutation. Elle s’est avérée capable de s’unir, d’éliminer la guerre entre ses nations. Les conflits porteurs d’innovations s’y expriment, et le règlement des différends s’y fait démocratiquement, par opposition aux pays où ils sont étouffés sous le couvercle de l’autoritarisme et à ceux où ils se règlent dans la guerre civile. Elle conserve un très haut degré d’éducation de ses populations, même si, sur ce terrain, elle a perdu sa primauté. C’est là que se jouera sa capacité de rebond.
Les États-Unis, aux
inégalités outrées, en guerre civile froide, gaspilleurs traditionnels de
ressources, au système éducatif hors de prix, avec une fraction considérable de
la population hérissée contre les mesures pour sauver le climat sont, pour une
fois, mal placés pour être les leaders. La Chine a tiré sa force d’un
capitalisme agressif contrôlé par un État et un parti totalitaire pratiquant
l’e-surveillance de masse et d’une ouverture inconséquente du marché mondial.
Cette force pourrait devenir sa faiblesse. À nouveau, le conflit mondial majeur
est entre deux systèmes, d’un côté les puissances démocratiques et de l’autre
les systèmes autoritaires ou totalitaires. À court terme, les méthodes
expéditives de ces derniers montrent leur efficacité. Agissons pour qu’à plus
long terme, les premiers réussissent à prouver, une nouvelle fois, leur
supériorité. L’Europe pourrait être le lieu d’émergence d’un nouvel ordre
productif construit sur la démocratie politique et sociale et une technologie
écologique. Depuis les années 1980, elle s’est embourbée dans un capitalisme
patrimonial, néo-libéral, elle a sacrifié ses forces productives, son système
de santé et son éducation dans des politiques d’austérité. Il lui faut tourner
le dos à ce système, retrouver les modalités de coordination et de régulation
qui firent son originalité et sa force. Si l’épidémie de covid-19 pouvait hâter
ce changement, ce drame aurait une dimension positive !
* Des éléments de ce texte sont à paraître dans les numéros associés de la Revue d’économie financière (n° 139-140 ) et de la Revue Risques (n° 124), particulièrement ce qui concerne les villes de la peste au XVIIe siècle.
[1] Au sens de Frank Knight et de John Maynard Keynes et par opposition au risque, une situation où l’on connait la loi de probabilité. Keynes écrit : « About these matters there is no scientific basis on which to form any calculable probability whatever. We simply do not know. », Keynes, John Maynard [1937], « The General Theory of Employment », in : The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 14, Macmillan, Cambridge University Press, 1973, p. 109-123, p. 113-114.
[2] Bourdelais, Patrice, Raulot, Jean-Yves [1987], Une peur bleue : histoire du choléra en France, 1832-1854, Paris : Payot. Au moment de l’agonie, le choléra générait une cyanose de la peau par rupture des capillaires.
[3] Il ajoutait : « Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines » (Regards sur le monde actuel, Paris : Gallimard, 1945, p. 43).
[4] Cf. Phèdre de Platon, et son analyse par Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon » (1968, Tel Quel, n. 32 et 33, repris à la suite de Phèdre, GF, 2006.
[5] Ionesco, Eugène [1976], « Manès Sperber, un médecin de l’âme », in : Le
Monde, 21 mai.
[6] Et un taux de létalité – par rapport au nombre de personnes atteintes – vingt fois plus élevé.
[7] Barro, Robert, Ursúa, José F., Weng, Joanna [2020], « The coronavirus and the Great Influenza epidemic: Lessons from the “Spanish Flu” for the coronavirus’ potential effects on mortality and economic activity », AEI Economic Policy, Working Paper Series, 16 mars ; Vagneron, Frédéric [2018], « D’une pandémie mondiale au spectre d’une crise globale : le centenaire de la grippe “espagnole” », Ler Historia, 73, p. 21-43 ; [2016], « Quand revient la grippe. Élaboration et circulation des alertes lors des grippes “russe” et “espagnole” en France (1889-1919) », Parlement(s). Revue d’histoire politique, 25, p. 55-78 ; [2015], Aux frontières de la maladie : l'histoire de la grippe pandémique en France (1889-1919), EHESS ; Quétel, Claude [2018], « Grippe espagnole : Le tueur que l'on n'attendait pas », L’Histoire, n° 449, juillet-août ; Vinet, Freddy [2018], La Grande grippe. 1918, la pire épidémie du siècle : histoire de la grippe espagnole, Paris : Vendémiaire.
[8] Fin 2020, le taux de mortalité européen de la covid-19 était de 0,05%, américain de 0,07%, mondial de 0,02%. Le taux de létalité (par rapport aux personnes atteintes) est en moyen de 1%, mais varie très fortement avec l’âge : de 0% pour les plus jeunes et 0,16 entre 40 et 44 ans à 9% pour les 84-89 ans et plus de 17% au-delà de 90 ans.
[9] Cf. Bouron, Françoise [2009], « La grippe espagnole (1918-1919) dans les journaux français », in : Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. 1, n° 233, p. 83-91.
[10] L’Office international d'hygiène publique (OIHP) existait depuis 1907 pour limiter la propagation des épidémies, organiser les quarantaines.
[11] Dans les pays occidentaux, la stigmatisation des victimes a considérablement régressé durant les années 1990 et 2.000. Ce n’est pas le cas dans d’autres régions du monde.
[12] « Le sidaïque […] est contagieux, par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C’est une espèce de lépreux. Les sidaïques, en respirant du virus par tous les pores, mettent en cause l’équilibre de la nation. » (Jean-Marie Le Pen, mercredi 6 mai 1987, « L’heure de vérité », Antenne 2).
[13] J. M. Le Pen, encore lui, demande la création de « sidatoriums ».
[14] Il était aussi chargé de constituer une « réserve sanitaire » (« un vivier de professionnels du secteur de la santé, volontaires pour être mobilisés en renfort lors d'une situation sanitaire exceptionnelle ou d'une crise ») qui s’est avérée quasi inexistante l’épidémie de covid-19 venue.
[15] Titre du célèbre ouvrage de Marc Bloch (L'étrange défaite : témoignage écrit en 1940, Paris : Société des Éditions « Franc-Tireur », 1946).
[16] Ariès, Philippe [1974], Western Attitudes Toward Death from the Middle Ages to the Present, Baltimore : Johns Hopkins University Press ; [1981], The Hour of Our Death, New York : Knopf. Vovelle, Michel [1974], Mourir autrefois, attitudes collectives devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris : Gallimard. Lebrun, François [1971], Les hommes et la mort en Anjou au XVIIe et XVIIIe siècle, Paris-La Haye : Mouton. Tenenti, Alberto [1957], Il Senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento, Francia e Italia, Turin : Einaudi.
[17] Attitude qui a suscité une iconographie hagiographique considérable, cf. en particulier le bronze en demi-bosse fixé sur le socle de la statue de l’évêque (jouxtant la cathédrale de la Major à Marseille) représentant « Monseigneur de Belsunce donnant la communion aux malades » ou les tableaux de Michel Serre (« Vue du Cours pendant la peste », musée des Beaux-Arts, Marseille) ou de Nicolas André Monsiau (« Le dévouement de Mgr de Belsunce durant la peste de Marseille », musée du Louvre).
[18] « Tout hussard qui n'est pas mort à trente ans est un jean-foutre. » (Antoine Charles Louis de Lasalle). Il est mort au combat à 34 ans lors de la bataille de Wagram en 1809.
[19] Moi et la peur nous sommes jumeaux, écrit Hobbes dans son autobiographie en vers latins écrite à la fin de son existence (l’annonce de l’arrivée de la Grande Armada causa à ma mère une telle peur « qu’elle donna naissance à des jumeaux, / La peur et moi ensemble. » : « T. Hobbes Malmesburiensis Vita, scripta anno MDCLXXII », Opera Philosophica, quae Latine scripsit, ed. W. Molesworth, London, 1839, reprint 1966, I, p. LXXXVI.
[20] Voir, dans La Grande illusion de Jean Renoir, le dialogue entre les deux officiers aristocrates, Boëldieu (Pierre Fresnay) et Rauffenstein (Éric von Stroheim), ce dernier expliquant que, pour eux, la mort au combat est une belle sortie, une solution, alors que pour les roturiers, un Maréchal (l’homme du peuple joué par Jean Gabin) ou un Rosenthal (le bourgeois juif joué Marcel Dalio) la mort est désespérante car ils n’ont que leur vie.
[21] Duby Georges, Guillaume le Maréchal, Paris : Gallimard, 1986.
[22] Un des motifs invoqués fréquemment pour l’établissement de la « Paix de Dieu » (au XIe siècle) est la protection des « pauvres » (la paysannerie désarmée).
[23] Pepys, Samuel [1970-76], The Diary of Samuel Pepys, R. Latham and W. Matthews ed., Londres : Bell & Hyman, 11 vol. ; trad. fr, Samuel Pepys, Journal, Paris : Laffont (Bouquins), 1994, 2 vol. (ci-dessous Pepys).
[24] Un péché capital comme l’envie (en relation avec l’orgueil) est typiquement le péché de celui qui « ne se contente pas de sa place », un péché individuel, mais aussi un péché de classe, un ferment de révolte sociale hautement condamnable (« ceux qui ont envie pour les riches et les nobles » écrivent les Chroniqueurs comme le Religieux de Saint Denis et Froissart, cf. Vincent-Cassy, Mireille [1980], « L’envie au Moyen Âge », Annales, 35-2, p. 253-271) qui vaut châtiment divin.
[25] Les jansénistes sont pour Mgr de Belsunce la cause de la peste de 1720 à Marseille.
[26] Le rôle des rassemblements religieux, dans les églises et lors des processions ou des prières en commun est important dans l’accélération des épidémies. Ce fut tout particulièrement le cas lors de la grande épidémie de Naples. On retrouvera ce phénomène avec la covid-19 (le rassemblement évangéliste de Mulhouse, 17-21 février 2020).
[27] Tractatus de peste, Amsterdam : Joan Blaeu, 1646, rééd. 1665.
[28] « un homme, un quaker, traversa la Grand-Salle, tout nu ; afin d’éviter le scandale, il s’était couvert de façon fort pudique, seulement les parties […] avec sur la tête un poêlon rempli de souffre enflammé, en criant “repentez-vous, repentez-vous” », (le 29 juillet 1667, Pepys, p. 928).
[29] Defoe, Daniel [1722], A Journal of the Plague Year, London, 1722, cité d’après l’éd. London : Aldine House, 1900 (ultérieurement Defoe, eng), trad. fr. Le journal de l’année de la peste, Paris : Gallimard (folio), 1959.
[30] Un riche commerçant, un sellier « avec boutique, magasins remplis de marchandises » traitant d’affaires internationales.
[31] Lassés d’attendre passivement l’advenue du royaume du Christ sur terre, les anabaptistes de Münster – sous l’impulsion de melchiorites néerlandais (du nom du prédicateur Melchior Hoffmann) ayant trouvé refuge à Münster – tentèrent de le réaliser. La révolte de Münster (février 1534 à juin 1535), animée en particulier par le prédicateur Bernt Rothman, dirigée par Jan Matthijs, puis par Jean de Leyde, est la plus célèbre tentative d’instaurer ici-bas la Nouvelle Sion dans un esprit communiste (la communauté des biens fut instituée, la polygamie aussi). L’expérience sombra dans une tyrannie sanglante avant d’être écrasée, après la prise de la ville par l’armée des Princes, par une répression atroce (tortures, exécutions, puis exposition dans des cages de fer – elles sont encore là, même si les squelettes ont été enlevés – de trois principaux dirigeants). Les « münstériens » furent pourchassés, et ce nom fut longtemps synonyme de terreur communiste.
[32] Rien n’est plus éloigné de Spinoza que l’idée du péché considéré comme une violation de l’ordre naturel. La pénitence est contraire à la raison, ce n’est en aucun cas une vertu.
[33] Dans la Sixième méditation, Descartes avait écrit : « par la nature, considérée en général, je n’entends maintenant autre chose que Dieu même ». C’était infiniment moins scandaleux d’assimiler la création à son créateur que le créateur à sa création.
[34] Carlo Ginzburg fait remarquer que « L’analyse extrêmement dense de Thucydide s’ouvre par le mot anomia, qui indique l’absence de loi, ou mieux encore, la dissolution de toutes les lois face à l’explosion de la maladie. Nous dirions aujourd’hui qu’il s’était produit un vide de pouvoir qui devait être rempli par les instincts les plus bas. Mais comme on l’aura remarqué, le terme d’anomia […] ne renvoyait pas seulement aux lois humaines. Face à l’imminence de la mort, c’est la peur des dieux elle-même qui avait perdu toute efficacité. » et il fait le lien avec Hobbes (qui a traduit Thucydide) : Ginzburg, Carlo [2007], « Peur, révérence, terreur. Lire Hobbes aujourd’hui », in : Peur, révérence, terreur. Quatre essais d’iconographie politique, Dijon : Les Presses du réel, 2013.
[35] Dont une fraction de citoyens ruraux difficile à évaluer. Ils ne peuvent participer, pour des raisons de distance, aux assemblées. Il s’agit d’adultes mâles avec un père citoyen et une mère légitime fille d’un citoyen, ayant accompli leur service militaire (éphébie) de deux ans. En comptant les femmes et les enfants des citoyens, la population dont le chef de famille était citoyen représentait approximativement 100.000 personnes à Athènes, une personne sur deux.
[36] Jacques Chiffoleau, « Les vivants ne suffisaient plus à enterrer les morts », L’Histoire, n° spécial, Vivre avec les morts, n° 473-474, juillet-août 2020.
[37] De même Guy de Chauliac, médecin et chirurgien du pape, resté à Avignon pendant l’épidémie écrit : (La grande chirurgie, II, II, 5) « Les gens mouraient sans serviteurs et étaient ensevelis sans prêtres […] : la charité était morte et l’espérance prostrée ».
[38] Delumeau, Jean [1978], La peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècle), Une cité assiégée, Paris : Fayard, repris in : De la peur à l’espérance, Paris : Laffont (Bouquins), 2013.
[39] « je puis assurer que les plus fameux médecins prédirent la mort à des personnes qui échappèrent à toute sorte d'espérance, et qu'ils prédirent la guérison à d'autres qui mouraient bientôt après, tant ce mal était impénétrable à la science des hommes, et tant il était accompagné de circonstances contraires à la raison et à l'apparence. » [Procope, Histoire de la guerre contre les Perses, II, chap. XXII, 5] ; « Toute science humaine était inefficace ; en vain on multipliait les supplications dans les temples ; en vain on avait recours aux oracles ou à de semblables pratiques ; tout était inutile ; finalement on y renonça, vaincu par le fléau. » [Thucydide, Guerre du Péloponnèse, Livre II, 47].
[40] Ces théories ne sont pas estimées contradictoires, les pestiférés infectant l’air de leurs miasmes pesteux (« la puanteur des plaies »). Ces deux types d’explication – contagion versus miasme – s’opposeront au XIXe siècle lors des épidémies de choléra.
[41] Le médecin hollandais Isbandis Diemerbroek faisait du tabac le meilleur moyen d’éviter la contagion en purifiant l’air des miasmes (d’où aussi les feux allumés dans la ville, surtout de certaines essences comme le cade). Selon certains travaux, les fumeurs n’ont-ils pas été considérés comme moins sensibles à la covid-19 ?
[42] Jacques Le Goff dans une remarquable interview par Pierre Dumayet sur la peste à Florence explique que Dieu ne saurait agir directement, il passe par l’intermédiaire de son peuple pour infliger le châtiment (L’émission « Histoire des gens » de l’ORTF du 26/10/1974 < https://www.youtube.com/watch?v=x7EmrIyylSA>). Sur un cas particulier : Muntané, Josep Xavier « Au carrefour des documents : la Peste Noire à Tàrrega (Catalogne) et ses conséquences pour les juifs de la ville », in : Clément, François (dir.), Histoire et nature, tome 2, Epidémies, épizooties : des représentations anciennes aux approches actuelles, Rennes : Presses universitaires de Rennes, p. 73-82.
[43] Bodin, Jean [1598], De la démonologie des sorciers, Lyon : Antoine de Harsy, p. 417-418, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83041x/f4.item. Cf. Beck, Eléonore [2017], « L’épidémie du mal : La répression des “semeuses de peste” à Genève en 1615-1616 », in : L'atelier historique, Genève, n° 2, automne, p. 38-49 <https://www.unige.ch/asso-etud/aehg/files/5115/1620/2812/AH.2.Site.Art.BECK.pdf>. Henri Boguet dans son Discours exécrable des sorciers (1603) précise « c’est le Diable qui fournit les graisses et oignements aux siens pour faire mourir les gens ».
[44] Verri met en cause l’usage de la torture, mais Manzoni vise les juges qui commirent une erreur judiciaire volontaire. Cf. la pièce de Dino Buzzati, La colonna infame (1962) et de Leonardo Sciascia, La strega e il capitano (1986) et son introduction à l’édition de La colonna infame de Manzoni (1973, essai repris in : Cruciverba, 1983, éd. fr. Maurice Nadeau/Papyrus, 1981)
[45] Au XIXe siècle, les pandémies cholériques débordent de leur lieu d’origine, les vallées du Gange et du Brahmapoutre, et finissent par gagner l’Europe à partir de 1829. L’Europe occidentale est frappée en 1831 (Londres en octobre, Paris en mars 1832), la zone méditerranéenne en 1833-34. Le choléra est revenu en Europe en 1848-49, 1853-54, 1865-1866 et, plus modérément, en 1883 et 1892. Sur une population de 33 millions d’habitants, il y eut 100.000 morts en 1832 (soit 3 pour mille ; mais à Paris, il tue 18.400 personnes sur 785.000 habitants, soit 23 pour mille ; l’épidémie a été également très forte en Provence) comme en 1849, 150.000 en 1854 (500.000 sur le siècle, moins que la variole ou la tuberculose). Les dégâts économiques furent minimes, mais les conséquences sociales importantes, les principales victimes se trouvant dans les quartiers les plus pauvres. cf. Bourdelais, Raulot, Une peur bleue, op. cit. ; Bourdelais, Patrice, Demonet, Michel, Raulot, Jean-Yves [1978], « La marche du choléra en France : 1832-1854 », Annales, 33-1, p. 125-142.
[46] Cf. la narration donnée par Henri Heine dans De la France, Paris : Renduel, 1833.
[47] C’est le signe de la fin des temps Matthieu 24 :15, une référence à Daniel 12 :11.
[48] Cf. Dockès, Pierre [2017], Le capitalisme et ses rythmes, quatre siècles en perspective, tome I, Sous le regard des géants, Paris : Classiques Garnier, p. 784 ss.
[49] Elle est nommée également pestis inguinaria ou pestis glandularia. Il a pu être démontré qu’elle était due à la bactérie Yersinia pestis. Venait-elle d’Asie centrale ou de Chine ?
[50] Guerre contre les Perses, Livre II, chap. 22 et 23. Procope raconte qu’il était sur place. Sa description est remarquable, aussi bien pour l’avancée de l’épidémie, les symptômes dans leur diversité, les conséquences.
[51] « la peste survenant, il y eut dans tout le pays une telle mortalité sur le peuple, qu’il est impossible de compter les multitudes qui périrent. Comme les cercueils et les planches manquaient, on en enterrait dix et plus dans une même fosse ; on compta, un dimanche, dans une basilique de saint Pierre [de Clermont], trois cents corps morts. La mort était subite ; il naissait dans l’aine ou dans l’aisselle une plaie semblable à la morsure d’un serpent ; et ce venin agissait tellement sur les hommes qu’ils rendaient l’esprit le lendemain ou le troisième jour ; et la force du venin leur ôtait entièrement le sens. » Histoire des Francs (éd. Guizot), Livre IV)
[52] Cf. Biraben, Jean-Noël, Le Goff, Jacques [1969], « La Peste dans le Haut Moyen Âge », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 24, n° 6 décembre, p. 1484-1510 ; Harper, Kyle [2019], Comment l'Empire romain s'est effondré. Le climat, les maladies et la chute de Rome, La Découverte, 2019 ; Sartre, Maurice [2018], « Byzance : L'autre Grande Peste », in : L'Histoire, juillet-septembre ; Agathias [573 ? 578 ?], Histoires. Guerres et malheurs du temps sous Justinien, Les Belles Lettres, 2007.
[53] « Que les sophistes, et ceux qui font profession de connaître les météores, en discourent comme il leur plaira ; pour moi, je me contente de représenter fidèlement quel a été son commencement, son progrès et sa fin. » ou encore « ce mal était impénétrable à la science des hommes, et […] il était accompagné de circonstances contraires à la raison et à l'apparence. », Guerre contre les Perses, II, chap. XXII.
[54] Depuis les années 2.000, la connaissance a beaucoup progressé en particulier grâce au génome du bacille retrouvé dans les os des cadavres.
[55] « Les esclaves [δουλοι] se trouvèrent sans maîtres. Les maîtres furent privés de leurs esclaves, ou par la maladie, ou par la mort. » (on traduit souvent par « serviteurs », mais jusqu’au XIe siècle, l’esclavage reste important à Constantinople, les marchés d’esclaves sont florissants et la δουλεία désigne l’esclavage stricto sensu).
[56] Guerre des Perses, II, chap. XXIII, 1.
[57] 541-544 ; 558-561 ; 570-574 ; 580-582 ; 588-591 ; 599-600.
[58] La fin de l’optimum climatique romain (climat doux et humide entre 250 av. J. - C. et 400 apr. J.- C.) aurait généré le développement de bacilles, particulièrement Yersinia pestis. Son arrivée à Constantinople aurait fait 350.000 morts sur une population de 500.000 personnes.
[59] Dès 543, les troupes impériales subissent une lourde défaite en Italie pendant la Guerre des Goths, mais l’Empire byzantin conservera l’Italie jusqu’au milieu du VIIIe siècle.
[60] Biraben, Jean-Noël Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, La peste dans l'histoire, Mouton, 1975, t. I, p. 44.
[61] Caffa était assiégée par la Horde d’or. Avant de lever le siège, ses chefs auraient fait jeter des cadavres de pestiférés au-delà des remparts. Il est plus probable que les Gênois ont embarqué des rats et leurs puces infectées.
[62] Si ce n’est l’extermination des Amérindiens, la disparition de leurs civilisations, du fait de la conquête et de chocs viraux extraordinairement puissants.
[63] Hildesheimer, Françoise [1981], Les lazarets sous l'Ancien Régime, in : Monuments historiques, n°114, avril-mai, p. 10-14.
[64] Aurell, Martin, Boyer, Jean-Paul, Coulet, Noël [2005], La Provence au Moyen Âge, Troisième partie : 1380 – 1482, chapitre 10. Une crise démographique profonde.
[65] Beaune, Colette, ed. [2011], Chronique dite de Jean de Venette, Librairie Générale Française, N.p., Lettres Gothiques, p. 111. En 1339, il est prieur du couvent de l'Ordre du Carmel, place Maubert à Paris (il devint supérieur de cet ordre de 1341 à 1366).
[66] En revanche, « les saintes sœurs de l’Hôtel-Dieu, [qui] ne craignant pas la mort, soignaient jusqu’au bout les patients avec la plus grande douceur et humilité, sans tenir compte de l’horreur de la maladie » (Beaune, op. cit., p. 111). Le chroniqueur Jean Le Bel confirme ce fréquent refus d’administrer les derniers sacrements « les uns prenaient [la peste] de l’autre, par quoi peu de gens osaient aider ni visiter les malades, et à peine se pouvait-on confesser, car à peine pouvaient-on trouver un prêtre qui le voulut faire », Viard, Jules, Déprez, Eugène (éds) [1904], Chronique de Jean Le Bel, Vol. 1. Paris : Librairie Renouard, 1904, p. 223.
[67] Le pape Clément fit donner par ses confesseurs aux moribonds absolution totale de peine et de châtiments. Ils en mouraient plus volontiers, laissant à l’Église et aux religieux quantité d’héritages et de biens temporels, car ils avaient vu partir avant eux leurs héritiers, leurs proches et leurs enfants (Beaune, op. cit., p. 113).
[68] Il s’agit de la première partie d’une œuvre considérable, Le livre des exemples qui traite de l’histoire universelle, des facteurs de l’évolution historique.
[69] Ibn Khaldoun [1377], Prolégomènes, trad. Mac Guckin de Slane, Paris : Institut de France, 1863, tome I, p. 66-67.
[70] Une période caractérisée par de longs hivers rigoureux, souvent avec de fortes précipitations qui débute avec le XIVe siècle (très fortes pluies des années 1315, 1316 et 1317, d’où la grande famine) et se prolonge jusqu’au cœur du XIXe siècle.
[71] Munro, John H. [2004], « Before and After the Black Death: Money, Prices, and Wages in Fourteenth-century England », in : New Approaches to the History of Late Medieval and Early Modern Europe, Vol. 104, February 2009, p. 335-364.
[72] Soit par « augmentation des espèces » – la valeur de la pièce (monnaie réelle, l’écu) est accrue en livres tournois (les débiteurs, dont l’État, sont favorisés : ils acquittent une dette de 10£ avec moins d’écus) –, soit par baisse de l’aloi (le titre du métal de la monnaie réelle baisse : entre 1345 et 1355, l’aloi (monnaies d’or) passe de 24 à 18 carats) d’où l’expression de « mauvais aloi ». On peut cumuler les deux solutions pour affaiblir les monnaies (c’est le cas en 1349-1354).
[73] Verlinden, Charles [1938], « La grande peste de 1348 en Espagne. Contribution à l'étude de ses conséquences économiques et sociales », Revue belge de philologie et d’histoire, 17-1-2, p. 103-146.
[74] Étienne Marcel et les Parisiens firent d’abord cause commune avec les Jacques, puis se retournèrent contre eux en s’alliant aux nobles que commandait Charles de Navarre.
[75] Froissard qui ne parle de la peste que pour dater une année, décrit la Grande Jacquerie (Livre I) et les révoltes populaires en France, en Flandre et en Angleterre (Livre II).
[76] Beaune, op.cit., p. 111.
[77] Boucheron, Patrick [2017], 1347 - La peste noire, Écrit et raconté par Patrick Boucheron, Documentaire 2017, série Quand l’Histoire fait dates http://www.pascalgoblot.com/doc/1347-la-peste-noire/
[78] Boucheron, Patrick [2020], « Entretien », recueilli par Corinne Renou-Nativel, La Croix, 21 septembre.
[79] La Guerre de Cent ans n’est nullement continue et générale, elle est épisodique et les dévastations sont régionales.
[80] Un chroniqueur orviétain a noté les peste qui suivirent : 1363, 1374, 1383, 1389, 1410, d’après Carpentier, Élisabeth [1962], « Autour de la peste noire : famines et épidémies dans l'histoire du XIVe siècle », Annales, 17-6, p. 1062-1092.
[81] Biraben, Jean-Noël [1979], « La Peste Noire en terre d'Islam », L’Histoire, avril, n° 11.
[82] En ce qui concerne la Chine, l’épidémie pesteuse sévit à partir de 1344. Aussi effroyable qu’en Europe, elle est suivie de famines, l’agriculture étant en outre accablée par les inondations du fleuve Jaune. L’économie s’effondre, les prix explosent, la taxation devient trop lourde. La dynastie régnante, d’origine mongole, détestée par les Han, est fragilisée. En 1351, éclate la révolte messianique des Turbans rouges, des paysans chinois surexploités (et en particulier ceux affectés de force à l’édification de nouvelles digues sur le fleuve Jaune). La période sera qualifiée par la chronique officielle des Ming « de sécheresse, de sauterelles, de terrible famine et d'épidémies ». Zhu Yuanzhang, lui-même d’origine paysanne pauvre, expulsé d’un monastère qui ne pouvait plus nourrir ceux qui s’y étaient réfugiés, va devenir un des principaux chefs de la révolte. Il finira par conquérir l’empire et fonder la dynastie Ming en 1368. L’économie chinoise va se redresser sous le règne de Yongle, son fils. Une période qui voit Pékin devenir capitale, la restauration du Grand canal, l’artère essentielle pour le transport du blé entre Pékin au nord et le Zhejiang au sud, délaissé pendant de longues décennies et l’ouverture maritime de la Chine, le pays se dotant d’une flotte importante, une ouverture qui se terminera avec la fin du règne (1424), la Chine revenant à sa traditionnelle fermeture.
[83] 120.000 morts pour la Provence, dont 50.000 pour Marseille et son terroir.
[84] Les données archéologiques montrent que, même aux moments paroxystiques, les funérailles individuelles se maintiennent, les charniers (et la chaux vive) se répandent cependant avec les Temps modernes. Cf. Castex, Dominique, Kacki, Sacha [2013], « Funérailles en temps d’épidémie », Les nouvelles de l'archéologie, 132, p. 23-29. Ils suggèrent que la différence de traitement pourrait être sociale. Certes !
[85] Pour ne pas parler d’état de siège qui, en droit, est un régime d’exception comprenant notamment le transfert des pouvoirs de police des autorités civiles aux autorités militaires.
[86] Benedetti, Rocco [1577], Noui auisi di Venetia, ne quali si contengono tutti i casi miserabili, che in quella, al tempo della peste sono occorsi …, Urbino : Battista de Bartoli Vinitiano.
[87] Lettre du 23 juillet 1850 à Olympe Bonenfant.
[88] Giono, Jean [1951], Le Hussard sur le toit, Paris : Gallimard, p. 62
[89] Hildesheimer, op. cit., p. 20-24 ; Panzac, Daniel [1986], Quarantaines et lazarets, l’Europe et la peste d’Orient, Aix-en-Provence, Edisud.
[90] L’hôpital Saint Laurent des Vignes à Choulans (il deviendra la Quarantaine) enfermera des pestiférés seulement en 1509 et ne deviendra un établissement important qu’en 1533.
[91] La quarantaine était organisée en trois temps et lieux (bâtiments ou cabanes) : une quarantaine pour les « suspects » (une vingtaine de jours), une quarantaine de convalescence (20 jours) et enfin celle d’approbation (cinq jours), Lucenet, Monique [1981], Lyon malade de la peste, Palaisseau : Sofedir, p. 104 ss. ; Guiart, Jules [1929], « La peste à Lyon au XVIIe siècle », in : La Biologie médicale, no 5, 1929.
[92] Ainsi à Noël 1720, M. de Nicolay de Saint-Rémy en Provence raconte : « J’avois pris le party de m’enfermer chez moi, Saint-Rémy estant attaqué avant Arles et je faisois des provisions de toutes choses, même un four pour cuire le pain ; je fis cimenter et approfondir une vieille citerne que je remplis d’eau du Rhosne. » [Caylux, Odile, La peste : récit des événements In : Arles et la peste de 1720-1721, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2009 http://books.openedition.org/pup/6718.
[93] Foucault, Michel [1975], Surveiller et punir, Paris : Gallimard, III, chap. 3 Le panoptisme. Il s’appuie sur un document de la fin du XVIIe siècle trouvé dans les Archives militaires de Vincennes (A1 516 91 sc. Pièce).
[94] Le document des Archives militaires de Vincennes n’est pas une description, mais une recommandation de mesures maximalistes.
[95] Le Lord-maire de Londres, en 1665, instaure des inspecteurs par paroisse, des surveillants, des gardiens des maisons infectées, des enquêteuses (choisies parmi les « femmes honnêtes »), des ensevelisseurs, nomme des chirurgiens de quartier (Defoe, p. 79).
[96] Foucault, op. cit.
[97] Carrière, Charles, Courdurié, Marcel, Rebuffat, Ferréol [1968], Marseille ville morte : la peste de 1720, Marseille : Autre Temps, 2008 ; Signoli, Michel, Tzortzis, Stéfan [2018], « La peste à Marseille et dans le Sud-Est de la France en 1720-1722 : les épidémies d’Orient de retour en Europe », Cahiers de la Méditerranée, n° 96, p. 217-230 ; Beauvieux, Fleur [2017], Expériences ordinaires de la peste. La société marseillaise en temps d'épidémie (1720-1724), Thèse Paris EHESS, 9-12-2017 ; [2020], « Marseille en quarantaine, la peste de 1729, L’Histoire, mai 202, n° 471, p. 10-19 ; Millot, Vincent [2020], « L’économie de la morbidité », 15 avril, <https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/04/15/economies-morbidite-peste-marseille/>. Relations anciennes : Bertrand, Jean-Baptiste [1779], Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Amsterdam : Mossy ; Lemontey, Pierre Édouard [1821], De la peste de Marseille et de la Provence pendant les années 1720 et 1721, Œuvres, tome V, p. 281 ss, 1829 ; Gaffarel, Paul, Duranty, marquis de [1911], La Peste de 1720 à Marseille & en France, Paris : Librairie académique Perrin.
[98] Par exemple Binet, R. P. Etienne (sur la grande peste de Lyon) dans Remèdes souverains contre la peste et la mort soudaine. Avec des prières pour cet effet, Bourg en Bresse : Tainturier, Jean, 1628, Paris : Chappelet, 1629 (rééd. Grenoble : J. Million, 1998), écrit : « Je ne vous défends pas même les trois mots qui sont excellents en cette matière, à savoir : cito, longe, tarde ».
[99] Fred Vargas (alias Frédérique Audoin-Rouzeau, archéologue au CNRS, auteur de Les Chemins de la peste, op.cit.) a écrit un excellent roman policier Pars vite et reviens tard.
[100] Beauvieux [2017] ; [2020], op. cit.
[101] Sur le choléra cf. Bourdelais, Raulot, Une peur bleue, op.cit.
[102] Thucydide observait dans La guerre du Péloponnèse que la « peste » à Athènes avait été aggravée par la présence d’un grand nombre de réfugiés (des campagnards qui avaient dû fuir devant l’armée spartiate). Il observe (Livre II, 52) : « Comme ils n'avaient pas de maisons et qu'au fort de l'été ils vivaient dans des baraques où on étouffait, ils rendaient l'âme au milieu d'une affreuse confusion ; ils mouraient pêle-mêle et les cadavres s'entassaient les uns sur les autres ; on les voyait, moribonds, se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour s'y désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu'on n'enlevait pas. »
[103] Pour une discussion sur la responsabilité des différents types de puces des rats et des rongeurs, également la puce de l’homme, le rôle du phénomène dit de « blocage proventriculaire » de la puce qui fait que, lors de la piqure, le sang (et les bactéries) est régurgités par la puce vers l’homme piqué (d’où la contagion), cf. Audoin-Rouzeau, Les chemins de la peste, op. cit.
[104] Le narrateur du Journal de l’année de la peste ne peut résister à la curiosité d’aller voir la grande fosse commune creusée dans sa paroisse, Algate. Elle a 40 pieds de long, 15 ou 16 de large et atteindra 20 de profondeur (un pied = 0,3 m) (Defoe, eng, p. 75).
[105] Elle débarque (sans doute d’un bateau en provenance de Sardaigne) fin janvier, on observe les premiers morts en mars 1656 à proximité du port dans le rione Lavinaio surpeuplé. Elle ne dure que six mois dans la ville (dans le reste du royaume elle se poursuit en 1657). Le 14 août 1656, des trombes d’eau tombèrent sur le ville. Elles firent déborder le Chiavicone (un canal sous la rue Toledo), s’effondrer des palais ; l’eau rejeta les cadavres dans les rues, et … l’épidémie s’arrêta (il y eut cependant quelques résurgences à la fin de l’année). Le peuple attribua le miracle à Saint Janvier. Cf. Rosi, Massimo [2004], Napoli Entro e Fuori le Mura, Rome : Newton e Compton Editori ; Calvi, Giulia [1981], « L’oro, il fuoco, le forche. La peste napoletana del 1656 », Archivio Storico Italiano, 507, p. 405-458 ; Preto, Paolo [1987], Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, Rome-Bari : Laterza ; De Renzi, Salvatore [1867], Napoli nell'anno 1656, ovvero documenti della pestilenza che desolò Napoli nell'anno 1656, Napoli : Tipografia di Domenico De Pascale. Cf. également les relations de la peste par Nicolò Pasquale (A‘ posteri della peste di Napoli e suo Regno nell’Anno 1656 dalla redenzione del mondo racconto, Naples : Luc’Antonio di Fusco, 1668) et par Geronimo Gatta (Di una gravissima peste che, nella passata primavera & estate dell’anno 1656, Naples : Luc’Antonio di Fusco, 1659).
[106] Fusco, Idamaria [2009], « La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli: diffusione e mortalità », Popolazione e storia, 10 (1), p. 115-138.
[107] On dénombre 5.550 aristocrates, 340 marchands, 1.000 médecins et chirurgiens, 330 pharmaciens, 2.600 barbiers, 220 peintres, 890 sculpteurs et graveurs, 1.400 imprimeurs et libraires, 1.930 orfèvres, 2000 maîtres-artisans, près de 3.000 tisserands de soie.
[108] « Le bruit du mal contagieux de Marseille répandu dans toute la Province, empêchoit les autres Villes d'y envoyer leurs denrées […]. Les barricades que les villes voisines avoient faites pour se garder, ne permettoient pas aux Marseillois d'en aller chercher. [La ville] fut donc bientôt réduite aux extrémités d'une disette générale : le bled commença de manquer aux Boulangers ; & le troisième Août, […] sur le soir la populace s'attroupa, & courut de rue en rue insulter toutes les maisons des Boulangers » […] » La municipalité demanda (et obtint) la création de « marchés à une certaine distance de la Ville, où l’on feroit une Barrière, & où les étrangers pourroient apporter leurs denrées, & les habitans de Marseille les y aller acheter sans se communiquer ensemble », Bertrand, Jean-Baptiste [1779], Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Amsterdam : J. Mossy.
[109] À Nîmes, lors de l’épidémie de peste de 1649, on avait également emmuré les habitants des arènes – d’où la peste était partie – alors elles aussi densément peuplées par les familles les plus pauvres dans des conditions sanitaires épouvantables.
[110] « pour prendre l’eau du Rhône, abreuver leurs bestiaux et travailler dans les terroirs du Tresbon, la Crau, et le plan du Bourg, sous cette condition toutefois que les hommes poseront sur leurs chapeaux et les femmes sur leurs coiffes, chacun une croix rouge […] sous peine, contre les contrevenants, d’être punis de mort au premier avertissement ». (Caylux Odile, op. cit.). L’épidémie augmentant, l’autorisation est supprimée.
[111] « les pauvres ne peuvent tous être comptés, tant ils sont nombreux » (Pepys, p. 164).
[112] Malthus, Thomas R. [1803], An Essay on the Principle of Population, London : Johnson (L. IV, 6, p. 531). Une phrase que l’on ne trouve que dans cette 2e édition (de fait un livre entièrement nouveau), trop choquante, Malthus préféra la retirer.
[113] Immunité collective des rats, morts des puces « bloquées » et donc propagatrices, raisons climatiques (humidité, température), elles sont mal connues et différentes d’une épidémie à l’autre.
[114] Bell, Walter George [1976], The Great Plague in London in 1665, AMS Press, London, 1re éd. 1924, d’après Graunt.
[115] Pepys observe le 7 juin deux ou trois maisons condamnées marquées d’une croix rouge ; le 29 juin, il observe que la cour du palais de Whitehall est encombrée de gens et de voiture en partance pour la campagne; le 20 juillet il note que l’épidémie bat son plein : « But, Lord! To see how the plague spreads » ; le 10 août, montée rapide des morts : plus de trois mille décès cette semaine ; 12 août : « The people die so, that now it seems they are fain to carry the dead to be buried by day-light, the nights not sufficing to do it in » (les enterrements avaient lieu la nuit pour éviter les rassemblements); 31 août, il écrit : « But, Lord! how every body’s looks, and discourse in the street is of death, and nothing else, and few people going up and down, that the towne is like a place distressed and forsaken. » ; le 1er septembre, il prépare son départ pour Woolwich, mais il continuera de vaquer à ses affaires publiques, privées et « très privées », au cours du mois il observe les feux purificateurs dans la ville, la folie des gens qui continuent de suivre les enterrements, la mort de tous les médecins de Westminster ; au cours du mois d’octobre Pepys se félicite de la chute de la mortalité, il est toujours très occupé par ses affaires publiques et privées ; le 4 décembre Pepys retrouve son habitation à Londres ; au cours du mois et début janvier les notables rentrent dans la City. En février 1666, le roi et la Cour reviennent dans la City.
[116] Biraben, Jean-Noël, Les hommes et la peste, Mouton, 1975, t. I, p. 236 et 301 ; Carrière, Courdurié, Rebuffat, op.cit.
[117] « Thence to the Exchange, where I have not been a great while. But, Lord ! how sad a sight it is to see the streets empty of people, and very few upon the ’Change. Jealous of every door that one sees shut up, lest it should be the plague; and about us two shops in three, if not more, generally shut up. »
[118] Defoe observe que des navires (surtout hollandais) tournèrent à leur avantage l’ostracisation des navires londoniens ou anglais : ils emplissaient leur cale de marchandises anglaises dans des ports peu atteints par la peste et ils allaient les revendre dans des pays tiers en cachant leur provenance. D’où des contagions.
[119] Les indigents qui tentèrent de fuir la ville moururent aussi souvent de faim, personne ne voulant les secourir.
[120] « but as the terror of the infection abated, those things all returned again to their less desirable channel and to the course they were in before. » (Defoe, 266-267 ; eng, 223)
[121] Leasor, James [1962], The Plague and the Fire, London: Allen and Unwin, p. 193-196
[122] Les Flamands et surtout les Hollandais en profitèrent, achetant les marchandises en divers ports anglais (libres de peste), les ramenant chez eux, et de là les réexportant en les faisant passer comme produites chez eux (321).
[123] 18 novembre 1722, ouverture des portes de la ville ; mai 1723, levée du blocus de la Provence ; janvier 1724, rétablissement de la liberté du commerce maritime.
[124] Carrière, Courdurié, Rebuffat, Marseille ville morte : la peste de 1720, op.cit.
[125] Cf. Fusco, [2009], op.cit.
[126] Carrière, Courdurié, Rebuffat, op.cit.
[127] À Naples où les élites ont été durement frappées, lorsque finalement les grands propriétaires et la Cour reviendront, cela relancera l’activité grâce à leurs dépenses, à leur domesticité, etc.
[128] Petty, William [1682], « Another Essay in Political Arithmetick Concerning the Growth of the City of London”, in : The Economic Writings of Sir William Petty, Cambridge University Press, 1899, vol. 2, p. 451-478 (rééd. Charleston SC : Eebo, 2011).
[129] Dès 1636, la nouvelle loi autorisant l’esclavage et la traite négrière est mise en œuvre par le gouverneur Henry Hawley à La Barbade qui devient dès 1640 un grand centre producteur de « sucre esclave », inaugurant la série des îles à sucre » anglaises.
[130] Villari, Rosario [1967], La rivolta antispagnola a Napoli: Le origini (1585-1647), Biblioteca di cultura moderna, vol. 635, Bari : Laterza.
[131] Sur l’économie de Naples et du Royaume de Naples avant la grande peste, cf. Tiran, André [2020], Le Royaume de Naples (1580-1620, Économie, monnaie et finance à l’époque d’Antonio Serra, Paris : Classiques Garnier.
[132] Fusco, Idamaria [2007], Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Milan : Angeli. Preuve de son rétablissement économique, mais aussi du durcissement de la fiscalité, le Royaume de Naples était redevenu l’un des plus importants contributeurs du Trésor espagnol.
[133] Benaiteau, Michèle [1980], « La rendita feudale nel Regno di Napoli attraverso i relevi: il Principato Ultra (1550 - 1806), in : Società e storia, n° 9, p .562-611.
[134] Les États-Unis au 3e trimestre 2020.