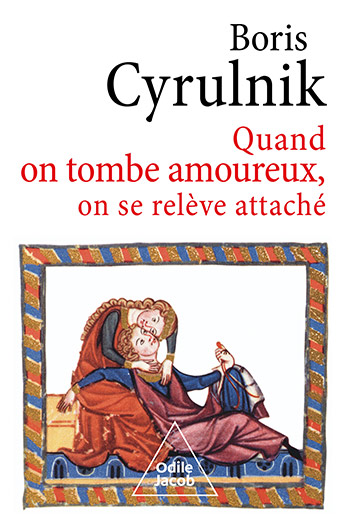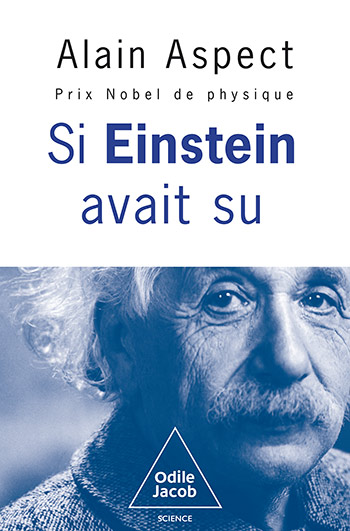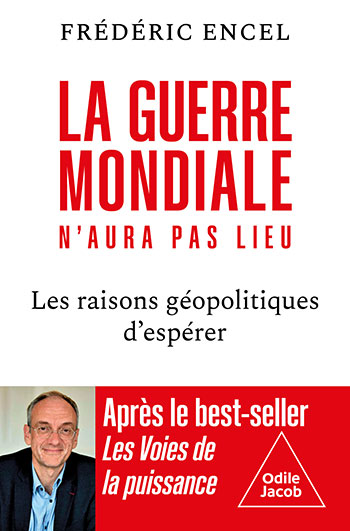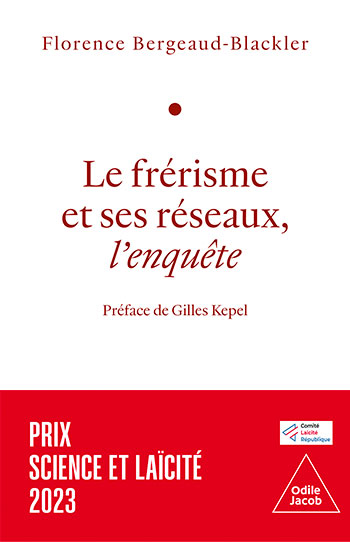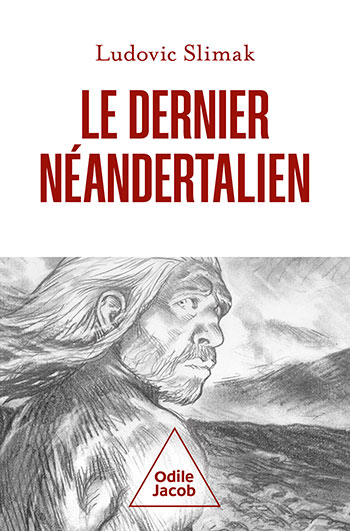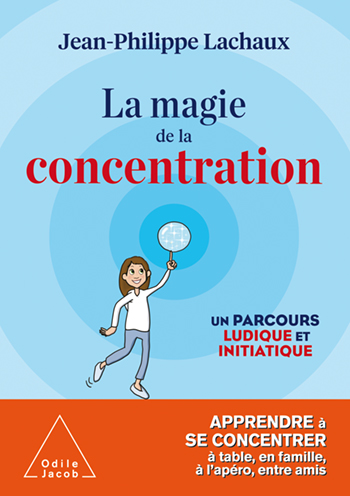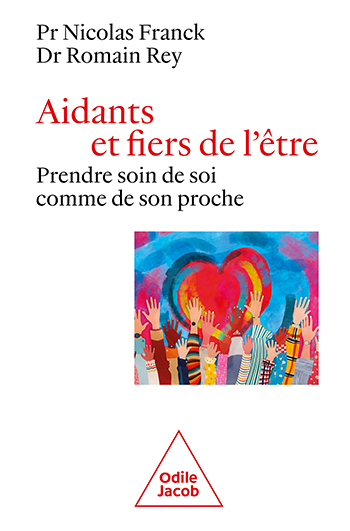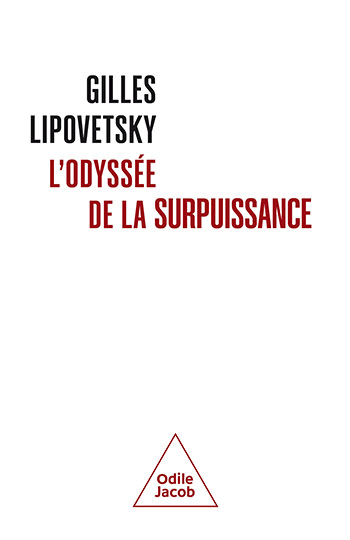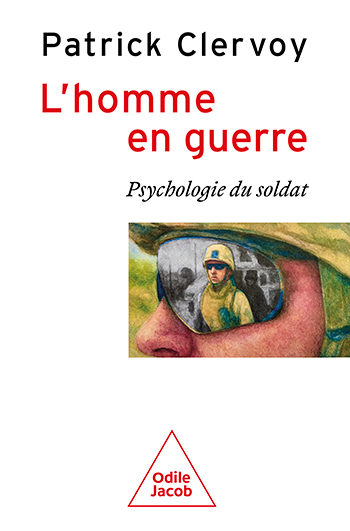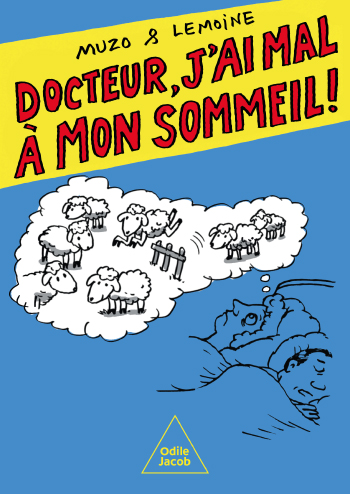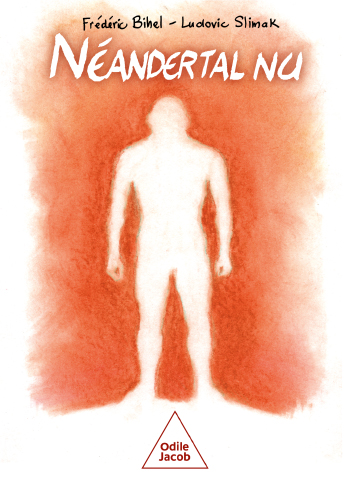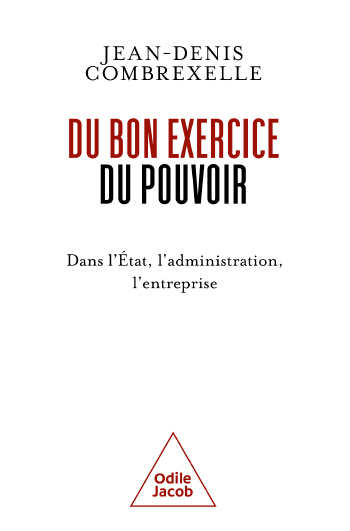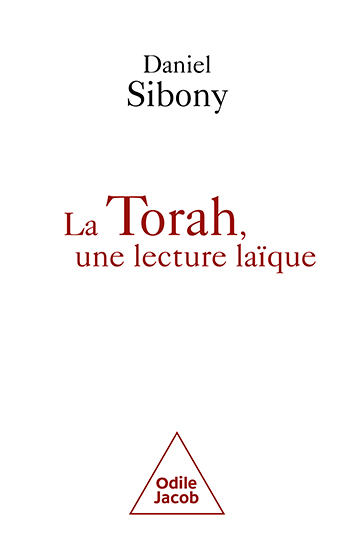Le fait majeur de ces dix dernières années est l'accès de la Chine au rang de puissance économique, technologique et géopolitique à parité avec les États-Unis. Les États-Unis sont désormais incapables d'exercer le leadership sur le « monde libre » qui fut le leur après la séquence WW1-WW2. Le « déclin de l'empire américain » est irréversible. Cependant la Chine ne remplacera pas les États-Unis dans la position hégémonique qui fut le leur dans le passé.
Le monde à venir sera donc multipolaire. Avec de fortes différenciations des systèmes socio-économico-politiques. Nous sommes donc entrés dans un régime de vive compétition entre « modèles ». Les occidentaux ont cru bien à tort, à l'effondrement du bloc soviétique - seul système alternatif à l'époque- que leur modèle allait devenir universel car fondé sur des « valeurs » elles-mêmes universellement partagées. Rien de tel. C'était ne pas vouloir comprendre que la domination de l'Occident, initiée au 16éme siècle par les grandes découvertes et la révolution galiléenne, n'était qu'une courte parenthèse dans l'histoire longue.
Le multilatéralisme dans un monde multipolaire.
On était donc déjà entré, dès avant la crise sanitaire et économique actuelle, dans une ère de compétition globale sur tous les plans : géopolitique, économique et politique. Une situation a priori peu favorable au multilatéralisme, qui prend acte de l'interdépendance des nations. Or le multilatéralisme reste plus que jamais vital dans un monde de puissances, certes en vive compétition, mais profondément et de plus en plus interdépendantes. A un point inconnu dans l'histoire. Une interdépendance qui n'a rien à voir, par exemple, avec celle du monde de 1929. La pandémie de Covid 19, qui en annonce bien d'autres, nous le rappelle, et bien sûr le changement climatique. Mais aussi l'instabilité menaçante et globale de la finance, ainsi qu'une révolution numérique d'emblée globale et l'intrication des systèmes productifs qu'elle continuera à favoriser.
A mon avis le multilatéralisme, au-delà des soubresauts actuels, ne reculera pas. Mais le multilatéralisme d'hier, mono-centré, va devoir se réinventer et sera nettement plus « concurrentiel ». Le gouvernement chinois ne présente-t-il pas l'initiative des « nouvelles routes de la soie » (mieux nommée en anglais « One Belt One Road ») comme une nouvelle forme de multilatéralisme, tandis que d'autres la qualifie d'impérialisme ? Il me paraît incontestable que la crise sanitaire et économique va encore renforcer la montée en puissance de la Chine et plus généralement de l'Asie de l'est.
Démondialisation ?
On entend partout affirmer que la « mondialisation » va, en conséquence, refluer. J'ai pour ma part développé (dans « L'inégalité du monde ». Gallimard, Folio Actuel. 2019) la thèse que la phase libérale et occidentale de la mondialisation s'est achevée dès la fin des années 2010, avec l'émergence de la Chine et son accession à la parité technologique, et qu'une nouvelle phase s'ouvre, que j'ai qualifiée de mondialisation « mercantiliste ».
Le mercantilisme du 17ème siècle consistait attirer le maximum d'or dans le royaume. Le mercantilisme contemporain consiste à attirer le maximum d'emplois « nomades », l'or moderne, dans son territoire. J'ai qualifié de « nomades » les emplois qui produisent des biens et services échangeables internationalement. Un emploi nomade est donc toujours en compétition directe avec des emplois nomades situés dans d'autre pays. Ces emplois sont nomades car les firmes peuvent mettre en compétition tous les territoires pour les localiser, en fonction de leurs avantages comparatifs de coûts de production et des perspectives de développement des marchés qu'ils permettent de servir.
Cette nouvelle phase de la mondialisation se caractérise par une compétition accrue entre deux types, forts différents, de capitalismes. D'une part, le capitalisme chinois, fermement et stratégiquement dirigé par le PCC, visant à doter son territoire d'un système productif complet et pour ce faire, mercantiliste dès l'origine. D'autre part, les capitalismes occidentaux, libéraux mais contraints à leur tour à devenir quelque peu mercantilistes et à réviser le rapport États/marchés.
La mondialisation : de quoi parlons-nous ?
Cela signifie-t-il pour autant un recul de la « mondialisation » ? Et d'abord de quoi s'agit-il ? J'ai proposé de parler non pas de « mondialisation », mais de trois « globalisations » encastrées : du numérique, de la finance, des firmes.
La globalisation numérique.
L'économie numérique, dont la « matière première » sont des données numérisées, est par nature « globale ». Les données circulent instantanément, à coût direct nul et sans entraves. Certes, les gouvernements peuvent temporairement restreindre l'accès à Internet de leur population. Une restriction toujours contournable (c'est la lutte perpétuelle entre la lance et le bouclier) et qui ne saurait être générale et prolongée, sauf à s'enfermer dans un modèle de type nord-coréen.
De plus, la révolution numérique n'en est qu'à ses (tout) débuts. Prochaines étapes : la connexion haut débit et transfrontière de quasiment tous les humains par la 5G et plus encore l'explosion attendue de « l'Internet des objets » qui connectera des dizaines de milliards de capteurs-producteurs de données, de microprocesseurs, et d'actionneurs-robots, à grand renfort d'intelligence artificielle.
Les relations numériques entre humains, à savoir les « télé-relations » : télé-travail, -enseignement, -autoformation, -médecine, -soin des autres, -jeux, -loisirs, -apéritifs, -célébrations religieuses et civiques, etc, avaient commencé de se développer bien avant la crise, mais à un rythme ralenti par les routines, les pesanteurs bureaucratiques, le manque d'imagination et des craintes justifiées pour l'emploi.
L'expérience massive de ces relations numériques, grâce et à cause des confinements, aura à l'évidence un effet d'accélération de la prise de conscience du potentiel de remplacement des relations en présence physique par du « télé-x ». Mais aussi, et à mon avis tout autant, une mise en évidence des limites de ce remplacement et par conséquent de la nécessité d'organiser la complémentarité entre relations numériques et en présence physique :
Le télétravail, y compris le télétravail « international », va se développer de manière très probablement accélérée, mais c'est beaucoup moins vrai des relations sociales, amicales et ludiques entre individus.
Cette expérience forcée va aussi, bien sûr, faire monter plus rapidement en puissance l'ensemble des questions politiques et sociétales que pose la révolution numérique
En bref, la révolution numérique constitue, dans le domaine de l'économie et bien au-delà, une cause essentielle de l'interdépendance croissante entre nations évoquée ci-dessus. Or, aucun recul n'est prévisible de cette forme de globalisation, majeure car conditionnant les deux autres.
La globalisation financière
Depuis la crise de 2008, rien de fondamental n'a changé dans la finance globale. On s'est contenté d'exigences réglementaires accrues de fonds propres et de liquidités pour les banques. Seule la Chine, en raison de la convertibilité seulement partielle de Yuan, associée à d'immenses réserves de change, pourrait parvenir aujourd'hui à s'isoler quelque peu des bulles spéculatives et krachs inhérents à la finance globale de marché, lesquels constituent un risque économique majeur, signalé par de nombreux experts bien avant la crise et considérablement amplifié par elle.
Une profonde réforme de la finance globale est un chantier urgent. Les idées avaient considérablement évolué ces dernières années, en particulier avec les débats autour de la « théorie monétaire moderne » (Modern Monetary Theory, MMT), qui pour faire très court tournent autour de la « monnaie hélicoptère », distribuée directement aux ménages et aux entreprises en passant au-dessus des banques, et du financement quasi illimité des investissements publics par création monétaire.
Cependant, la politique monétaire n'est pas, et de loin, le tout de la question. Si l'on veut réformer la finance globale, il s'agit de réglementer l'ensemble de la finance et non les seules banques : les assurances, les divers types de fonds d'investissement, les marchés eux-mêmes, bref ce qu'on nomme le « shadow banking », dont le grand public a largement ignoré l'importance dans le financement de l'économie. Il s'agit d'instaurer, entre la sphère de la monnaie créée par les banques commerciales et celle de la finance de marché, des « coupe-feu » pour maitriser le « risque systémique ».
Enfin, je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont les grands blocs monétaires pourraient, en limitant la circulation de certains types de capitaux, en particulier les plus volatiles, regagner, à l'instar une fois de plus de la Chine, plus d'autonomie en matière de politique monétaire et surtout de capacité à garantir la stabilité financière dans leur zone. Autrement dit instaurer des « coupe-feu » pour ralentir la propagation du risque systémique, non seulement entre banques et finance de marché, mais internationaux, entre grandes zones monétaires et financières.
Sans ce type de réformes radicales, la crise économique actuelle engendrera très probablement une crise financière globale bien plus violente que celles de 1929 et de 2008. Mais, même avec ces réformes, la finance, comme le numérique, restera par nature « globale ».
La globalisation des firmes
Quand on parle de « démondialisation », on ne parle donc en vérité que de recul de la « globalisation des firmes » qui produisent des biens et services internationalement échangeables. Ce à quoi ne se réduisait pas et de loin, comme on vient de le souligner, la phase libérale de la mondialisation qui s'achève.
Lors de la phase libérale des globalisations, la répartition des emplois nomades dans le monde a été bouleversée, provoquant un éclatement des « chaines de valeur mondiales », rendu possible par l'abaissement des coûts de transport, la coordination numérique des activités et la finance globale. Le terme de « délocalisation » (une entreprise ferme une usine dans un pays pour ouvrir la même dans un autre, parce que le coût du travail y est plus faible) est trompeur car il ne désigne qu'un aspect du phénomène. Le mouvement d'ensemble est en effet une forte augmentation de la création nette d'emplois nomades dans le monde, et pas seulement dans l'industrie manufacturière. Ainsi les emplois du tourisme, en forte expansion, sont nomades puisqu'un emploi dans le tourisme en France est en compétition avec un emploi dans le tourisme en Italie, en Grèce ou au Maroc. Il en est de même dans les services numériques, qui sont parfaitement internationalement échangeables, et dont on a dit qu'ils vont continuer de se développer.
On avait déjà beaucoup parlé, dès avant la crise, d'un mouvement spontané de relocalisation de l'industrie manufacturière aux États-Unis et en Europe, pour des raisons de qualité des produits issus des segments délocalisés et de l'importance, dans les flux tendus, de la proximité physique des clients. Quelques exemples ont été montés en épingle, mais le phénomène est resté très marginal. La raison en est simple. Certes, si l'on peut fabriquer à bas coût, car pratiquement sans main d'œuvre peu qualifiée, des chemises avec des imprimantes 3D dans un atelier du Bronx, point n'est besoin de les importer de Dacca. Mais on pourrait tout aussi bien fabriquer des chemises en atelier d'impression 3D au Bengladesh, où les programmeurs et les opérateurs qualifiés seront longtemps moins coûteux que dans le Bronx. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il est toujours encore moins coûteux de les y fabriquer avec des machines à coudre et une main d'œuvre corvéable à merci dans un « sweatshop ».
En bref, ma conviction est que les perspectives de croissance des marchés intérieurs d'une part et d'autre part la loi ricardienne des avantages comparatifs, qu'ils soient naturels (dans la production des matières premières), ou construits et temporaires (dans l'industrie manufacturière et les services), continueront à gouverner les tendances lourdes de localisation des emplois nomades dans le monde. Sauf ruptures graves de l'ordre géopolitique mondial, peu probables en raison des interdépendances croissantes évoquées ci-dessus.
Les politiques étatiques
Il est cependant évident que les crises en cours, même si elles seront à mon sens de peu de conséquences sur les tendances lourdes décrites ci-dessus, vont infléchir significativement certains aspects des politiques étatiques.
Les industries « stratégiques »
Dans la crise sanitaire actuelle, la pénurie de masques, tests, respirateurs et molécules de médicaments génériques a soulevé l'indignation. On parle en Europe de rapatrier massivement les industries « stratégiques », sans se donner la peine de les définir. La fabrication de masques est-elle une industrie stratégique ? Certainement pas. La « relocalisation » de tous les segments des chaînes de valeur n'est y pas nécessairement la meilleure solution, comparée à une combinaison de stocks de précaution suffisants pour faire face au très court terme, suivi de l'activation d'outils de production flexibles, capables de passer d'une production à l'autre et de monter rapidement en puissance
(Voir Thierry Weil : https://theconversation.com/la-resilience-de-lindustrie-ne-passe-pas-toujours-par-la-relocalisation-136619 )
Reste qu'il existe bel et bien des industries « stratégiques ». Ou plus précisément des « pôles stratégiques » d'excellence technologique, pôles qui articulent toujours recherche, développement et certaines productions, intimement liées. (Voir le rapport « Faire de la France une économie de rupture technologique » Février 2020.
https://www.vie-publique.fr/rapport/273229-faire-de-la-france-une-economie-de-rupture-technologique )
La localisation de ces pôles stratégiques dans un territoire, et préférentiellement par des entreprises sur lesquelles le gouvernement a un réel pouvoir de contrôle, est une absolue nécessité quand ce territoire prétend jouer dans la « cour des grands » du monde multipolaire qui émerge.
L'Europe constate que le « grand jeu » économique et technologique pourrait se limiter au duopole États-Unis/Chine, si elle ne réagit pas vigoureusement. Elle affiche cette ambition et a encore, pour quelques années au moins, les moyens de cette ambition. En témoignent la réapparition de « politiques industrielles » - un concept jusqu'ici tabou en Europe-, avec par exemple l'initiative franco-allemande concernant l'industrie des batteries.
Même si les avantages comparatifs de David Ricardo continueront à mon sens de façonner les tendances lourdes de la localisation des activités nomades au plan mondial, l'Europe est fort heureusement en train de redécouvrir l'autre grand penseur de la division internationale du travail, l'allemand Friedrich List et ses thèses sur « protection des industries naissantes » (en l'occurrence en Europe, « renaissantes »). Des politiques que les Japonais puis les Coréens et bien sûr les Chinois ont pratiqué de longue date, ainsi que dans les années 70 l'Europe des grands programmes, nucléaires, aéronautiques et spatiaux. Je n'entends nullement par là qu'il faudrait répliquer les grands programmes européens du passé à l'identique dans d'autres domaines, comme le numérique, mais en retrouver l'esprit et l'ambition.
Sortir de l'obsession des emplois nomades
Conserver et augmenter les emplois nomades créés par les firmes nationales et attirer ceux que les firmes globales distribuent à leur guise, est sans conteste une nécessité. D'autant que la création d'emplois nomades dans un territoire entraine celle d'emplois sédentaires, ceux qui produisent des biens-services ne traversant pas les frontières, donc consommés localement. Ainsi, j'ai calculé avec Philippe Frocrain qu'en France, entre 2008 et 2016, la création de 100 emplois nomades a entraîné celle de 80 emplois sédentaires (Voir : « The Evolution of Tradable and Non‐Tradable Employment: Evidence from France ». Economics and Statistics N° 503‐504, 2018).
Il reste que la part nomade des économies nationales est partout très minoritaire. Elle croît certes dans les pays émergents, mais elle est en décroissance dans tous les pays riches. En France, la part des emplois nomades dans l'emploi total est passé de 28% à 24 % entre 1999 et 2015, et plus de la moitié des emplois nomades y sont désormais des emplois de service. L'évolution est similaire en Allemagne, en Grande Bretagne et aux États-Unis.
Or le pouvoir des États sur la part « sédentaire » de leurs économies reste en théorie entier et ce, quelle que soit la taille de leur marché intérieur. Stimuler l'économie sédentaire de son territoire est donc pour tout État un enjeu économique en fin de compte plus important que l'obsession actuelle d'attraction des emplois nomades. Ceci suppose des politiques spécifiques qui ont été jusqu'ici largement négligées.
Les attentes des populations à l'égard des États
En Europe, mais ceci vaut aujourd'hui pour la plupart des pays, la demande politique des populations, amplifiée par la crise n'est pas tant plus « d'État social », un État distribuant à tous des services et des biens publics uniformes, mais « plus d'État protecteur ». Protecteur contre la mort, la maladie et la vieillesse abandonnée, contre l'extrême pauvreté, la misère et l'exclusion, contre ce que j'ai appelé « l'Inutilité » économique et sociale , contre les violences civiles dont font partie la surexploitation capitaliste. Ce sont aujourd'hui en réalité des fonctions régaliennes des États qui sont jugées mal assurées.
Montée en puissance de l'idée de « revenu universel »
Une des conséquences de ces demandes est l'amplification du débat sur le « revenu universel inconditionnel », solution en effet possible à la demande de protection, au moins en matière économique. Une idée qui a déjà une longue histoire et que la crise réactive. Un revenu universel distribué sous forme monétaire sans aucune condition m'apparaît cependant comme une manière un peu facile de se débarrasser des problèmes qu'il est censé soulager, à commencer par l'inutilité économique d'une part croissante de la population. Il me paraît beaucoup plus adéquat, quoique beaucoup plus difficile, de mettre en place des politiques visant à insérer chacun dans une activité productive ou socialement utile qui lui permette de vivre des revenus engendrés et qui le socialise.
Revalorisation des revenus des gens vraiment « utiles » ?
Un autre espoir suscité par la crise sanitaire, qui fait l'objet d'un très vaste consensus populaire, est la reconnaissance sociale et la revalorisation des revenus de tous ceux qui ont été « au front », tandis que la plupart des cadres travaillaient chez eux à l'abri de la pandémie, que les actionnaires (dont beaucoup de petits épargnants, on a toujours tendance à l'oublier) recevaient l'essentiel de leurs dividendes habituels et que les traders s'activent à tirer le maximum d'argent des turbulences des marchés financiers, dont j'ai dit qu'elles étaient largement devant nous.
A vrai dire, tout le monde ou presque savait très bien qu'une infirmière, un éboueur, une caissière de supermarché, un migrant qui quitte son pays pour ramasser dans un autre des fruits qui sans lui pourriraient sur l'arbre, un instituteur, un retraité d'EDF qui reprend du service et grimpe à 65 ans aux poteaux pour réparer les lignes en cas de tempête, et bien d'autres encore, sont beaucoup plus utiles à la société qu'un, disons, « trader » ou responsable de marketing dans la grande consommation, voire qu'un CRS supplémentaire (admettons cependant qu'il en faille quelques-uns) armé d'un LBD.
Mais désormais on le proclame et en France, tous les soirs à 20 heures, on sort sur son balcon pour applaudir les « soignants », tandis qu'en Inde, les hélicoptères de l'armée déversent sur les villes, en leur honneur, une pluie de pétales de roses…
Suivant le mouvement, le président Macron, dans son intervention du 13 mars, a cité la très belle deuxième phrase du premier article de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, qui aujourd'hui figure dans le préambule de la Constitution :
« Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »
Cela se traduira-t-il par une revalorisation de leurs revenus, quand le chômage aura explosé ou même plus tard, quand nous aurons surmonté une crise économique dont nul ne peut encore prévoir la profondeur et la durée ? Je crains fort que, de même que les avantages comparatifs continueront à gouverner la localisation mondiale des emplois nomades, la compétition sur les marchés du travail continuera à gouverner les salaires relatifs. On assistera peut-être à une revalorisation des salaires de certaines catégories de travail qualifié, comme les infirmières et les enseignants, en particulier dans le secteur public. Mais je crains que les éboueurs et les caissières continuent à être payés au smic et les ouvriers sans papiers en dessous. Certes, on pourrait revaloriser le smic, mais cela ne peut se faire qu'au niveau européen, et sous condition de quelques protections aux frontières contre le travail à très bas coût dans les sweatshops du monde pauvre.
En revanche, et c'est à mes yeux un des effets très encourageants de la crise, les débats antérieurs sur « l'identité française », le caractère prétendument inassimilable de « l'islam », les « « territoires perdus de la République », sont pour le moment renvoyés aux « oubliettes de l'histoire ». Tout le monde a bien vu de qui était composé « le peuple de France », et de quoi il était capable.
Quant à l'avenir plus lointain, ne mésestimons pas pour autant, pour paraphraser Mao Zedong : « la puissance des idées justes, quand les larges masses s'en emparent ». Mais le chemin sera long à parcourir.
Pierre-Noël Giraud est professeur d'économie à Mines ParisTech PSL et à l'Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc.
Dernier ouvrage publié aux éditions Odile Jacob : L'Homme inutile – une économie politique du populisme (janvier 2018)
Téléchargez l'article