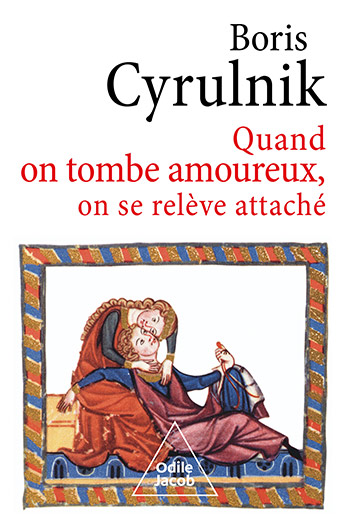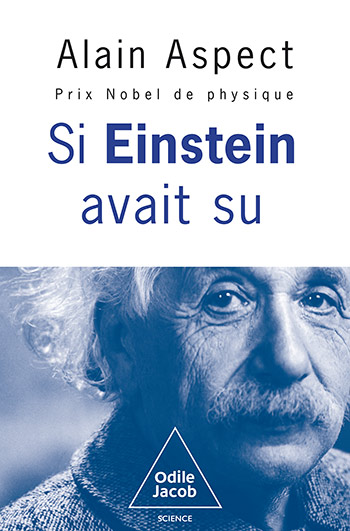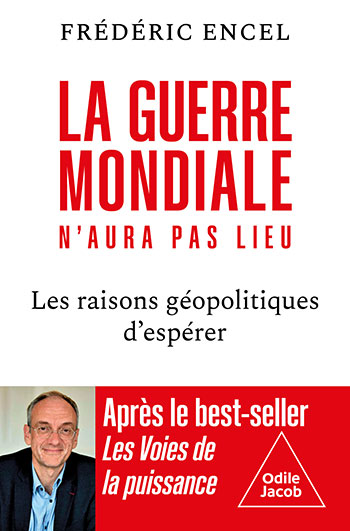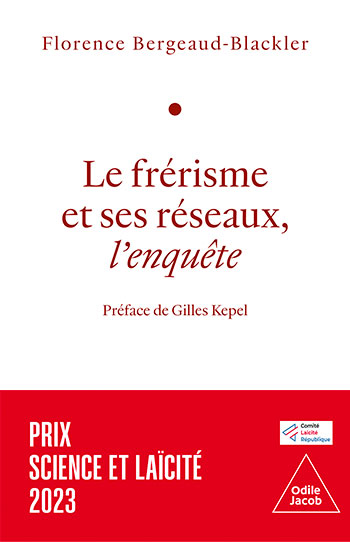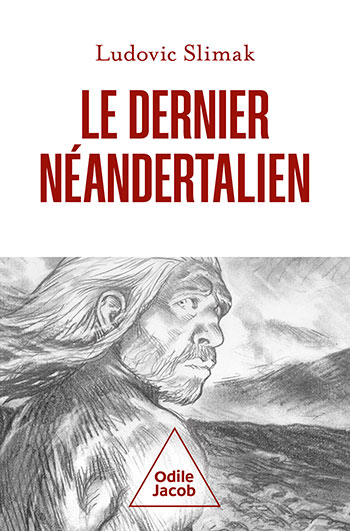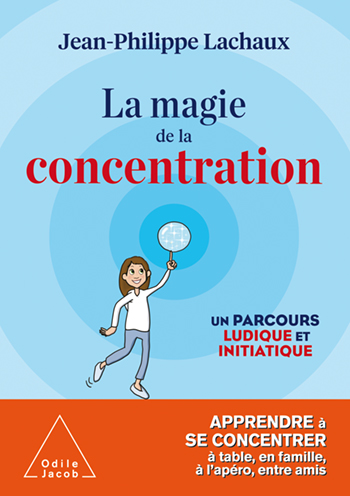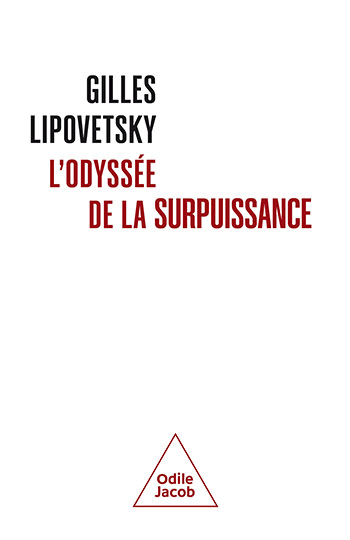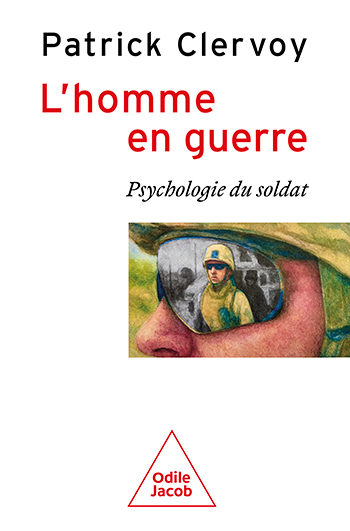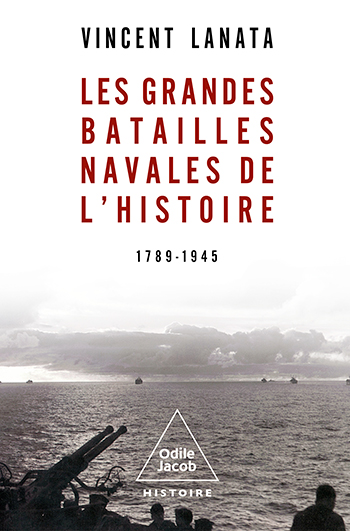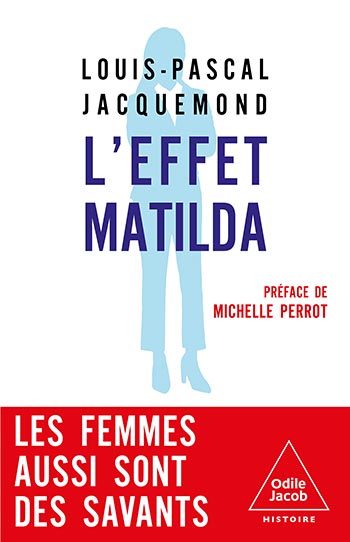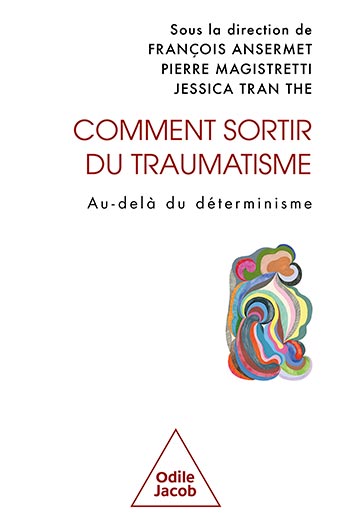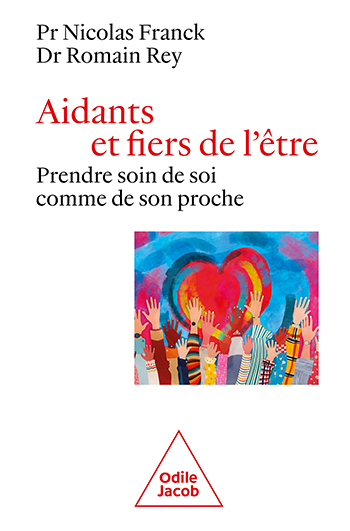Des siècles d’expérience internationale nous ont amenés à penser, construire et accomplir les politiques de sécurité en étroite association avec l’idée de nation. Face au monde dans lequel nous vivons, la menace ne pouvait venir que de l’autre semblable, l’ennemi-stratège qui avait pour objectif de porter atteinte aux paramètres essentiels de notre souveraineté afin de nous affaiblir et de gagner de nouveaux avantages. La cible était ainsi notre intégrité nationale, nécessairement conçue en termes territoriaux. Quoi de plus normal ? Une géopolitique triomphante ramenait notre existence internationale à la réalité exclusive d’un Etat-nation souverain dont l’incarnation était d’abord territoriale et frontalière : la sécurité passait naturellement par l’idée de sanctuaire. A partir de cette conviction profonde, qu’il eût été blasphématoire de remettre en cause, toute la vie internationale s’éclairait d’un même mouvement : elle était articulée autour de l’opposition fondatrice de l’ami et de l’ennemi qui l’emportait évidemment sur l’idée-utopique- de l’autre coopérant ; si coopération il y avait, celle-ci se pensait prioritairement en termes d’alliance compétitive ; enfin, le jeu de chacun des acteurs était « à somme nulle », les gains des uns faisant la perte des autres…
On voit défiler, à travers ce prisme, bien des images familières de notre mémoire nationale : la « ligne bleue des Vosges », la ligne Maginot ou l’évocation de Strasbourg, séparée de l’armée rouge par l’équivalent de « deux étapes du tour de France », selon la formule même du Général de Gaulle. Reviennent aussi toutes les thématiques classiques de la « défense nationale », dont la concrétisation passait inévitablement par les figures traditionnelles de l’instrument militaire. Ce répertoire, où se mêlent les ombres de Clausewitz et de Carl Schmitt, deux figures du XIXéme siècle, a fabriqué notre histoire contemporaine. On ne prétend pas pour autant que celle-ci est close : tant que demeureront les Etats-nations (certainement longtemps encore), elle ne sera pas abolie. Depuis quelques temps, et notamment la décolonisation et la dépolarisation, son récit perdait pourtant déjà une part de sa crédibilité, tant les « nouvelles guerres », en Afrique ou au Moyen Orient, ne lui ressemblaient pas, même si nous ne voulions pas voir ce changement profond qui affectait progressivement la conflictualité, devenue irréductible à nos vieilles grammaires.
Aujourd’hui, la pandémie de coronavirus contribue à tout bouleverser. La menace ne vient plus d’un ennemi, mais d’un processus viral. Elle n’oppose plus les humains entre eux, mais les réunit face à un même danger. Elle ne vise plus un territoire, mais cible le monde, non dans ses logiques souveraines ou territoriales, mais dans son interdépendance. Elle n’est pas le fait d’un stratège malveillant, mais des lois de la virologie. Elle ne suscite pas un jeu à somme nulle, mais un combat dans lequel les pertes des uns font les pertes des autres, et les gains accumulés par les uns bénéficient à tous les autres. La sécurité n’est plus nationale, elle est devenue globale : plus exactement, « ma sécurité nationale » dépendra désormais de mon aptitude à la soumettre à une sécurité qui est celle de l’humanité toute entière.
Voilà qui fut bien difficile à admettre : il est même pathétique d’observer le réveil crispé des tenants de la vieille grammaire « géopolitique ». Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’OTAN, lance ainsi un appel pressant, dès mars 2020, aux États affiliés pour ne pas renoncer à hisser leur budget militaire à 2% de leur PIB, au moment même où une commission se crée, au sein de l’organisation, pour définir sa raison d’être… En bien des lieux, là où souffle le vent du néo-nationalisme, on consent des efforts remarquables pour « renationaliser » le virus, lui donner un passeport, exiger de lui un visa, en faire l’instrument d’une puissance étrangère, se lancer dans tout un tas de guerres, celle des masques, des tests, des vaccins, celle même des scores nationaux, ou encore celles pour fermer les frontières, accuser les migrants, dénoncer la mondialisation… Des figures familières de l’ardeur néo-nationaliste s’illustrent par leurs tweets et leurs discours, voire leurs provocations : Donald Trump, Jair Bolsonaro, face au monde, Narendra Modi ou Viktor Orban face à leur nation…
En réalité, le passage d’un logiciel à l’autre n’est pas simple, surtout quand on est dans l’urgence. Celle-ci est davantage traitable avec les moyens du bord, ceux de plusieurs siècles de défense nationale. Il est évidemment plus simple de décider vite là où les structures d’autorité existent et ont toute chance d’être immédiatement obéies. Il peut paraître plus efficace d’agir au plus près d’une population plutôt que d’un hypothétique centre de la décision mondiale : les institutions étatiques elles-mêmes en firent l’expérience à leurs dépens dans les régimes fédéraux où les gouvernements locaux les ont pris de vitesse, érodant à leur manière le principe d’une défense nationale unique. Tout ceci est vrai, mais terriblement insuffisant. D’abord, ce rythme national ou local agit par défaut et ne doit sa supériorité qu’à l’impréparation. Voilà près de trente ans que les instances internationales, les chercheurs, les militants associatifs nous avaient alertés sur cette mutation de l’idée de sécurité. Il n’est que de se rapporter au « rapport mondial sur le développement humain », publié par le du PNUD en 1994, qui soulignait déjà les vrais périls, cette ardente nécessité de libérer les humains d’une peur qui ignorait les frontières et les patries, dérivant des nouvelles insécurités alimentaires, sanitaires et environnementales notamment…Aucune production institutionnelle nouvelle, ou presque, n’a suivi ce constat de fond: peut-être était-cela une terrible première dans le triste roman de l’insouciance internationale… En outre, la réactivité nationale, généralement pensée avec sérieux, du moins lorsqu’on la tenait pour nécessaire, s’est révélée sous forme d’une addition de 193 politiques sanitaires, mal ou peu articulées les unes aux autres, différenciées dans leurs instruments de mesure et leurs critères, parfois tristement concurrentielles dans leurs modalités, toujours incomplètes car obéissants aux normes nationales et non internationales (qui souvent n’existaient même pas).
C’est peut-être au cœur même de ces contradictions que se situe l’innovation la plus remarquable portée par la crise sanitaire mondiale. Solidairement, l’opinion publique et les dirigeants, les uns dans leur chair, les autres dans leurs angoisses professionnelles, ont enfin pris la pleine mesure de ce qu’implique l’interdépendance généralisée. Souvent sans se l’avouer, parfois même en affirmant le contraire, ils conviennent, l’un et l’autre, de l’inéluctabilité d’une gouvernance globale qui devra rapidement s’emparer de bien des secteurs, notamment de celui de la santé, jusqu’ici soigneusement calfeutrée dans son carcan souverainiste. On l’avait déjà pressenti, notamment à propos du changement climatique qui tue, chaque année, dans l’anonymat des millions d’humains, à la manière de la malnutrition qui en fait plus encore. L’un et l’autre sont comptables, et depuis bien longtemps, d’infiniment plus de victimes que le Covid 19… Mais la différence est forte : dans un cas comme dans l’autre, seuls ceux qui souffraient ressentaient le problème dans sa pleine dimension, c’est-à-dire une toute petite partie de l’humanité. Les autres pouvaient s’offrir le luxe de l’indifférence ou se laisser bercer par l’illusion de la sanctuarisation dont ils se croyaient les bénéficiaires…
Nous sommes ainsi dans un contexte somme toute banal et déjà répertorié : tiraillés entre un besoin d’intégration intellectuellement admis et sa satisfaction concrète qui demande des efforts et des innovations que chacun redoute. Bien des crises ont suscité ce genre de dilemme parfaitement décrit par David Mitrany, dans les affres de la seconde guerre mondiale (Mitrany, 1943). C’est ainsi, ente rêves et cauchemars, qu’a été imaginée l’intégration européenne...pour se concrétiser tout de même, au moins sous une forme minimale. Mais il fallut 60 millions de morts pour qu’on acceptât de franchir le pas. Autant de victimes qui ne suffirent pas pour produire un multilatéralisme pleinement efficace, au moins sur le plan sanitaire. On peut alors tenter de mettre l’instrument avant les principes, définir les conditions d’optimisation d’une OMS qui brilla autrefois dans plusieurs domaines (comme les campagnes de vaccination en Afrique ou celles pour assainir l’eau sur ce continent), mais dont on perçoit empiriquement les manques dans la gestion de la présente crise. On peut se convaincre, en suivant ce chemin, que la sécurité globale est un bien commun de l’humanité qui ne se conquiert ni par les armes, ni par la puissance, mais par l’engagement multilatéral et le décloisonnement. De quoi nous porter vers un nouveau monde et briser les conservatismes tenaces. Mais qui en sera l’entrepreneur, dans ce contexte de nationalisme persistant ? N’est-ce pas là l’histoire d’un autre virus dont nul ne connait le vaccin et ont beaucoup croit encore qu’il peut être un remède ?
Mitrany, David, 1943, A Working Peace System, An Argument for the Functional Development of International Organization, Londres, The Royal Institute of International Affairs, Oxford University Press.
Professeur des universités à Sciences Po Paris, Bertrand Badie s’est imposé comme l’un des meilleurs experts en relations internationales.
Dernier ouvrage publié aux éditions Odile Jacob : L'Hégémonie contestée (octobre 2019).
[ Idées pour aujourd'hui et pour demain ]
Bertrand Badie
L'hypothétique triomphe de la sécurité globale : d'un virus à l'autre
Publié le 29 mai 2020